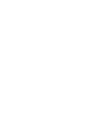Gimpel SAS
par sa petite-fille Cécile Wajsbrot et sa fille Denise Wajsbrot
Gimpel SAS par sa petite-fille Cécile Wajsbrot
C’était une photo…
C’était une photo posée sur un meuble de la salle à manger de ma grand-mère ou accrochée au mur, je ne sais plus, un visage de profil plus proche du dessin que de la photographie, barré en haut d’un bandeau tricolore bleu blanc rouge. Mais je dois confondre avec un papier qui était encadré, une sorte de diplôme, d’attestation de déporté. C’était un visage et un nom. Mon grand-père ? Plutôt le mari de ma grand-mère, un homme dont je ne connaissais qu’une image, qui n’en livrait pas grand-chose, et la façon qu’elle avait de parler de lui en disant, mon mari. Elle disait qu’il était bon, qu’il avait attendu sept ans avant de l’embrasser quand ils vivaient en Pologne et qu’ils n’étaient pas encore mariés, et elle racontait comment il avait été convoqué, le 14 mai 1941 – tout ce que j’ai écrit déjà dans Beaune-la-Rolande. C’était un être présent dans sa vie, son discours, jusqu’au bout, dans ses pensées – elle signait Mme Vve et ne s’est jamais remariée. Et comme elle était présente, tellement, pour moi, lui l’était aussi, mais pas comme un grand-père, je ne sais pas ce que c’est, un grand-père – j’ai connu le père de mon père, mais n’ai jamais vraiment eu de contact avec lui. Je sais ce qu’est une grand-mère, un mari, aussi puis-je imaginer le mari de ma grand-mère.
Avec le temps, avec la maladie de ma grand-mère, une hémiplégie qui la priva presque totalement de la parole les six dernières années de sa vie, ma mère prit le relais, prit la parole. Le mari de ma grand-mère devenait le père de ma mère. Il ne m’était pas plus proche ni plus connu pour autant, mais peu à peu vint la période où les archives s’ouvraient, où tout paraissait à la fois plus lointain et plus accessible et un jour, ma mère me montra un papier sur lequel figurait la date de la mort de son père – le 25 juillet 1942. Connaître cette date si longtemps après était étrange et paradoxalement, sa vie me parut alors plus concrète. Elle avait une fin repérable, il y avait un jour précis où il était mort, comme tout le monde, c’en était presque rassurant – un peu comme ces âmes fantomatiques qui cessent d’errer lorsque, enfin, quelqu’un de leur descendance peut réparer quelque chose.
Quelque temps plus tard à Berlin, au centre d’information qui se trouve au sous-sol du mémorial de l’extermination des Juifs d’Europe, je feuilletais un livre, une sorte de journal de bord de la vie quotidienne au camp d’Auschwitz et retrouvai le 25 juillet 1942. J’étais avec ma mère. Nous avons regardé. Ce jour-là, des dizaines de déportés étaient morts du typhus et d’autres causes, était-il écrit sans davantage de précisions. La veille, arrivait de Beaune-la-Rolande le premier convoi de femmes et d’enfants. Ma grand-mère racontait qu’à partir de ce moment-là, son mari ne voulut plus vivre – un cousin survivant le lui avait rapporté. Il était émouvant de trouver ses dires corroborés par ce récit scientifique. Ce jour-là, j’ai eu le sentiment d’approcher au plus près de la vie de mon grand-père, d’en avoir en quelque sorte une preuve objective, presque concrète, et en même temps, d’en saisir la limite, de ne jamais pouvoir aller plus avant, de ne jamais pouvoir l’atteindre – comme un rivage lointain demeurant à jamais inaccessible.
Gimpel SAS par sa fille Denise Wajsbrot
Mon père Gimpel SAS est né le 14 mai 1904 à Zalesie en Pologne, au Nord Est de Kielce où il vivait. Ils étaient dix frères et sœurs. L’un a réussi à passer en URSS, et c’est le seul survivant de cette grande famille. En 1947, il a transité par Paris (et c’est ainsi que je l’ai connu), avant d’aller au Paraguay et en Argentine.
Je ne sais pas si mon père venait d’une famille pratiquante ou politisée, je sais seulement que mon grand-père était colporteur.
Mon père est arrivé en France, déjà marié, fin 1929 ou début 1930, mon frère est né Kielce le 31 août 1929 et je sais que mon père a attendu sa naissance avant de quitter la Pologne. Il est venu à cause des pogroms, je pense, et du manque de travail, pour avoir une meilleure vie.
Du côté de ma mère, sa sœur était déjà en France avec son mari et ses deux enfants ainsi que deux de ses frères.
En arrivant en France, la vie a été très difficile. Ils ont habité Montreuil, puis rue au Maire, dans le 20e, et 1 rue Boyer, dans le 20e jusqu’à ce qu’on quitte l’appartement, en 1942.
Quand mon père est arrivé en France, il était coupeur, modéliste dans le cuir, chez des patrons.
Je suis née en 1932, et mon frère avait six mois quand ma mère est venue rejoindre son mari.
J’allais à l’école rue de la Bidassoa, une rue perpendiculaire à la rue Boyer. J’y suis allée à partir de quatre ans peut-être, jusqu’aux vacances de l’été 42, puisque le 16 juillet, on a échappé à l’arrestation, rescapés, miraculeusement, grâce à ma mère.
Je n’ai pas de souvenirs de l’arrestation de mon père. Ce que je sais me vient de ma mère : il a reçu une convocation, « le billet vert » et il y est allé très tôt, pour ne pas perdre trop de temps pour le travail. Je ne crois pas que mon père a hésité à y aller, parce que c’était quelqu’un de très droit. Et pour lui, échapper à la Loi ou à la réglementation, ce n’était pas possible. Puisqu’on le convoque, il faut qu’il y aille. Un frère de ma mère a reçu la même convocation, mais lui ne s’est pas présenté. Pour mon père, c’était inimaginable. Il ne pouvait pas le faire. En plus, je pense que, comme tout le monde, il était loin d’imaginer la suite.
Ma mère m’a dit qu’elle l’avait accompagné et qu’on lui avait dit de revenir avec quelques vêtements, peut-être une couverture, j’imagine, je ne sais pas. J’étais sans doute à l’école. Il était peut-être 8 heures, je ne sais pas.
Je crois qu’il a été convoqué au commissariat du 20e, qui se trouve près de la Mairie, place Gambetta. Puis il a été à la caserne Bd Morland. Ma mère devait être dans tous ses états, c’est sûr... Elle était catastrophée. Il se présente à la convocation, et voilà, il est gardé. Il ne peut plus sortir, prisonnier.
Ma mère n’avait pas de métier, elle ne travaillait pas. La situation matérielle fut d’un seul coup dramatique, alors qu’ils commençaient tout juste à être un petit peu à l’aise, après des débuts difficiles.
Mon père, bien qu’étranger, s’est engagé volontaire en 1939, dans l’armée française. Il est resté cantonné à Septfonds, puis démobilisé. Et six mois après c’était le 14 mai 1941…
Je ne sais pas quand ma mère a su qu’il était à Beaune-la-Rolande. Elle est allée le voir, mais je ne sais pas si c’était des visites autorisées ou si c’était officieux. Notre mère nous a dit que mon frère et moi sommes allés le voir, mais je ne m’en souviens pas. Elle y est retournée plusieurs fois et elle lui envoyait des colis.
Puis, en juillet ou août 1941, mon père a tenté une évasion en compagnie de deux internés. L’un était un cousin par alliance, du côté de ma mère, il s’appelait Bydlowski, le nom de jeune fille de ma grand-mère, et l’autre était un ami. D’après les documents que j’ai reçus du Cercil il n’y a pas longtemps, et c’est très émouvant, il s’appelait Goldberg. Le cousin n’est pas revenu non plus, et Goldberg, je ne sais pas. Ils étaient dans une charrette à cheval et par un hasard malencontreux, ils ont croisé d’autres internés que les gendarmes avaient rattrapés sur la route.
Quand ils ont vu cette charrette bâchée, ils l’ont arrêtée parce qu’elle avait l’air vide. Ils voulaient éviter de refaire le trajet à pied et retourner au camp avec leurs prisonniers. Le charretier, qui conduisait, a dit aux trois évadés de maîtriser les gendarmes, ce qui aurait été possible. Mais ils n’ont pas voulu. La tentative d’évasion a rapidement avorté. Je sais que ma mère a toujours dit que la sœur de ce cousin Bydlowski, qui était à Beaune pour cette circonstance aurait dû se trouver sur la charrette près du conducteur. Les gendarmes auraient vu qu’elle était occupée, et ils ne l’auraient peut-être pas arrêtée. Ma mère lui en a voulu terriblement.
Ils sont retournés au camp et mon père et les deux autres internés ont été condamnés à de la prison : dix jours plus dix jours supplémentaires. La condamnation figure dans le rapport de la direction du camp, du 3 au 9 août 1941.
Puis, le 8 mai 1942, il a été envoyé à Compiègne, et de là, déporté le 5 juin, par le convoi 2. Cécile, ma fille, a suggéré que, s’il a été envoyé à Compiègne, c’est à cause de sa tentative d’évasion, ce que confirme le Cercil. Il y est resté presque un mois, dans des conditions plus dures qu’à Beaune-la-Rolande. Ce camp, tenu par les Allemands eux-mêmes, était destiné aux politiques, résistants ou Juifs. Ces derniers étaient dans des baraques à part au fond du camp.
Cette année, au mois de Mai, je suis allée avec mon frère à Compiègne voir le nom de mon père gravé sur le mur du camp, à côté du monument et du musée.
Ma mère me disait que mon père était un non-violent, qu’il n’était pas taciturne, mais ne parlait pas beaucoup, et qu’il était très droit.
Mes parents parlaient yiddish et un petit peu polonais entre eux, quand ils voulaient ne pas se faire comprendre et sortir ou aller au cinéma. On finissait par deviner. Mon père avait appris le français en premier. Ma mère le parlait difficilement et avec un fort accent, d’autant qu’elle sortait essentiellement pour faire les courses. Pourtant c’est elle qui dirigeait la maisonnée, mon père lui confiait tout. D’après mes oncles, sa famille comptait par-dessus tout pour mon père.
Il y a des pans entiers de cette période que j’ai oubliés.
J’allais à l’école primaire, mais je serais incapable de citer le nom d’un enfant, ou d’une institutrice. J’ignore si d’autres enfants avaient leur père interné dans la classe. Je n’ai même pas de souvenir de mon arrivée en classe avec l’étoile jaune. J’avais pourtant presque 10 ans. J’ignore également si mon père nous a envoyé du courrier et si quelqu’un a aidé matériellement ma mère. Mon frère qui a trois ans de plus que moi se souvient de beaucoup de choses, mais il ne veut pas témoigner. Après bien des péripéties, il a été caché au Chambon-sur-Lignon.
En 1942, au moment de la rafle du Vel d’Hiv, nous étions à la maison. Ma mère souffrait de colites néphrétiques. Elle a simulé une crise la veille au soir, car il y avait des rumeurs d’arrestations et mon frère a réussi à faire venir un médecin, bien qu’il leur était interdit de se rendre chez les juifs. Lorsque les deux policiers français en civil sont venus nous arrêter tôt le matin, et lorsqu’ils ont dit à mon frère et à moi de nous habiller, ma mère s’est jetée à leurs pieds et leur a dit, « vous avez déjà pris mon mari, si vous voulez nous tuer, tuez-nous sur place ». Nous habitions un appartement de trois pièces qui donnaient toutes sur un long couloir et c’est là qu’a eu lieu cette scène. Je revois toujours ma mère allongée aux pieds de ces policiers. Ils ont dû miraculeusement se laisser attendrir, et ils lui ont demandé de fournir un certificat médical. Ils nous ont enfermés à clef, et heureusement, ma mère avait un autre trousseau. On est quand même restés vingt-quatre heures, avant de quitter l’appartement.
Les policiers sont revenus, mais nous étions partis, avec plusieurs couches de vêtements sur le dos en plein mois de juillet, pour éviter de prendre des valises, à cause du mauvais regard de la concierge.
On est partis chez la belle-sœur de ma mère, la femme d’un frère, celui qui n’avait pas voulu se rendre à la convocation et avait quitté Paris tout de suite. Elle n’était pas juive. On est restés rue Danrémont dans le 18e, dans une chambre de bonne inoccupée, au 6e étage. Je ne sais pas combien de temps. Je me souviens que mon frère et moi étions obligés de rester sur le lit tout le temps, sans bouger car le plancher grinçait. Puis on a été cachés à Colombes chez une amie de ma tante, sans doute trois semaines. Ma tante a trouvé un passeur qui devait nous conduire en zone libre. Mais il nous a trahis. Nous sommes restés en zone occupée, sur le quai à Libourne avec des soldats allemands à la sortie, sans papiers, puisqu’il avait gardé nos faux papiers. Nous avons réussi à passer la ligne de démarcation, sous des barbelés, et entre deux passage de patrouilles allemandes. Il fallait faire très vite. Nous avons ensuite rejoint mon oncle dans le Lot-et-Garonne. Ma mère a travaillé chez un paysan, je ne sais pas combien de temps, puis nous sommes partis à Villeneuve-sur-Lot. Je me souviens que j’étais dans une famille protestante, j’avais de longs cheveux et ma mère me faisait des boucles, avec un ruban dans les cheveux. Un jour, on me les a coupés à cause des poux, et pour ma mère, ce fut un drame !
A Villeréal, un petit village où nous étions ensuite, j’étais dans un pensionnat de sœurs qui avaient été expulsées de Lorraine, parce qu’elles ne voulaient pas avoir la nationalité allemande. J’ai été baptisée, il fallait que je fasse comme les autres pour ne pas être remarquée. Mon frère, lui, avait été pris en charge par la Croix-Rouge Suisse. Normalement, il devait être envoyé aux Etats-Unis, mais avec le débarquement en Afrique du Nord, cela ne s’est pas fait. Ma mère que je voyais aux vacances travaillait dans deux châteaux qui étaient à 3-4 km, comme bonne à tout faire, puisque elle faisait très bien la cuisine et la pâtisserie.
Je suis restée un peu plus de deux ans dans ce couvent, à 40 km d’Agen. On y est retournées ma mère et moi après la guerre. A part l’église, je n’ai rien reconnu. Moi-même, j’en suis très étonnée. Les rares choses dont je me souviens sont comme des flashs, il n’y a pas de lien, pas de fil continu.
Puis j’ai été pensionnaire au Collège de Bergerac, et ma mère est partie pour rechercher mon frère. Ma grand-mère, qui était restée à Paris, a été internée à Drancy, puis à Rothschild, mais n’a pas été déportée. Elle était très pratiquante. Ma mère est revenue à Paris en 1945. Elle a entrepris des démarches pour récupérer l’appartement, il y a eu procès, et ensuite elle est venue me chercher et nous sommes, ma mère, mon frère et moi, restés quelques mois chez ma grand-mère jusqu’à ce que l’on puisse récupérer notre appartement.
Je suis allée plusieurs fois au Lutétia. A chaque déporté qu’elle rencontrait, ma mère montrait photos de son mari et demandait des nouvelles. Je ne sais pas à quel moment elle a perdu espoir et surtout à quel moment elle a su que mon père ne reviendrait plus. Je pense que pour moi, c’est en même temps qu’elle que je l’ai su.
Pour nous faire subsister, il a fallu que ma mère fasse différents petits travaux, comme s’occuper d’une vieille dame ou coudre des boutons sur des vêtements de cuir, entre autres
Elle était handicapée par le fait qu’elle n’avait pas de profession.
Ma mère a retrouvé trois frères et une sœur à la Libération ainsi que ma grand-mère, qui est morte en 1950.
A la Libération, j’avais 13 ans. Pendant environ trois ans, ma mère a vécu avec quelqu’un qui avait une fabrique d’horlogerie à Coeuilly où on est allés habiter. Ma mère s’y est résolue uniquement pour améliorer notre situation. Mon frère y a appris le métier d’horloger. J’allais au collège à Champigny. Puis ils se sont séparés et on est revenus à Paris.
Ensuite, je suis allée à l’école Pigier pour apprendre un peu de secrétariat, je ne pouvais pas faire d’études vu l’état de nos finances. Ma mère vivait d’expédients. Je me suis mariée et puis voilà.
En faisant ce témoignage, je veux qu’il reste une trace. J’ai remarqué que plus le temps passe, plus je repense à toute cette tragédie. Il y a trois ou quatre ans, je suis allée avec mon frère à Auschwitz. A Birkenau, malgré le temps écoulé, nous avons senti une odeur très spéciale, de crémation, et ce n’était pas un effet de notre imagination.
Aller à la commémoration de Beaune-la-Rolande est, pour moi, une obligation, il faut que j’y assiste. C’est la seule chose que je peux faire. Avant, j’y allais avec ma mère et mes filles ; à partir de 1988, ma mère n’était plus en état. Mes filles, Cécile et Cathie viennent toujours quand elles le peuvent et elles peuvent très souvent. Aujourd’hui, l’une de mes petites-filles s’y rend avec nous. Et bien sûr, mon frère et sa famille.
Témoignage recueilli en 2008
GIMPEL SAS
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 5 juin 1942 par le convoi n°2
Assassiné à Auschwitz le 25 juillet 1942 à l’âge de 38 ans
CÉCILE WAJSBROT
Petite-fille de Gimpel Sas
DENISE WAJSBROT
Fille de Gimpel Sas
Née en 1932
-

Tyla et Gimpel Sas en 1925 en Pologne. Archives familiales
-

Denise (née en 1932) et Léon (né en 1929) avec leurs parents Tyla et Gimpel Sas (sl, sd). Archives familiales
-

Gimpel Sas (au 1er rang à droite), engagé volontaire, à Septfonds en 1940. Archives familiales
-

Denise, Tyla et Léon Sas sont assis au 1er plan. Gimpel, leur père et mari, est debout juste derrière eux. Le 1er à gauche debout, appuyé sur une canne, est Majerowicz. Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Gimpel Sas est le 1er à gauche, à côté de Bydlowski. Majerowicz est le 3e en partant de la droite (25 novembre 1941). Inscription au verso : « A ma chère Paulette adorée / et à mes chers enfants / en souvenir du Camp. / de Beaune la Rolande / le 25/XI 1941 / signature illisible ». Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Gimpel Sas, à gauche, à côté de Majerowicz (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Inscription au recto : « M.S. 14.5.1941 ». Inscription au verso : « En souvenir / de Beaune la Rolande / Gimpel ». Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Gimpel Sas, au milieu, à côté de Majerowicz à gauche (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Inscription au verso : « En souvenir / de Beaune la Rolande / pour ma chère femme / et mes chères enfants / Gimpel ». Archives familiales
-

Léon et Denise Sas, avec leur grand-mère maternelle Chaya-Pessel Lubliner et leur mère Tyla, posant chez le photographe avec leur étoile jaune (juin 1942 ?, sd). Archives familiales