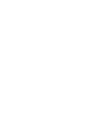Jakob BINDER
par sa fille Nicole Ball
Je ne sais pas trop comment parler, et si tard, de ce père que je n’ai pas connu, dont on m’a si peu dit, et sur lequel j’ai très peu demandé.
Grands-parents, parents, frère ou sœur, amis, tous ceux qui, là-bas à Piotrkow en Pologne, l’ont vu naître, grandir, devenir l’homme qu’il était à 27 ans, quand en septembre 1926, il est parti pour la France, tous ont disparu, dans les camps sans doute. Aucune trace d’eux, nulle part, personne qui ne se soit jamais manifesté. De sa vie en Pologne, je n’ai jamais rien su.
Jusqu’à la mort de ma mère en 2001, il y a eu deux photos, de plus en plus floues dans ma mémoire. L’une, sépia, représente mes parents, juste leurs visages un peu graves, en 1931, l’année de leur mariage à Paris. Lui, né en 1899, a 32 ans, 8 ans de plus qu’elle. Il est déjà assez chauve. Comme je n’ai plus cette photo, c’est tout ce que je peux dire de lui. Il y en avait une autre, très petite, en noir et blanc, prise à Merlimont-Plage, qui portait la date 1939, je crois. On le voit derrière ma mère et mon frère ; eux sont agenouillés dans le sable, il a l’air de faire froid ; il les entoure de ses bras, pour les protéger, du vent peut-être. Il semble grand et costaud. Mais cette petite photo, je ne l’ai pas non plus, alors j’invente peut-être. Ce que je sais aujourd’hui, c’est qu’il y avait là-bas un préventorium, “la Santé de l’Enfance”, et que mon frère, enfant délicat, y avait passé un mois.
Leur livret de famille dit que Jacob (il signe Jakob avec un K) habite 102 boulevard de Picpus, qu’il est riveteur (c’est-à-dire ouvrier dans une usine de pièces détachées destinées à fabriquer ces outils qui font les trous dans les tickets de métro), qu’il est le fils d’Abram Binder, commerçant (en grains, m’avait dit ma mère, mais je n’en suis plus sûre), et de Nisela Tenenbaum, mes grands-parents. Ma mère a 24 ans, fille de Szlama Dawid Goldberg et de Ciwia Rozencwajg. Elle aussi est de Piotrkow. Ils sont un peu cousins, paraît-il. Peut-être qu’ils se sont toujours connus. Ses parents à elle tenaient une sorte de “beerstube”, et mon grand-père était un peu usurier (prêteur ?) dans son officine de l’arrière-salle : “Oh ! C’était un homme avec une bonne tête ! Il avait une bonne tête pour les chiffres !”. Maman disait se souvenir des Allemands qui venaient boire de la bière dans leur établissement pendant la Première guerre. Elle, a fait des études secondaires dans un lycée juif de Piotrkow et elle parlait et écrivait le polonais. Lui ne semble pas avoir eu d’éducation ni de formation particulière, mais je ne sais pas. Elle a quitté ses parents et ses six frères et sœurs un an auparavant pour aller vivre chez une tante installée à Strasbourg. Elle était couturière. Elle l’a rejoint à Paris pour se marier, à la mairie du 12e, le 1er juin 1931. Ils vont d’abord habiter chez lui, puis dans un hôtel, rue Voltaire.
Mon frère Edouard est né un an plus tard en 1932. Ils vivent à présent tous les trois dans un hôtel de la rue du Pressoir dans le 20e, et plus tard, ils s’installeront 26 rue des Couronnes, à deux pas de là, dans un deux-pièces sur cour où je naîtrai en juillet 1941.
J’ai sous les yeux un document administratif : une reconstitution de la carrière de mon père entre 1928 et son arrestation le 14 juillet 1942. Ouvrier presseur chez des petits patrons, juifs eux aussi. Avant 1933, il est chez Klein, rue Wurtz dans le 13e. Puis, il y a des périodes creuses de plusieurs mois : la morte-saison ? Après, ça va mieux. A partir de mars 1933 jusqu’au 25 août 1939, il est régulièrement employé, d’abord chez Bynstok, rue de Reuilly, puis chez Spitalnik, rue des Quatre Fils.
Le 26 août, selon ce même document, il se rend à la caserne Mortier où il s’engage dans la légion étrangère. Le 26 août ? Mais on lit, sur un “certificat de position militaire” délivré en 1947 : “Engagé volontaire pour la durée de la guerre, le 8 mai 1940 au titre de la légion étrangère, arrivé au corps le 9 mai 1940, démobilisé à Caussade (Tarn-et-Garonne) le 9 septembre 1940”. Il aurait donc été dans l’armée pendant un an ? J’aurais eu un père militaire et ma mère ne m’en aurait rien dit ? (Ce ne sera d’ailleurs pas sa seule période militaire ; il y en aura une autre, si l’on en croit cette reconstitution de carrière : trois jours, du 14 au 17 juillet 1942. Ou c’est une erreur ou c’est comme soldat qu’il serait parti pour Auschwitz…).
Après cette année de “service militaire”, il retourne à son dernier emploi. Suivent quatre mois creux : la morte-saison encore (?). Nous sommes à l’automne 41. Je suis née à l’hôpital Rothschild trois mois plus tôt. Le 25 octobre, Jacob Binder, “de nationalité juive”, s’est présenté à la mairie du 20e pour déclarer “que de son mariage avec Chawa Goldberg était issue une enfant Nicole Binder, née le 25 juillet 1941 à Paris 12e, sur laquelle il exerce les droits de la puissance paternelle, et que voulant, bien qu’elle soit encore mineure, lui assurer la qualité de Française, il réclamait au nom de celle-ci, la nationalité française, en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 10 août 1927”. Il croyait vraiment qu’on ferait suite à sa demande ? Lui, “de religion juive” (c’est écrit sur le papier) ? Cette enfant ne deviendra française que le 10 juillet 1945. C’est la preuve, en tout cas, qu’il m’a connue, qu’il m’a prise dans ses bras, qu’il a voulu quelque chose pour moi...
En janvier 1942, il est embauché comme “bûcheron” par la “Délégation générale à l’équipement national”, un organisme de l’état, certainement, (militaire encore ?) dont le siège se trouve rue de Berri, dans le 8e, et dont je n’ai retrouvé la trace nulle part. Il est envoyé à Aunay-en-Bazois, un petit village de la Nièvre, pas loin de Clamecy. Il est logé au Château de la Baume, avec d’autres Juifs qui travaillent avec lui. Apparemment, il lui arrive de rentrer à Paris “en permission”. C’est de là que, pendant cette période, il écrit à ma mère. Il reste deux lettres de lui, l’une datée du 25 juin, l’autre du 12 juillet 1942, écrites en yiddish sur du papier d’écolier tout jauni, que j’ai toujours vues rangées dans le carton à chaussures, sur l’étagère supérieure de la grande armoire, à gauche. Des lettres qui sont restées mortes pour mon frère et moi puisque nous n’avons jamais cherché à savoir ce qu’il disait. Il y a un an seulement, j’ai finalement eu le courage de les ramener à Paris où quelqu’un, à la Maison de la Culture yiddish, m’a aidée à les déchiffrer. Il parle essentiellement, dans ces deux lettres, de ce qu’il a trouvé comme nourriture et comme choses à envoyer ou à rapporter à la maison lors de sa prochaine "permission”. Apparemment, quand il ne travaille pas, il bat la campagne en quête de choses à manger, d’objets à acheter (avec “sa paye militaire”, 465 frs par quinzaine : 300 frs pour séparation de famille, 85 frs d’allocations familiales, 85 frs de salaire unique ; moins 2 jours pour la dernière paye: ce qui est bien normal puisqu’il n’a pas travaillé les 16 et 17 juillet), ou à troquer ; il les détaille, avec les prix. J’ai été déçue. J’ai exprimé ma déception à la jeune femme qui déchiffrait pour moi. Cette obsession de la nourriture, m’a-t-elle dit, se comprenait ; c’était sa manière à lui de se soucier continuellement de nous, restés à Paris dans la pénurie.
C’est là, à Aunay-en-Bazois, qu’il a été arrêté, le 13 juillet, avec seize autres Juifs du chantier n° 206, “en vertu de la note de M. le Préfet de la Nièvre, en date du 12 juillet 1942”. Le lendemain de la lettre dans laquelle il se fâchait contre maman, parce qu’elle lui avait envoyé des cigarettes. Lui, il voulait juste des tickets. Il allait lui rapporter du sucre, du beurre, des flocons d’avoine, des petites chaussures qu’il avait fait réparer. Il se plaignait des commerçants et des paysans qui profitent. J’espère qu’il a pu au moins emmener au camp de Pithiviers ce qu’il comptait nous rapporter, se conformant ainsi aux directives du préfet : “Les Juifs devront se munir d’un ravitaillement pour 3 jours”. Le 14 juillet, il est entré au camp de Pithiviers, et le 16, il a pu écrire un mot (dans un très mauvais français) pour prévenir qu’il partait et qu’il avait laissé pour elle deux colis au Château La Baume avec dix-sept œufs, des chaussures et sa montre. Quand et comment Maman a-t-elle reçu ce mot ? Et les colis ? Je ne sais pas, je n’ai pas demandé…
Le convoi 6 est parti le lendemain à l’aube. La veille, au moment peut-être où il écrivait ce mot, des policiers sont venus frapper chez nous, rue des Couronnes. “Madame, vous avez un bébé, vous ne partez pas, restez chez vous”. Mon frère, qui avait presque 9 ans, devait bien s’en souvenir de ce 16 juillet-là, jour de la rafle du Vel d’Hiv. J’aurais aimé le lui demander, s’il s’en souvenait. A lui non plus, je n’ai rien osé demander. Le convoi 6 est parti pour Auschwitz le 17 juillet et mon père y est mort exactement un mois plus tard, le 17 août 1942. Cette date, je l’ai toujours sue puisqu’elle figure sur le livret de famille (Mais quand et comment l’a-t-on sue ?)
En somme, ce que j’aurai le mieux connu de mon père, ce sont les derniers mois de sa vie, et depuis 2006, grâce au CERCIL, les circonstances de son arrestation.
Mes parents ont-ils été heureux pendant leurs dix années de mariage ? J’ai demandé à ma mère une fois quel genre de personne c’était, son mari. Oh un sérieux ! Il se faisait du souci tout le temps… Il semble que son français ait été très limité alors qu’elle, elle suivait des cours le soir. Ça a dû l’agacer qu’il ne fasse pas d’effort pour l’apprendre. Qu’est-ce qu’il aimait faire quand il lui arrivait de penser à autre chose qu’à nous faire vivre ? Il y avait dans la boîte de l’armoire un appareil photo à soufflet ; il a été content de pouvoir l’acheter : cette petite photo d’eux trois prise à Merlimont-Plage, il aura demandé à quelqu’un sur la plage de la prendre, mais il y en a eu beaucoup d’autres, prises par lui, c’est sûr. Il aimait lire ? Et de quoi parlaient-ils entre eux, mes parents ? J’ai appris que beaucoup de Juifs s’étaient engagés au début de la guerre : je suis fière qu’il l’ait fait, lui aussi. Par sentiment d’un devoir envers la France ? Pour la solde ? Qu’en avait pensé ma mère ? Elle l’avait encouragé, poussé ? Et quel genre de père c’était pour mon frère Edouard ?
Nous sommes restés à Paris jusqu’en 1943. Puis, en 1944, mon frère et moi avons été placés (cachés ?) à la campagne, par l’OSE, dans différents endroits, toujours près de Paris.
Maman a quitté l’appartement de la rue des Couronnes. Elle a fait déménager son lit et sa grande armoire et est allée habiter chez une dame française qui habitait près de la porte des Lilas. Elle a confié le reste de l’appartement à une voisine qui ne s’est pas gênée pour se servir avant qu’on y mette les scellés, le reste de nos pauvres affaires ayant sans doute été expédié au dépôt d’Austerlitz. J’ai retrouvé, à sa mort, le brouillon d’une liste des choses “déménagées par les Allemands” qu’elle avait faite "sur l’honneur” en 1946, à son retour chez nous, pour obtenir un peu d’argent. Je suis tentée de la recopier, puisque ce sont les seules traces de la vie d’avant ; quelques meubles, quelques objets, quelques vêtements : des “vêtements d’homme : un complet, 1 gabardine – état neuf”. Maman a trouvé du travail chez un docteur, puis dans un pensionnat de jeunes filles. Elle a décousu son étoile, elle a échappé aux rafles, elle est restée en contact avec nous et elle est venue nous récupérer à Houdan à la libération. Dans ce carton à chaussures, avec ses deux étoiles jaunes, elle a toujours gardé quelques lettres écrites par mon frère entre janvier et mai 1944. Il avait 11 ans, moi, 2 ; un grand frère sérieux, responsable, d’une maturité impensable aujourd’hui. Il a été comme un père pour moi. Il est mort d’un cancer il y a cinq ans. Sans que nous ayons réussi à parler ensemble de cette époque de notre vie.
Après la guerre, mon frère a été pensionnaire dans une maison de l’OSE à Saint-Germain-en-Laye, et pendant un an, j’ai vécu avec maman dans une maison d’enfants où elle travaillait comme lingère. Puis ma mère a récupéré notre logement et nous sommes rentrées toutes les deux à Paris. C’est à partir de cette maison d’enfants et de ce retour, en septembre 1946, que je commence à me souvenir. Edouard est revenu et je suis allée à l’école maternelle. Ma mère s’est remise à faire des robes sur mesure pour des dames qui venaient à la maison. Il me semble avoir été heureuse, entre ma mère et mon frère, à cette époque-là, mais eux, je ne sais pas.
Un jour, pour Noël, j’ai eu la grande surprise de trouver un vélo devant la machine à coudre de maman. Un cadeau étonnant. Peu de temps après, un monsieur est venu vivre chez nous. Je n’ai pas du tout le souvenir d’avoir été préparée à cette présence, mais ça ne veut pas dire que ma mère ne m’ait rien dit. Un homme gentil, timide, et qui ne parlait que le yiddish. Si bien qu’entre ma timidité, la sienne, et l’absence de langue commune, on ne se parlait pas. Je sentais qu’il aurait fallu l’appeler “papa”, mais le mot n’a jamais pu sortir de moi. Très tôt, je me suis sentie coupable de ne pas pouvoir lui donner cette chose si simple, qui lui aurait fait tellement plaisir. Il m’était impossible de l’appeler par son nom non plus, si bien que je ne l’ai jamais appelé. Un Juif polonais rescapé des camps où il avait perdu toute sa famille, sa femme et ses deux petites filles. Il avait des photos qui sont venues rejoindre les nôtres dans la boîte et que j’ai souvent regardées ! Jamais je ne lui ai posé de questions. Je n’aurais pas su comment, c’était bien plus qu’une question de langue. La peur de ce qu’on lui avait fait, je crois, et qu’on ne pouvait pas mettre en mots. Mon frère est né en 1948. J’ai été très contente d’avoir ce petit frère. Ça m’a un peu décrispée.
Ma tante Esterka, la sœur de ma mère, louait une chambre à une vieille dame dans l’immeuble. Nous avons fait un échange d’appartement et nous nous sommes retrouvés tous les six côté rue. Ma tante était aussi une rescapée des camps. Elle portait un numéro tatoué sur son avant-bras, ce que n’avait pas mon beau-père. Elle aussi avait perdu un mari et deux enfants. Elle non plus ne parlait pas le français. J’ai partagé son lit jusqu’à son départ pour Israël en octobre 1950. D’elle aussi j’ai eu peur, pour les mêmes raisons. Sauf qu’avec elle, c’était plus facile, elle avait un nom.
Les camps, la déportation, nous avons grandi dedans. Sans en parler. Dehors, oui, on nous en a beaucoup parlé. Mes parents étaient des Juifs communistes, très actifs à l’U.J.R.E. (l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide). Nous avons fréquenté les colonies de la C.C.E. (Commission Centrale de l’Enfance) où on commémorait beaucoup. Mais notre propre histoire était tue.
Et Juif ? Qu’est-ce que c’était, qu’est-ce que c’est, être ”juif” ? Le mot, déjà, Juif, Juive. Jew, ici, en Amérique, où je vis depuis quarante ans. La sonorité du mot même. Je me souviens de cet incident, en classe de seconde, où après avoir récité « Le dormeur du Val », j’ai répondu à notre professeur de français qui m’avait demandé, avec bienveillance pourtant : ”Ces cheveux bouclés, ces yeux verts, vous êtes de quelle origine ?” Au lieu de répondre “je suis juive”, ce qui m’est sorti immédiatement de la bouche, c’est Polonaise, je suis polonaise. J’ai regagné ma place, les joues en feu. Moi qui ne me souviens de rien, je m’en souviens encore, avec honte.
Et cette affreuse gêne, en pleine rue. Il y avait rue du Faubourg du Temple, l’année de mes 13 ans, une femme qui, les yeux bandés, répondait aux questions que lui posait son partenaire sur des gens pris au hasard dans la foule agglomérée autour d’eux. C’est tombé sur moi : “Et cette jeune personne, quel sera le nom de son mari et sa profession ?” “Abraham. Il sera tailleur”. Même quand on avait les yeux bandés, on le voyait, que j’étais juive ! Ça m’a à la fois bouleversée et mortifiée. Je suis retournée m’agglutiner à l’attroupement quinze jours plus tard, pour vérifier. J’ai fait en sorte d’être repérée : même question, même réponse de la cartomancienne “Moïshè. Fourreur”.
J’ai en effet épousé un Juif. Américain. Et ni tailleur, ni fourreur. Pas par hasard sans doute. Lui, au début, me répétait sans cesse qu’il était juif, me citant des expressions en yiddish qu’il me traduisait. J’ai fini par lui dire que moi aussi, je l’étais, juive, et que je comprenais parfaitement le yiddish. Il est tombé des nues et n’a pas compris pourquoi je n’avais rien dit avant.
C’est vers la fin des années soixante-dix, avec la publication du Mémorial de Serge Klarsfeld qu’en parcourant toutes ces listes de noms, j’ai découvert dans celle du convoi 6 le nom Jacques Binder. Depuis, études, témoignages, films, fictions, je lis tout, je vois tout ce qui me tombe sous les yeux. Une obsession morbide, que l’éloignement a exacerbée. De cette fixation aussi, j’ai honte. “A Holocaust junkie”, dit mon mari. Pourtant, je ne peux plus répéter que seule la déportation m’a faite juive. L’histoire des Juifs de Pologne, Piotrkow, les shtetl, les Juifs de France... D’avoir replacé l’histoire de mes parents dans l’Histoire les a fait un peu sortir de leur condition de victimes. J’ai même tenté, il y a une dizaine d’années, d’apprendre le yiddish, avec l’idée que ça ferait plaisir à ma mère, mais avec aussi le chagrin de ne pas l’avoir fait quand Bernard, mon autre père, vivait encore. Il paraît que la troisième génération veut savoir, pose les questions qu’il faut. C’est certainement le cas de mon fils aîné. Il a pu parler un peu avec ses grands-parents ; il a appris le yiddish à l’université, il fait des films documentaires, “à thèmes juifs”. Et il a appelé son petit garçon, mon petit-fils, Jakob.
Le nom de Jakob Binder est maintenant gravé avec sa date et son lieu de naissance sur le Mur des noms du Mémorial à Paris. Bientôt, il figurera aussi sur une stèle qu’il est question d’élever à Pithiviers pour ceux du convoi 6. J’ai appris aussi très récemment que ma tante Esther était allée en 1956 remplir un formulaire pour lui à Yad Vashem. En somme, il est entré dans l’Histoire avant de réintégrer la mienne. Il était temps.
Chez nous, au hasard des alliances, les uns sont restés juifs, les autres ne le sont qu’à moitié, d’autres pas du tout. C’est à l’école ou à la télé qu’on parle encore un peu de nous, ce qui nous dispense d’en parler nous-mêmes. A nous non plus, enfants de déportés ou de survivants des camps, nés juste avant la guerre ou pendant ou juste après, on ne pose pas de questions, et que pourrions-nous dire à nos petits-enfants s’ils s’avisaient de savoir puisque justement nous savons si peu. Coupables de n’avoir pas cherché à savoir, nous voici aussi coupables d’oublier ce peu que nous savions.
(Merci au CERCIL et à tous ceux et celles qui ont témoigné. Merci à Monique Novodorsqui sans qui je n’aurais pas eu le courage de revenir fouiller mes vieux papiers)
Témoignage recueilli en 2009
JAKOB BINDER
Interné au camp de Pithiviers le 14 juillet 1942
Déporté à Auschwitz le 17 juillet 1942 par le convoi 6
Assassiné à Auschwitz le 17 août 1942 à l’âge de 43 ans
NICOLE BALL
Fille de Jakob Binder
Née le 25 juillet 1941 à Paris 12e
-

Extrait du livret de famille de Jacob Binder et Chava Goldberg. Archives familiales
-

Certificat de position militaire de Jacob (Jacques) Binder, délivré en janvier 1947. Archives familiales
-

Extrait du procès-verbal de gendarmerie rendant compte de l’arrestation de 47 Juifs, dont Jacob (Jacques) Binder, à Aunay-en-Bazois dans la Nièvre (13 juillet 1942) – page 1. Archives départementales de la Nièvre - 115 W 83
-

Extrait du procès-verbal de gendarmerie rendant compte de l’arrestation de 47 Juifs, dont Jacob (Jacques) Binder, à Aunay-en-Bazois dans la Nièvre (13 juillet 1942) – page 2. Archives départementales de la Nièvre - 115 W 83
-

Liste des Juifs arrêtés et transférés au camp de Pithiviers (sd, juillet 1942). Archives départementales de la Nièvre - 115 W 83
-

Lettre écrite du camp de Pithiviers par Jacob (Jacques) Binder, la veille de son départ en déportation, le 16 juillet 1942. Archives familiales