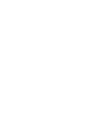Judel, Sarah et Cywja BOROWSKI
par Albert, leur fils et frère
Aussi loin que peuvent aller mes souvenirs, quand je creuse dans ma mémoire, c’est une petite pièce perchée au cinquième étage du n° 145 de la rue de Bourgogne à Orléans que je revois. C’est là que mes parents avaient abouti après avoir quitté leur Pologne natale. Ils n’étaient pas venus qu’avec leurs seules valises ; « Tsirkélé », belle et sage petite fille aux cheveux bouclés, ma sœur aînée avait déjà trois ans. C’est là aussi que « Soré » ma mère, bénie soit sa mémoire, me donna le jour, quelques années plus tard. Car en ce temps-là, on pouvait accoucher la femme d’un émigré juif polonais sinon chez elle, assistée d’une sage-femme et de l’aide de Dieu.
J’ai appris que tu étais née à « GRAYEVI », dans cette Pologne lointaine, au pays de « LIVATKS », au milieu d’une famille généreuse, cultivée. Où déjà à cette époque des années 1900, le foyer où tu as grandi baignait à la fois dans l’atmosphère des pratiques religieuses et du sionisme. Il me faut donc parler de toi, chère maman, puisque nous avons eu si peu l’occasion, le temps de parler et surtout de vivre ensemble comme cela se fait naturellement dans chaque famille. Ton père Hanschel KOCIAK, jeune rabbin de la YECHIVA de VOLODJIN qui étudia et vécu ces années sur les mêmes bancs que des BIALIK et autres grands écrivains et penseurs juifs de cette époque, vivait déjà ce grand élan de sionisme naissant. Non pas qu’ils aient abandonné la foi et les pratiques de nos ancêtres, mais il mettait l’accent sur le besoin des Juifs de retrouver la langue et la terre ancestrale. C’est dans ce foyer doublement juif que ta mère Malka GROSSMAN a eu son premier enfant, toi SORÉLÉ, l’aînée de la famille KOCIAK. Ainsi, ton enfance puis ton adolescence furent marquées par cet attachement, cet amour pour « ERETS ISRAEL » et pour sa langue que vous pratiquiez déjà avec tes autres frères et sœurs qui vinrent grossier et fortifier votre famille : Alter, Rah’mil, Menachem, Shoshana, Rachel.
Par ton frère Menachem, qui échappa aux massacres des hordes nazies envahissant la Pologne, j’appris que votre frère était, avant-guerre, le Directeur de la grande Ecole juive de « GRAYEVI » et que votre mère MALKA, oratrice célèbre pour ses discours où elle présentait déjà dans les années trente le retour au foyer juif « ERETS ISRAËL ». Sans doute, aurais-je dû le questionner davantage sur ta vie et celle de ta famille en Pologne. J’ai eu malgré tout la chance de correspondre un peu avec lui et de nous rencontrer chez lui en ISRAËL où il a été avocat. En fait, dans les traits de son visage, dans sa façon de parler, de se comporter, c’est toi que je cherchais, toi qui m’avais tant manqué !
J’en reviens à notre premier logis, 145 rue de Bourgogne à Orléans ; de cette époque, de cet endroit, seules quelques images me reviennent en mémoire, n’ayant vécu là que jusqu’à peine l’âge de quatre ans. En bas, dans la petite cour, mon attention avait été attirée par l’atelier d’un menuisier d’où émanaient des senteurs de bois fraîchement coupés et dans un coin un tas de chutes de bois qui s’entassaient là, formant une petite montagne. Déjà, dès mon plus jeune âge, l’envie de grimper sur un arbre, de monter sur un obstacle me dévorait. Un beau jour, la chance n’étant pas avec moi, de ce tas de bois, je dégringolais dans un hurlement de cris et ce fut ma première cheville foulée et ma première visite précipitée chez le médecin ! De ce premier logis où j’ai vécu avec les miens, très peu d’images me reviennent, j’étais si jeune ! Peut-être encore une grande bassine en bois foncé comme un demi tonneau, rempli d’eau qui me servait de baignoire.
A quelques mètres de cette maison débutait la rue Saint-Etienne qui allait devenir pendant plusieurs années le centre de ma vie avec mes parents, ma sœur et ma famille entre les années 1937 et 1942.
En effet, mon père avait trouvé en location un nouvel appartement bien plus grand au premier étage du n° 6 de la rue Saint-Etienne.
Rue Saint-Etienne, petite rue étroite, pavée, calme au milieu du vieux quartier d’Orléans. Pas de boutiques, pas de voitures, quelques rares passants. En cette belle journée de printemps 1938, assis sur le rebord du trottoir en compagnie de mes trois cousins Henri, François et Maurice, nous sommes là à nous amuser avec les quelques jouets de l’époque que nous avons : trois, quatre soldats de plomb, un petit canon, une vieille roue de poussette, un cerceau. Le début de la rue qui commence à l’intersection de la rue de Bourgogne est plus large et c’est là que nous passons le plus clair de la journée. C’est notre aire de jeux, notre terrain, notre parc…Très facile pour nous d’y venir puisque nos parents habitent justement là. Les miens au N° 6, ceux de mes cousins au N° 5. D’un simple coup d’œil, ils pouvaient nous surveiller. C’est là qu’ils sont venus demeurer après avoir tous quitté leur Pologne natale.
Au N° 5 habitent ma tante Léa, la sœur de mon père, son mari Aron et mes trois cousins et notre grand-mère, la mère de mon père et de ma tante. Au N° 6, mon père Youdel, ma mère Sarah, ma sœur Ciwia et moi-même.
Déjà à cette époque nos vies étaient mêlées dans une proximité très forte. Bien souvent, je montais chez mes cousins voir notre grand-mère commune et quelquefois j’y déjeunais. Nous avions le même âge. A l’époque, Henri 7 ans, François 4 ans et demi, moi Albert 4 ans, Maurice 3 ans.
Au N° 6 de cette rue au rez-de-chaussée, je revois la porte d’entrée de couleur vert foncé avec l‘inscription M. et Mme Judel BOROWSKI avec une sonnette à tirette en cuivre. L’immeuble donnait sur la rue et le premier étage était occupé par notre famille : nous quatre ; un couloir de plusieurs mètres menait à l’escalier. C’est par la porte de la cuisine que l’on entrait ; la pièce était spacieuse et une grande fenêtre donnait sur la rue. C’est principalement dans cette pièce que nous vivions, c’est là que je passais une bonne partie de la matinée avec ma mère qui préparait les repas, tandis que je tournais çà et là autour d’elle à lui poser toutes sortes de questions en yiddish, car c’était la langue que nous parlions à la maison.
Aussi loin que vont mes souvenirs, c’est cet appartement que je revois : De la grande pièce qui tenait lieu de cuisine on entrait dans la salle à manger aussi spacieuse, c’est là que nous étions les jours de fête. Dans l’encoignure, une machine à coudre à pédale type SINGER où mon père faisait les retouches ou les réparations des vêtements pour DAMES qu’il avait vendus dans les marchés environnants ; sur le rebord de marbre de la cheminée, deux grands chandeliers en argent amenés de Pologne que ma mère, bénie soit sa mémoire, allumait les veilles de « Chabess » et de fêtes. C’est là aussi que mes parents recevaient parfois quelques amis ou proches parents et parfois le vendredi soir revenant de la synagogue c’est mon père, bénie soit sa mémoire qui invitait quelques déshérités de passage à venir partager le repas de Chabbat. De là en ouvrant la porte, la grande chambre à coucher donnant également sur la rue. Près du grand lit de mes parents, le mien avec des tubes métalliques blancs retenant l’oreiller ; derrière un paravent décoré de fleurs multicolores, c’était le territoire de ma chère sœur Tsivké comme nous l’appelions. De grandes fenêtres donnaient sur la rue Saint-Etienne et à l’extrémité de la chambre, une autre fenêtre à un battant nous laissait voir la rue de Bourgogne, la longue et principale rue qui traversait la vieille Cité d’Orléans. Une image me revient parfois quand, par la pensée je me transporte dans cette pièce c’est celle de mon père Youdel enveloppé dans son Talit (châle de prières) ayant revêtu les Tefilines pour la prière matinale avant son départ pour le travail.
Le souvenir de cette maison que j’ai aimée et dont j’ai tant rêvée depuis tant d’années demeure encore maintenant très fort, car il me rattache aux miens qui me furent sauvagement arrachés ; en effet c’est là que j’ai passé les années les plus fortes, les plus denses, les plus chères du début de ma vie. Bien sûr à l’époque l’enfant turbulent, gâté que j’étais ne s’en rendait pas compte. Pendant ces quelques et trop courtes années où j’ai pu un peu partager la vie de mon père, de ma mère et de ma sœur, je m’y accroche désespérément et c’est pour moi encore comme si je creusais à la recherche d’un trésor qui m’a été volé.
A partir de 1941 le ciel s’assombrissait pour nous, rempli de nuages de haine, de crainte, de frayeur. Tout jeune que j’étais, je ressentais un climat d’incertitude, de danger. Je me souviens qu’un soir j’avais accompagné mon père à une réunion qui se tenait chez une parente, commerçante rue de Bourgogne, qui s’appelait « Bloumki », une tante de mon père. Il y avait là un certain nombre de personnes de la communauté qui s’étaient réunies pour discuter de la situation qui devenait précaire pour nous autres. La conversation se faisait en yiddish, en voix basse et je crois me rappeler que certains parlaient de partir et d’autres se demandaient où pouvaient-ils aller !
C’est ainsi que déjà à l’âge de 7 ans, le temps des jeux insouciants s’était envolé ! Ma tante, mon oncle, mes cousins avaient quitté Orléans et se trouvaient dans leur pavillon en Sologne à Ligny-le-Ribault. De temps en temps, ma sœur et moi-même nous nous y rendions et entretemps j’allais à l’école de la rue Serpente à ORLEANS au cours élémentaire. Ce dont je me souviens est une journée de mi-juin 1942, ma sœur Ciwia était venue me chercher à la sortie de la classe et avait signalé à mon maître Mr. LANGUMIER que je ne viendrai plus à l’école, compte tenu de la situation.
Les quelques jours qui suivirent, j’ai dû les passer avec mes parents à Orléans. Entretemps, ma sœur était partie à Ligny-le-Ribault rejoindre et aider notre tante Léa qui avait eu un quatrième enfant, la petite Eliane. Au bout d’une semaine ma sœur revint à Orléans chez nous ; puis à mon tour je m’apprêtais à rejoindre mes cousins à la campagne.
Nous étions probablement le 20 juin 1942 quand ma sœur m’accompagna au petit car qui faisait, une fois par semaine, le trajet entre Ligny-le-Ribault et Orléans et vice versa. C’était en fin d’après-midi et je ne sais pour quelle raison, je ressentais une certaine tension à la maison. Maman m’avait préparé une petite mallette avec quelques vêtements ; j’y avais ajouté un jouet et une balle en mousse à laquelle je tenais beaucoup. De son côté, papa était occupé à ranger de la marchandise et probablement pour me faire remarquer, je courais dans la maison en faisant des singeries autour de mon père. L’heure du départ approchant, j’embrassai maman tout en évitant papa, contrarié que j’étais des reproches qu’il m’avait faits à la suite de mes stupides singeries. Quelle importance cela pouvait avoir, pensais-je, puisque j’allais le revoir dans quelques jours !
Ainsi, nous descendions les escaliers, nous retrouvant dans la rue sur l’étroit trottoir de droite qui menait jusqu’à la cathédrale. De la fenêtre, nos parents nous virent partir. Ma sœur Ciwia portait ma mallette et marchant à mes côtés après une vingtaine de mètres, j’ai soudain senti une forte odeur de gaz, comme si une fuite s’était produite d’une canalisation dans la rue. Je crois lui avoir serré la main, étonnée que j’étais qu’elle ne sente pas cette forte odeur. Etait-ce la réalité ou bien un produit de mon imagination, tel un triste pressentiment de leur fin tragique dans les chambres à gaz d’Auschwitz !
Ainsi nous avons continué notre chemin et après avoir contourné la cathédrale, nous parvenions à la petite place où stationnait le véhicule du cafetier M. PAJON de Ligny qui faisait office d’autocar. C’est ainsi que nous nous sommes quittés par cette chaude après-midi. Nous nous sommes embrassés, avons échangé quelques mots, sans savoir ni l’un ni l’autre que nous nous parlions, nous voyions, nous embrassions pour la dernière fois dans ce monde !
C’est ainsi que chaque évènement de cette époque en relation avec ma famille, mes proches est quelque chose d’important, d’essentiel pour moi. Tous ces évènements qui se sont passés au cours de mon enfance, avant et pendant la guerre, qu’ils soient heureux ou douloureux, je les garde en moi comme un bien précieux. Ils me permettent dans une certaine mesure d’approcher de mes racines ; mon père, ma mère n’ont pas eu le temps, l’occasion de me parler, de me raconter leur vie, leur vécu, leur jeunesse en Pologne ni de leurs propres parents que je n’ai pas connus, si ce n’est ma grand-mère paternelle dont je garde un souvenir ému tant elle nous choyait, mes cousins et moi-même.
Que de fois n’ai-je pas ressenti ce sentiment d’injustice, de révolte d’avoir dès mon jeune âge, été privé de la présence, de l’amour, de l’affection, des conseils de mon père, de ma mère, de ma sœur ; de ma chère sœur « Tsiwké », mon aînée de huit ans, il me faut aussi parler !
Tu avais juste seize ans quand avec nos parents tu es tombée dans les griffes des bourreaux nazis et de leur complice, la milice française. Tous ceux qui t’ont connue ou côtoyée parlaient de ta gentillesse, ta délicatesse, ta sensibilité, ton intelligence ! Je me souviens comme tu veillais sur moi, le turbulent, l’étourdi, bref le petit diable que j’étais alors.
Un jour, te souviens-tu, nos parents partirent pour la journée et ayant eu la fâcheuse idée de sauter et rebondir sur le lit de nos parents, je t’avais entraîné à ce jeu plutôt risqué : en effet, après avoir rebondi, tu t’étais fait mal à l’œil et je me souviens avoir alors ressenti une frayeur épouvantable, me sentant responsable ! Il est vrai que je n’avais que six ans et toi à peine quatorze ; j’ai retrouvé un livre de lecture en Hébreu avec des dessins impressionnants représentants différents épisodes de l’histoire biblique ; ce livre t’avait été offert par le grand Rabbin Sommer de TOURS, dédicacé avec les félicitations pour ton travail excellent comme premier prix à l’examen d’Hébreu. Je te revois un soir, assise à la grande table en train de feuilleter et lire ce livre dont les images et les lettres hébraïques m’impressionnaient fortement.
Je m’adresse à toi en quelques mots pour dire à quel point ton absence et celle de nos parents m’a été douloureuse et insupportable : voilà, j’ai aujourd’hui presque quatre-vingts ans et je peux dire qu’il ne s’est pas passé un jour sans une pensée, une image de vous trois ! Je te revois en train de tourner la manivelle de ton « phono » et d’couter tes disques préférés. Comme tu dessinais bien !
J’ai ici quelques objets nous ayant appartenu. Je ne sais pas qui les a retrouvés : les deux chandeliers argentés de maman, la petite mallette avec les pièces en argent que papa et toi-même enrouliez le soir assis à la grande table ; je garde ta petite montre en or et ta petite boîte de gomina qui embaume toujours la violette ; il faut ajouter l’album de photos de notre famille et les cartes postales que tu collectionnais et que tu recevais de tes amies. Dans cet album, il y avait aussi une lettre reçue de notre famille de GRAYEVO en Pologne, petite ville où tu es née. Cette lettre écrite par notre tante Rachel t’était adressée, écrite dans un français parfait ; il y avait également du courrier de notre grand-père Hanschel, le père de maman, les dernières cartes datées de mai 1942 avec des timbres d’Hitler, la Pologne étant occupée comme la plus grande partie de l’Europe, par les nazis. La fameuse lettre que tu as écrite à notre oncle d’Amérique sous la dictée de notre père, d’une écriture et d’un français parfaits, m’a été restituée par leur petite-fille Yvonne, qui l’a remise à mon fils Youdel, ainsi appelé en souvenir de papa. Je garde précieusement le diplôme de certificat d’études avec mention BIEN que tu as eu avant 14 ans ; je note qu’à cette époque, nous parlions à peine le français à la maison !
Maintenant, je vais te raconter un peu quelle fût mon existence après que nous nous soyons quittés. Dans ma tête d’enfant, je n’étais pas mécontent de retrouver mes cousins, pensant aussi que tu allais bientôt me rejoindre. Deux, trois jours après mon arrivée, j’attrapais la rougeole que mes cousins venaient d’avoir. J’étais couché au premier étage dans la chambre avec une très forte fièvre et je commençais à délirer. Ce soir-là, l’oncle Aron venait d’arriver d’ORLEANS et j’entendis Henri qui, répétant les paroles de son père, se mit à crier : « les parents d’Albert se sont faits arrêter par les Allemands ». Une massue s’est abattue sur ma tête, le monde venait de s’écrouler pour moi ! Ma tante Léa me soigna avec beaucoup de dévouement et après quelques jours, la maladie s’en était allée.
Bien plus tard, l’oncle Aron raconta ce qui s’était passé. C’était le 24 juin 1942 vers 4h 1/2 de l’après-midi, il était venu rendre visite à nos parents. Toi aussi, hélas, tu étais là et si je parle de cet après-midi maudite, c’est pour que les autres sachent ! L’oncle Aron raconta : La sonnette de la porte retentit. Papa s’approcha de la fenêtre, tirant légèrement le rideau. La Police avec la Gestapo étaient en bas dans la rue. Aron dit alors : « je m’en vais au grenier ». Toi petite sœur, n’as-tu pas dit : « Je m’en vais aussi ? » Papa, pensant probablement à un contrôle t’a dit : « Reste, peut-être j’aurai besoin de toi », sachant que tu parlais et écrivais parfaitement le français. C’est bien cela, n’est-ce pas, je le crois.
Papa t’aimait tant, il était à juste titre si fier de toi. Tu le connaissais aussi bien, même sûrement mieux que moi. Il était si bon, si généreux, tout naïf qu’il devait être aussi ! Je ne me trompe pas, n’est-ce pas ? Je me suis souvent posé la question terrible : qu’aurais-je fait à sa place ? J’imagine sa souffrance quand après, il a compris ce qui se passait réellement !
Votre arrestation, plutôt votre rapt, je le revis douloureusement chaque 24 juin. Les souffrances physiques et morales que vous avez endurées après votre rapt, je les ressens, ces images se bousculent dans ma tête, je revis votre calvaire ! Mais dans ma tête et depuis bien des années, la révolte et le sentiment d’injustice sont si forts, alors j’imagine un « scénario » différent. Je suis avec vous tous, ce jour-là. La sonnette de la porte en bas retentit. J’ai comme un pressentiment : je crie à mon père de ne pas toucher au rideau de la fenêtre à travers lequel nous voyons la milice en bas de la rue. Nous quittons tous la pièce ; en face dans le couloir, il y a heureusement la réserve où notre père entrepose la marchandise. Nous vous enfermons là ; la sonnette a beau retentir à nouveau, nous ne bougeons pas ; quelques minutes s’écoulent… Par l’escalier proche, on entend de violents coups de bottes contre la porte extérieure au rez-de-chaussée et enfin les deux voitures démarrent en trombe à la recherche d’autres proies !
Comme j’ai pu le constater, j’ai eu au cours de ma vie des prémonitions et je me dis souvent en moi-même « pourquoi n’étais-je pas avec vous ce maudit 24-6-42 ? Cette histoire imaginaire avec son dénouement heureux, que de fois ne l’ai-je vécu dans mes pensées et mes rêves, mais hélas, elle ne s’est pas réalisée !
Maintenant que me voilà bien engagé dans « l’automne de ma vie », je peux t’appeler : Tsivkélé, comme nous t’appelions autrefois, petite sœur. Et je reprends le récit interrompu. Notre tante Léa nous raconta plus tard qu’elle essaya de faire intervenir une personne qui avait des connaissances dans le milieu « collabo » d’Orléans, mais que la tentative échoua du fait que les personnes à sauver étaient des Juifs !
Dès lors, la décision de s’enfuir de Ligny fut prise, malgré les dangers que nous aurions à affronter : allions-nous échapper aux monstres qui nous pourchassaient ? Nous étions fin juin 1942 et je me souviens de cette nuit-là. Nous nous étions endormis tristes et fatigués. Vers minuit, Henri l’aîné de mes cousins vint nous réveiller. Nous nous habillâmes à la hâte, sans bruit. Il ne fallait surtout pas se faire repérer ; les quelques bagages dans la vieille camionnette Citroën B2. Henri, François, Maurice et moi-même à l’arrière. Au volant, l’oncle Aron et à ses côtés, la tante Léa qui portait la petite Eliane âgée tout juste d’un an. Tous feux éteints, la camionnette démarra, quittant le « chemin de la Fontaine », traversant le bourg aussi vite que possible pour rejoindre la route de Saint-Cyr-en-Val. La bâche arrière de la voiture avait été descendue, si bien que nous étions dans l’obscurité. J’ai encore en mémoire, j’ai encore dans l’oreille le bruit ronronnant, régulier, rassurant de cette vieille guimbarde qui nous menait je ne sais où, mais dans des lieux que nous pensions plus sûrs. Assis les uns contre les autres, nous demeurions en silence, ballotés de ci de là sur ces petites routes quelques peu déformées, qui traversaient les bois obscurs de Sologne.
Au bout d’un certain temps, nous arrivâmes dans une ferme et nous pûmes nous étendre sur des lits pour passer le reste de la nuit.
Le lendemain matin, à la grande table de ces braves fermiers, nous partagions leur déjeuner : une bonne assiette de soupe avec des tranches de gros pain. Je crois bien que nous sommes restés là une semaine environ, le temps pour mon oncle et ma tante de prendre contact avec ceux qui pourraient nous aider à fuir.
Je me souviens m’être senti un peu apaisé dans cette grande ferme entourée de champs, de prairies et de petits bosquets. Mes cousins et moi-même restions à l’écart des employés de la ferme pour éviter qu’ils nous questionnent et souvent nous allions marcher dans les prairies à l’entour et sur les chemins qui longeaient les bois environnants. Pourtant, parfois une angoisse me saisissait en pensant à mes parents et à ma sœur dont l’absence me pesait si lourdement.
Mon oncle et ma tante décidèrent qu’il valait mieux se séparer en deux groupes pour franchir la ligne de démarcation. Léa, Henri et la petite Eliane partirent ensemble et le lendemain ce fût notre tour. Un matin, une dame au volant d’une petite Simca 5 vint nous prendre. L’oncle Aron à l’avant et nous, les trois gosses, François, Maurice et moi-même, entassés avec la valise à l’arrière ; le vélo de l’oncle accroché sur le pare choc arrière. Par de petites routes secondaires, nous avons roulé ainsi et quelques kilomètres avant VIERZON, nous nous sommes arrêtés et l’oncle Aron ayant décroché son vélo bleu, nous installa tous les trois dessus ainsi que la valise. Nous continuâmes notre chemin jusqu’à Vierzon. Nous roulions avec la plus grande prudence. Il ne fallait surtout pas attirer par trop l’attention dans cette ville où la Gestapo et la Milice étaient en grand nombre, du fait qu’après commençait la « Zone Libre ». Au coin d’une rue, nous entrâmes dans un café-buvette. Aron commanda trois « DIABOLO », signalant qu’il allait faire une course et qu’il viendrait bientôt nous chercher. Nous savions vaguement qu’il allait contacter un « passeur ». Près d’une heure s’étant passée et ne le voyant pas revenir, j’étais assez préoccupé ; les minutes devenaient longues. Nous regardions souvent l’horloge. L’heure de midi avait déjà sonné et l’inquiétude montait en moi, craignant d’être remarqué par certains consommateurs auxquels nous aurions pu paraître suspects. En fait, nous n’avions aucune pièce d’identité et en cas de contrôle, que pouvions-nous dire ou faire, nous autres, trois enfants de sept à huit ans ? J’en parlai à François et je lui suggérai de sortir sur le pas de la porte du café pour voir s’il apercevait son père ; il ne venait toujours pas, l’inquiétude montait en nous et chacun à notre tour, allions vers la porte. Sortant à mon tour, je vis au loin dans la rue la silhouette de l’oncle Aron. Je fais des signes de la main, mais sans réponse de sa part, je demandais à François de l’appeler, ce qu’il fit aussitôt et au cri de « PAPA », il vint nous quérir ici. Nous nous précipitâmes vers lui. Quel ne fut pas notre soulagement et le sien aussi. Il avait longtemps tourné dans le quartier et n’arrivait plus à situer le café où il nous avait laissé. Puis nous avons quitté le centre de la ville pour arriver dans une zone moins habitée, puis ce furent des champs et des prés ; chemin faisant, je ramassai une pomme au pied d’un arbre mais elle était si aigre que je ne pu la manger. Un peu plus loin derrière un arbre se trouvait une espèce de grange où nous nous arrêtâmes : le passeur attendait là ; d’autres personnes s’étaient jointes à nous : quatre prisonniers évadés d’Allemagne : deux Polonais, un Algérien et un Sénégalais. Après une rapide discussion, notre groupe se mit en route en direction d’un bois au bas duquel coulait le Cher, la rivière qu’il fallait franchir. Au-delà, c’était la Zone Libre que tant de malheureux pourchassés juifs, d’évadés d’Allemagne cherchaient à atteindre ! Arrivés à proximité du petit bois, le passeur nous fit signe de nous séparer, de marcher en silence les uns derrière les autres, d’avancer d’arbre en arbre. Nous avancions ainsi par à-coups, dès qu’il nous faisait signe de la main. Après quelques minutes de cette marche saccadée, la rivière était en vue. Nous attendîmes un moment, chacun derrière son arbre. La faim commençait à me tirailler l’estomac, l’inquiétude aussi. Puis, le passeur vint vers nous rapidement nous donnant ses consignes : à son signal, il faudrait s’élancer vers la rivière le plus vite possible. Il me revient en mémoire les paroles de l’oncle Aron qui s’adressant aux autres personnes leur dit : « même si la patrouille nous surprend, ne vous laissez pas attraper, battez-vous, jetez-vous sur eux, il y aurait des survivants parmi nous ! »
Les autres évadés qui étaient de jeunes hommes dans la force de l’âge acquiescèrent et en particulier le Sénégalais, joignant le geste à la parole, sorti de sous son vêtement un énorme couteau, le porta à hauteur de son cou en prononçant avec son accent si particulier « Couper Cabêche, couper Cabêche ». Entretemps, il fut rapidement décidé comment, nous autres enfants allions traverser le Cher. Les deux Polonais allaient prendre sur leurs dos mes deux cousins et moi j’allais passer sur le dos de l’Algérien. On l’appela « Arrache l’herbe ». En quelques mots, il nous avait dit sa souffrance, sa faim depuis qu’il s’était évadé d’Allemagne et que pour survivre, il arrachait de l’herbe ! Puis ce fut le silence, chacun d’entre nous se taisait comme pour se recueillir à l’approche d’un évènement aussi important et vital. Nous tendions l’oreille à l’écoute des bruits ; la forêt était silencieuse, seul le bruissement des feuilles et des branchages au-dessus de nos têtes et en contrebas le clapotis de l’eau de la rivière. Le passeur s’avançant un peu tout en scrutant les alentours nous dit à mi-voix : « Allez-y ». On se précipite alors sur la berge de la rivière ; il y a une dénivellation d’environ deux mètres, nous sautons au bord de l’eau. Par bonheur, il y a des roseaux et des plantes bien feuillues ; nous voilà tous accroupis à terre. Nous commençons à nous relever pour la traversée. Soudain le passeur s’écrie : « Arrêtez ! » Ayant couché sa tête, l’oreille collée par terre, il vient d’entendre un bruit de pas. Au fur et à mesure, les pas deviennent plus distincts. Pendant ce temps, nous demeurons accroupis, silencieux, retenant notre souffle, chacun dans ses pensées. Nous sommes tous les uns contre les autres et alors de mon cœur et par ma bouche me reviennent en silence les paroles sacrées de notre Foi, de notre tradition : CHEMA ISRAEL ADONAÏ ELOENOU ADONAÏ ECH’OD « Borouh’ Chem Kevod Malh’ousso Leolam Voed ! ».
« ECOUTE ISRAËL, L’ETERNEL NOTRE DIEU, L’ETERNEL EST UN » Béni soit à jamais le Nom de Son règne de gloire !
A quelques mètres au-dessus de nous, la patrouille allemande s’approche ; le bruit de leurs bottes qui s’abattent sur le chemin de terre qui longe et surplombe la rivière grandit, emplissant nos oreilles, ils sont maintenant à notre hauteur, la terre, les cailloux crépitent sous leur marche cadencée tandis qu’un aboiement de chien nous fait tressaillir ! L’instant est décisif ; de quel côté penchera la balance, la chance ou la providence sera-t-elle avec nous ?
Le bruit de leurs pas s’atténue peu à peu, puis plus rien ; à nouveau le silence ; quelques instants plus tard, les hommes s’élancent dans l’eau. Tout à droite, l’oncle Aron avec son vélo lutte contre le courant, nous autres accrochés au cou et sur le dos de nos porteurs, l’eau leur arrivant au-dessus de la ceinture... Bientôt la rive opposée est atteinte. Nous grimpons sur la berge. Des cris de joie et de soulagement fusent çà et là. Les hommes se donnent l’accolade, se congratulent, quelques paroles de remerciements et d’adieu. Un dernier signe vers le passeur qui disparait sur l’autre berge.
Chacun va son chemin, tenter sa chance et se fondre dans le bois de la liberté ! Il fait encore jour en cette soirée d’été 1942. Nous marchons encore un peu dans le bois, traversons des prés ; un peu plus loin, une petite ferme attire notre attention. Nos n’en pouvons plus de marcher, nos pieds mouillés sont douloureux, la faim nous tenaille aussi ! Bientôt nous parvenons à cette petite ferme. Après quelques paroles échangées, le paysan nous offre l’hospitalité et sur un lit-cage, nous nous étendons, harassés de fatigue, tout en avalant quelques tranches de pain. Cette nuit-là, nous nous endormons d’un profond sommeil. Comme elle fût longue cette journée depuis le petit matin où nous avons quitté la grande ferme près de Saint-Cyr-en-Val en Sologne ! Aux griffes de la Gestapo, de la Milice, des gendarmes et policiers, nous avons échappé et ce soir c’est la Liberté Retrouvée. Toute fragile qu’elle soit, nous l’apprécions, mais pour combien de temps encore ! Tant d’obstacles sur notre route, tant de dangers autour de nous ; un simple contretemps, la moindre erreur et nous tombions dans la gueule d’AMALEC ! Quelle rude et grande journée ; cette fois-ci, la Providence Divine nous a soutenus assurément !
Le lendemain matin, de bonne heure, nous quittons la ferme ; nous sommes à la mi-juillet et par ce beau matin d’été, nous voilà tous les quatre installés sur ce fameux beau vélo bleu, qui nous permet d’aller plus loin vers le sud en direction de CHATEAUROUX. L’oncle Aron, qui est véritablement une « force de la nature », pédale inlassablement ; toute la matinée, nous avons roulé, traversant la campagne berrichonne où alternent les champs de blés mûrs et de nombreuses prairies parsemées de bosquets. Nous faisons quelques haltes dans les chemins de traverse à l’écart de la grande route (N 20). Il fait chaud en ce mois de juillet mais il faut faire vite et arriver avant la nuit à CHATEAUROUX, où nous faisons halte, je crois, chez une connaissance de l’oncle Aron. C’est chez ce brave homme, habile et courageux que la carte d’identité de mon oncle a été transformée. Il s’appelle désormais ARONALT ARNAULT. Le lendemain, nouveau départ en vélo et nous parvenons enfin à VELLES, petit village du Berri, chez Mr. Léon Levensonas, dit « le petit Léon » en raison de sa petite taille, mais au grand cœur ! C’est dans cette famille que nous allons demeurer quelques semaines. Il y a là Mr. Léon, sa femme Guita, leur fille Betty et la tante Hanna. Nous prenons notre premier bain et un petit repas avant de retrouver un véritable lit. La maison est entourée d’un petit jardin et se trouve au bord d’un chemin en retrait de la rue principale du village. Curieux et insouciants que nous sommes, mes cousins et moi-même allons faire un tour dans le bourg qui ne compte que quelques centaines d’habitants. Nous ne sommes retournés que très rarement au bourg pour ne pas attirer l’attention des villageois, comme Mr. LEON nous l’avait recommandé, très prudent qu’il était : aux personnes qui nous questionneraient, il était convenu de répondre que nous étions ses neveux venus passer les vacances d’été. Nous avons passé là quelques jours plus tranquilles et nous nous contentions du peu que nous avions. Par contre, Betty, fille unique, était très choyée par sa famille et était quelque peu capricieuse du haut de ses huit ans ! Malgré tout, nous jouions ensemble. Il me revient en mémoire, une fin d’après-midi où nous nous étions assis sur l’herbe ; l’oncle Aron s’était absenté et le voilà qui revient de je ne sais où, triste, désemparé et s’adressant à Monsieur LEON, la voix entrecoupée par l’émotion : « Léa s’est fait arrêter avec les enfants (Henri 11 ans et Eliane un an) en traversant la ligne de démarcation ! Maurice, le plus jeune de mes cousins, s’est mis à pleurer et à moi aussi les larmes me viennent aux yeux, François, légèrement à l’écart est là tout blême, sans un mot, comme pétrifié ! Je me souviens encore de paroles encourageantes de Mr. Léon : « Léa parle bien le français et trouvera le moyen de s’en sortir ! » tandis que l’oncle Aron avait du mal à cacher son désespoir !
Fin août, début septembre, nous quittons la famille de Mr. Léon et, de VELLES, nous remontons vers la grande route RN 20 où se situe un minuscule village, un hameau, LOTHIERS, au croisement de deux autres routes départementales. C’est là que nous allons passer deux années des plus mouvementées de notre vie, entre la peur, l’espoir, le doute mais aussi avec cette rage de vivre, de survivre ! En ce mois de septembre 1942, la petite famille de l’oncle Aron et la tante Léa s’est à nouveau, Dieu merci, retrouvée, reformée. Ma tante Léa, Henri et la petite Eliane, sortis miraculeusement des griffes de la Gestapo, nous ont rejoints.
Nous voilà maintenant réunis à Lothiers dans une petite maison qui ne comprend que trois petites pièces au bord de la Route qui mène à Saint-Gaultier. L’été s’achève doucement et c’est la rentrée. Nous avons été inscrits à l’école du village, distante d’une centaine de mètres du logis que nous occupons maintenant. Je m’appelle Jean Arnault. La maîtresse sait qui nous sommes en réalité et nous accueille dans notre nouvelle école. Une fois le portail franchi on pénètre dans la cour, cinq ou six arbres feuillus se dressent là. Une bonne odeur de fleurs de tilleul embaume l’air. Faisons quelques pas et l’on accède à l’unique classe : la première rangée à gauche est réservée aux petits, la seconde aux enfants du cours élémentaire, la troisième au cours moyen et la plus à droite aux élèves qui préparent le Certificat d’Etudes. Nous sommes un peu plus d’une vingtaine d’élèves dirigés par une seule maîtresse qui s’occupe des uns et des autres à tour de rôle. Finalement, les choses ne se passent pas trop mal car nous avons le temps de faire des pauses quand la maîtresse, Madame BARBIER, change de rangée. Quelques noms d’enfants qui me reviennent en mémoire : les frères LALOEUF, Michel et Jean et leur petite sœur, Claude Barbier, la fille de la maîtresse, son frère, Thérèse Romanello, la fille de fermiers italiens, Yvette Villate, la fille de l’épicière... Quelques autres dont j’ai oublié le nom et en particulier un garçon de mon âge, quelque peu malingre qui habitait un lieu-dit « BELAIR » ; il racontait que pour reprendre des forces, le médecin lui avait recommandé de manger chaque matin deux œufs et du jambon. Ses parents qui étaient fermiers pouvaient le lui donner. En l’entendant ainsi parler, il avait réveillé en moi l’envie de manger des œufs frais.
Maintenant que nous fréquentions cette école, nous partagions la vie quotidienne des enfants de ce village : les jeux, les promenades, les disputes, le ramassage de bois mort, des marrons à l’automne : telles étaient les directives du gouvernement de l’époque. Toutes les richesses du pays prenaient la direction de l’Allemagne ou des collaborateurs, tandis que le peuple devait se contenter des restes !
Les tas de marrons que nous ramassions servaient à fabriquer un carburant pour les Allemands ! A la maison, bien des aliments essentiels manquaient : beurre, fromage, lait, œufs, viande, pain ; tout était rationné, il fallait des tickets d’alimentation. Nous vivotions malgré tout.
L’oncle Aron allait parfois dans des fermes à l’entour et en échange de son travail, ramenait un peu de nourriture. Pour nous, les enfants, à l’âge que nous avions, l’envie de jouer, de se distraire, d’apprendre, de découvrir des choses nouvelles était plus forte que la crainte, l’angoisse que pouvaient ressentir les adultes qui eux étaient tout à fait conscients des risques, des dangers que nous courrions !
Un matin, alors que nous étions à l’école, des gendarmes français s’étaient présentés à la maison pour vérification d’identité. Ma tante qui heureusement avait beaucoup de sang-froid parvint, je ne sais comment, à leur donner des réponses suffisantes. Heureusement, elle parlait bien le français sans accent ; son mari l’ayant soi-disant abandonnée, elle était venue se réfugier ici ! Peut-être y eut-il dénonciation ? La plupart des habitants du hameau étaient de braves gens, mais parfois il suffit d’une seule brebis galeuse comme dit le dicton ! Je me souviens que l‘oncle Aron s’éclipsa quelques jours dans les environs, peut-être bien à VELLES ?
Remercions la Providence qui nous mena dans ce petit hameau ! Le seul établissement public était cette petite école communale. Pas de Mairie, pas de gendarmerie, pas d’église. Puis vint l’hiver 1942, époque difficile ; le froid rigoureux, le manque de nourriture et de vêtements appropriés. Il y eut parfois des alertes. Mais pour nous les enfants, on se réchauffait en courant, sautant, glissant sur une petite mare qui avait gelé. Comme nos petits camarades, nous partagions leurs jeux étranges, leurs discours extravagants dans la même insouciance, tout en sachant que pour nous, petits Juifs, il y avait des limites à ne pas franchir, car il fallait malgré tout demeurer toujours sur nos gardes !
A quelques mètres de la petite maison que nous occupions se trouvait une petite grange au toit de chaume, où l’on entreposait des bûches et des fagots de bois pour le chauffage du poêle à bois et de la cuisinière. C’était en général l’oncle ARON qui sciait et coupait le bois. Parfois, après la classe, nous étions de corvée pour scier quelques bûches. Un dimanche matin, me sentant assez en forme, je pris une petite bûche que j’installais sur le billot de bois. La serpe dans la main droite, j’assenais un bon coup sur la bûche que je retenais de la main gauche. Pour imiter les gens du pays, je poussai un juron et c’est le majeur de ma main gauche qui en prit un bon coup, au point de le couper profondément. Ce fut ma première et dernière douloureuse expérience de bûcheron, pour longtemps !
Une autre scène me revient en mémoire qui me fait penser maintenant à un cours de sciences naturelles. Ce matin-là, la maîtresse nous mena dans un pré, juste derrière l’école pour une cueillette de champignons : les « rosées » appelés ainsi car on les cueille le matin assez tôt quand la rosée recouvre de ses gouttelettes l’herbe humide des champs, quand flotte au-dessus des prairies comme des voiles de brume blanchâtre ; ainsi nous avancions, courbés comme des roseaux, notre panier d’osier au bras, à la recherche des précieux comestibles. Je garde de cette sortie un souvenir très fort car grâce à cette institutrice dévouée, j’ai alors commencé à découvrir et à aimer un monde jusqu’alors peu connu de moi !
Au cours de l’année 1943, nous avons transporté nos pénates de l’autre côté du carrefour dans une habitation plus grande avec un jardin à l’arrière et un grand espace de verdure devant ; deux grands marronniers se dressent là avec leur ombrage bienfaisant l’été et leurs beaux marrons qui tombent en automne. Nous avons là un grand espace de jeux et nous en profitons pour faire des constructions avec des briques que nous allons chaparder dans un taudis inhabité et tout proche. Jouxtant la maison, deux à trois stères de bois ont été entassés là en provision avant l’hiver et avec quelques bûches et branchages ; deux de mes cousins et moi construisons une baraque. Soudain une voiture Traction Avant Citroën s’arrête non loin de nous ; deux hommes, révolver en main, se précipitent vers des poteaux indicateurs de direction et les inversent ; ils marchent vite, à leur bras, un brassard avec l’inscription F.F.I. L’un d’eux s’écrie : « N’y a-t-il pas des patriotes par ici ! » De chaque côté du carrefour, les poteaux dernièrement installés par les Allemands et leurs acolytes français ont été retournés. Nous sommes en effet à un croisement important : la Nationale 20 est traversée par plusieurs routes départementales qui partent en plusieurs directions différentes. Mais ces braves maquisards ne savaient sans doute pas que, malgré notre jeune âge, nous avions avec une autre personne servi d’intermédiaire pour transmettre des informations à un autre maquis, dans une forêt avoisinante.
Nous étions au printemps et c’est dans cette nouvelle demeure qu’une nouvelle venue vint agrandir la petite famille, la petite Monique que l’on nomma depuis lors : « BIBI ». Je me souviens l’avoir promenée parfois dans une petite remorque à vélo pour calmer ses pleurs. François aussi la promenait dans ses bras en l’embrassant. Entretemps, pour avoir du lait frais en quantité suffisante, mon oncle fit l’acquisition d’une vache. Bien souvent, je la menais brouter l’herbe au bord de la petite route en direction de la petite gare de Lothiers. Au bord de cette route, à quelques centaines de mètres de notre maison, une petite mare avait attiré mon attention. Tout autour, des saules laissaient tomber leurs branchages au ras de l’eau. Avec quelques copains, nous aimions nous retrouver là dans ce lieu tranquille, car ici nous trouvions notre bonheur : avec l’argile que nous ramassions – la terre glaise ainsi appelée – nous fabriquions des objets divers au gré de notre imagination et de plus avec les joncs qui poussaient au bord de l’eau, j’appris à faire des tresses. C’est ainsi que par un bel après-midi d’été, tout occupé que j’étais à faire un bonhomme d’argile, j’oubliais de surveiller la vache qui s’était tranquillement engagée dans le petit bois qui s’étendait à proximité. Surpris et affolé par sa disparition, je partis à sa recherche, mais comme le soir commençait à tomber, j’hésitais à pénétrer dans le bois et c’est ainsi que je revins bredouille à la maison où l’on me fit des reproches. Après le souper, l’oncle Aron, Henri l’aîné de mes cousins et moi-même partîmes avec une torche et une lampe électrique à la recherche de notre vache. Il faisait nuit et en moi-même je me disais : « pourvu qu’on la retrouve ! » Bientôt nous parvenions au bosquet et nous avancions dans le chemin à travers bois tout en suivant du regard le faisceau lumineux de la torche qui éclairait les deux côtés du chemin. Ainsi avons-nous poursuivi nos recherches environ une demi-heure en silence ; tout en avançant, nous scrutions du regard de part et d’autre du chemin ; finalement, nous arrivâmes à une petite clairière : étendue à terre dans l’herbe en train de ruminer tranquillement, notre vache tournant sa tête vers nous semblait nous dire : « hé bien voilà, je ne suis pas perdue »…
A l’époque des grandes vacances d’été, je me souviens avoir accompagné mes cousins et leur père qui participaient à la moisson à la ferme de la famille ROMANELLO, située à plus d’un kilomètre du village sur la route d’ARGENTON/sur Creuse. La batteuse faisait le plus gros du travail, mais pour porter les gros sacs de blé, il fallait des hommes forts ; je me souviens de l’étonnement des travailleurs de la ferme voyant avec quelle aisance l’oncle Aron soulevait et portait ses sacs de blé si pesants ! Plus tard ce fut l’époque des vendanges et c’était à notre tour de trimer une bonne partie de la journée, courbés dans les vignes, mais au passage, nous avalions quelques raisins que nous n’aurions sans doute pas pu nous procurer autrement !
Ainsi s’écoulèrent nos journées de congé et en dehors des jeux et des ballades que nous faisions, ce fut pour moi l’occasion de découvrir la vie des paysans, des gens de la campagne, de mieux comprendre les cycles de la nature, comment poussent certains fruits et légumes, ceux qu’il faut cueillir ou bien ceux qu’il faut déterrer !
Je me souviens du jour où ce brave homme, Monsieur LEFOL, voyageur de commerce et gérant de l’affaire de mon oncle Aron m’avait apporté mon vieux vélo resté à Orléans. En fait, en raison des décrets antisémites du gouvernement de Vichy, les commerces de mon père et de mon oncle étaient passés entre les mains de deux gérants « aryens » qui par la suite fusionnèrent les deux commerces. Heureusement que cet homme honnête et courageux nous rendit visite deux ou trois fois et nous apporta quelques subsides.
Avec ce vieux vélo, j’ai pu à cette époque m’évader un peu, tout en me rendant plus utile en faisant quelques courses dans des fermes des environs non sans avoir fait quelques chutes ! Comme dans toutes les familles, il y a eu quelques disputes entre les enfants mais vraiment rarement. En fait, mes cousins et moi-même, nous nous entendions parfaitement et nous nous soutenions les uns les autres ; mais un jour, pour un motif sans doute futile, mon jeune cousin et moi en vinrent à nous taper et nous lancer des chaussures. C’est François, le plus raisonnable, le plus réfléchi qui vint nous séparer. Nous partîmes chacun de notre côté et troublé que j’étais malgré tout, je fis quelques pas vers le carrefour sur la Route de l’école et soudain tout en marchant me revint à l’oreille un chant de Hanoucca que ma mère et ma sœur chantaient le soir de cette fête à la maison, chant mélodieux et plein d’espérance qui m’était revenu comme pour me réconforter !
Par la suite, François qui avait réussi son diplôme, partit rejoindre Henri qui était déjà pensionnaire au Lycée de Châteauroux. Parfois, ils revenaient en fin de semaine à LOTHIERS, à la maison. Nous étions à l’époque fin 1943, à l’âge que nous avions, nous tenions rarement en place, toujours à la recherche de quelque chose de nouveau à découvrir. Aussi, quand j’en avais le temps, je partais sur cette petite route où, après l’école et un peu plus loin, la mare, on arrivait au lieu dit : « le grand chêne ». Avant d’y arriver, je faisais quelques arrêts pour attraper quelques mûres qui poussaient dans les buissons au milieu de ronces abondantes. Heureux et fier d’avoir dégusté ces petits fruits délicieux, je m’en sortais malgré tout avec les jambes égratignées. Nous étions à l’époque des culottes courtes ! A partir de ce « grand chêne » débutait le bois qui s’étendait d’un côté du village. Le calme qui régnait là me plaisait : les senteurs qui émanaient de la terre et des arbres m’enivraient. ; je me sentais en sécurité ici, à l’abri des regards et des questions des « grandes personnes » qu’il valait mieux éviter… C’est lors d’une de ces balades dans ce bois que tout en marchant dans les feuilles mortes qui tapissaient le sol, mon pied buta contre un obstacle. En dégageant les feuilles qui le recouvrait, apparut un cylindre assez fin. Quelle ne fut pas ma surprise mêlée de crainte en découvrant un fusil, puis un autre, puis un troisième ! De mes mains et avec mes galoches, je les recouvris rapidement. De retour à la maison plus vite que je n’étais venu, il fut décidé d’en parler au maréchal ferrant qui d’après ce que j’avais entendu, n’avait guère de sympathie pour l’occupant. Le plus discrètement, nous les déposâmes chez Mr. Aimé, le maréchal ferrant. Selon lui, il s’agissait de fusils LEBEL jetés là par des soldats français lors de la débâcle de 1940.
Au moment où j’écris ces lignes maintenant, nous sommes à l’époque de PESSA’H - la Pâque juive, et cela me remémore la même époque en 1943. Malgré les restrictions, ma tante Léa avait fait cuire quelques tranches de ce pain Azyme et nous avions tous vécu cette soirée du « SEDERE » plus courte qu’à l’accoutumée, mais pleine d’émotions en perpétuant la pratique ancestrale que nous observons de générations en générations depuis plus de trois mille ans. C’est ainsi que me reviennent en mémoire quantité d’évènements marquants de mon enfance ; nous étions alors fin 1942, époque des plus tragiques : une nuit, je fis un rêve des plus merveilleux de ma vie : ma grande sœur Ciwia, « Tsivki » était à mes côtés ; nous nous parlions, évoquions des souvenirs de notre maison. Je lui parlais du bonheur que j’avais de la retrouver, combien son absence et celle de nos parents m’avait été douloureuse, mais comme ils allaient eux aussi revenir, je vivais alors un moment de félicité extraordinaire ; de plus, elle m’avait apporté de belles portions de gâteau que mes parents faisaient parfois à la maison ; je nageais dans le bonheur ! Et puis soudain, le rêve s’interrompit, suivi d’un réveil amer et j’étais là désemparé dans le lit, mes yeux emplis de larmes de désespoir, en constatant, hélas, que je n’avais fait qu’un rêve !
Un souvenir bien réel, celui-ci : j’avais environ cinq ans et ayant été malade, mes parents avaient installé un petit lit dans cette grande pièce qui servait de cuisine et de salle de séjour. Un soir, après sa journée de travail, je revois mon père, penché au-dessus de mon petit lit, me glisser dans la bouche des tranches de pêches succulentes ! Environ deux ans plus tard, début 1941, je venais de prendre sept ans : par un bel après-midi, mon père et moi enfourchons nos vélos, descendons la rue de « Bourgogne », puis la rue de la « Tour Neuve » et nous voilà en train de rouler sur les quais longeant la Loire. Bientôt, nous atteignons le chemin de halage qui va le long du canal ; ici, pas de bruit, c’est le calme complet et la verdure tout autour de nous. L’air est doux, parfumé. Toute cette végétation, ces plantes variées embaument, se mêlant aux effluves du fleuve qui coule en bas du canal. Nous posons nos vélos pour faire quelques pas ; mon père en profite pour me faire quelques recommandations sur la façon de rouler, à quel moment il faut freiner et surtout une grande prudence comme nous sommes près du canal, plus dangereux que la Loire, me dit-il. Je savoure ces moments car nous sommes seuls là à nous détendre et je profite de ce temps qu’il me consacre, lui qui est toujours si occupé par son travail. Nous avons repris nos vélos ; cette fois nous longeons toujours le canal mais le vélo à la main. C’est lui qui marche au bord de l’eau et tandis que je regarde cette eau sombre et stagnante, il me recommande la plus grande prudence ; c’est en Yddish qu’il me parle. A notre gauche, le terrain est assez escarpé et recouvert de verdure, d’une végétation variée, multicolore. Un instant, il s’arrête, pose son vélo sur le bas-côté, j’en fais de même, la pente est assez forte mais après quelques mètres, il grimpe encore pour atteindre les fleurs d’un petit arbre. Je découvre pour la première fois ces petites boules jaunes, d’un jaune citron, il cueille ces fleurs avec précaution et bientôt me tend deux bouquets parfumés. Voilà, me dit-il en Yddish : ce sera un beau cadeau pour ta mère et ta sœur. Je suis tellement fier que j’en reste sans mot ! Nous nous reposons encore un peu. Devant nous, le panorama est magnifique : le canal, un peu plus bas la Loire parsemée de quelques bancs de sable et de petits arbustes qui poussent çà et là et au-delà, sur l’autre rive, la campagne qui s’étend jusqu’à l’horizon. Puis c’est le retour et tout heureux je pédale sur mon grand vélo, mon père roulant derrière moi. Il me fait confiance, me laissant rouler le premier tout en me surveillant ainsi jusqu’à notre arrivée à la maison.
Ah ! Mon cher papa, brave Youdel comme on t’appelait ; combien ta présence, tes conseils, tes paroles m’ont manqué plus tard, au cours des années ! A ton sujet cher Papa, une anecdote m’a été racontée par l’oncle Aron après la guerre. Nous étions vers les années 1950. Un jour que son employé était absent, j’accompagne mon oncle au marché de Jargeau pour lui donner un coup de main ; nous roulions sur la route et à un moment donné, il ralentit et me dit : « C’était en 1938 ; comme tu le sais, ton père et moi on partait ensemble au marché ; ce jour-là, il faisait froid et il neigeait et quand nous sommes arrivés à cet endroit, ton père s’est écrié : « Aron, arrête-toi » ; il s’est précipité au bord de la route, a retiré le manteau qu’il portait et il l’a remis sur un vieil homme qui était là frigorifié ! Mon cher papa, même si nous n’avons hélas vécu que trop peu de temps ensemble, je sais quel genre d’homme tu étais ! Les gens qui t’ont connu, qui t’ont côtoyé, m’ont tous parlé de ta droiture, de ta bonté, de ta générosité et en particulier envers les plus démunis. Des voisins, des amis, des proches que j’ai rencontrés plus tard à Orléans me dirent à quel point ils t’estimaient.
C’est l’occasion pour moi de parler aussi de maman qui était venue seule de Pologne, le reste de sa famille demeurée là-bas ou ayant émigré en Amérique du Sud et en Terre d’Israël, la Palestine du mandat anglais, la patrie ancestrale du peuple juif depuis trois millénaires ! Chère maman, je me doute qu’au début de ton arrivée en France, généreuse terre d’accueil, les débuts furent difficiles, quand il fallait grimper avec le filet de nourriture et le mioche que j’étais alors, jusqu’au cinquième étage de ce petit logis rue de Bourgogne. Par la suite, quand nous nous sommes installés dans le grand appartement au premier étage, 6 rue Saint-Etienne, arrivèrent pour toi, je pense, des jours meilleurs. C’est dans cette fameuse grande cuisine que je te revois penchée sur la cuisinière en fonte où mijotaient pots et casseroles. La bonne chaleur de la cuisinière se répandait dans toute la pièce, mêlée aux odeurs des plats savoureux qui cuisaient doucement ; en y pensant, je ressens encore ces bonnes odeurs des mets que tu savais si bien préparer. Une autre scène me revient en mémoire, toujours dans cette grande cuisine car c’est là que nous passions une bonne partie de la journée, papa étant parti au travail et « Tsivki » à l’école. Ce jour-là, un matin, en hiver probablement, je m’approchai de toi tandis que tu emplissais ton fourneau de charbon et tirant sur le pan de ta jupe, je te demandais en Yddish, « mais quel âge as-tu maman ? » Sans hésiter mais sans me regarder, tu me répondis : « j’ai dix-huit ans ». Dans ma tête d’enfant de quatre ans et demi, ne sachant alors pas bien compter, je me disais malgré tout comme elle est jeune ! (en réalité, elle devait avoir 30 ans). Entre temps, j’allais jouer avec quelques soldats de plomb et puis, ne tenant plus en place, je revenais à la charge avec une autre question ! Par la fenêtre de notre cuisine qui donnait sur la rue, on apercevait à une cinquantaine de mètres, au-delà des appartements d’en face, une grande bâtisse dont l’architecture m’intriguait et je me souviens t’avoir demandé : qu’est-ce que c’est que ce bâtiment : « A cloïster a vou leben chvestern » « un cloître où vivent des bonnes sœurs ». Elle me répondit cela le plus naturellement, sans la moindre moquerie, sans la moindre remarque désobligeante envers ces religieuses : en effet, je sais qu’elle avait été éduquée avec des principes de tolérance et elle savait faire la différence avec des voyous qui en Pologne, lors des fêtes chrétiennes, venaient jeter les pierres sur les jeunes qui sortaient de l’école dans le quartier juif.
De l’année 1941 me reviennent en mémoire quelques évènements : certains après-midi, je me retrouvais seul avec toi, chère maman. Parfois, nous sortions jusqu’au jardin public derrière la cathédrale ou bien nous nous promenions dans ce vieux quartier pittoresque, non loin de la Préfecture. Au coin d’une petite rue, mon attention fût attirée par la vitrine d’une petite boutique. Je te tirai par la main et restais là, planté devant le spectacle qui s’offrait à mes yeux émerveillés. Une poupée de la grandeur d’un petit enfant, vêtue comme une petite princesse, trônait là devant moi, me fixant de ses grands yeux. Je restais là à l’admirer, incapable de détacher mes yeux de cette merveille : « Soré, ihr will die lalkie, sie gefelt mir » dis-je. (Soré, je voudrais la poupée, elle me plaît). Je ne sais pas le prix affiché, mais elle devait coûter une petite fortune. Le soir même, tu en parlais avec papa et très vite, mon énorme caprice fut satisfait et je pus l’admirer à ma guise, à la maison. Je me plaisais à l’habiller autrement. Je me lassais vite de ce jeu qui décidemment ne me convenait pas et par la suite, je fini par m’en désintéresser complètement. Il ne m’a pas été donné, hélas, le temps de pouvoir te remercier et de rendre à mon tour l’amour que tu me témoignais !
Revenons à Lothiers, dans ce minuscule village, où nous sommes encore au début de l’été 1944. Ce matin, il fait beau temps ; mes cousins et moi-même sommes en train de construire une cabane avec quelques planches, des rondins et autres morceaux de bois. A peine avons-nous terminé qu’un bruit de véhicules qui s’approchent, se fait entendre : quelques camions et deux Auto mitrailleuses de soldats allemands s’arrêtent au carrefour. Nous voyant là, un soldat se précipite vers notre maison, un sceau à la main en criant : « vassère, vassère ». Ma tante ayant entendu les cris arrive sur le pas de la porte ; heureusement pour nous, à une vingtaine de mètres, il y a un puits ; il emplit le sceau d’eau, s’en retourne, revient à nouveau, revolver au poing, remplir son sceau. Quelques minutes s’écoulent et le convoi repart par la N20, en direction de Châteauroux. Dans la journée, nous apprenons que ce convoi a été attaqué par des maquisards à deux, trois kilomètres de là ; il y a des blessés de part et d’autre. Finalement, après notre inquiétude, ce fut le soulagement ! Plus tard, nous apprenons qu’à quelques jours près, il y a eu l’abominable massacre d’ORADOUR-sur-Glane. Entretemps, les Alliés que l’on attendait comme le Messie, avaient débarqué en Normandie et pour savoir ce qui se passait réellement, nous écoutions en cachette la BBC en français, qui était évidemment brouillée.
Vers la fin juillet, l’oncle Aron repartit en vélo jusqu’à Ligny-le-Ribault, ce petit village de Sologne d’où nous nous étions échappés en juillet 1942. Il revint à Lothiers nous chercher avec son autre voiture, une conduite intérieure Citroën, qui était restée camouflée dans un garage.
Après des adieux émouvants avec nos voisins et quelques connaissances avec lesquelles nous avions noué des liens d’amitié, nous prîmes le chemin du retour. Une très courte halte à Orléans et nous rejoignîmes LIGNY-le-Ribault où, petit à petit, la vie reprit son cours.
Ce fut bientôt pour moi et mon cousin Maurice, le retour à l’école du village où le maître faisait régner la terreur en frappant d’un bâton les élèves qui avaient des difficultés ou de mauvaises notes. Heureusement à la rentrée suivante, j’allais rejoindre mes deux cousins Henri et François, pensionnaires au Lycée d’Orléans. A cette époque, la nourriture manquait encore. Un détail me revient en mémoire. Un jour, au réfectoire, après un repas frugal, nous avions reçu comme dessert une grosse orange, mais partagée en huit tranches pour les huit garçons de la table.
Je me sentais soulagé de ne plus avoir à me cacher, mais traumatisé par l’absence, la perte de mes parents et de ma sœur. Il me fallut plusieurs années pour parvenir à une vie plus équilibrée. Entretemps, le jour de mon douzième anniversaire, naquit la petite Chantal. Nous formions alors une famille unie de neuf personnes dont sept enfants et dont je faisais partie. Puis commença pour moi un nouvel épisode de ma vie, plus heureux non sans quelques évènements forts qui marquèrent mon adolescence. Mais cela est encore une autre histoire !
Ecrit en 2013-2014.
JUDEL, SARAH ET CYWJA BOROWSKI
Arrêtés à Orléans le 24 juin 1942
Internés au camp de Beaune-la-Rolande et déportés à Auschwitz le 28 juin 1942 par le convoi 5
Assassinés à Auschwitz
Judel est assassiné à Auschwitz le 22 juillet 1942 à l’âge de 48 ans
ALBERT BOROWSKI
Fils de Judel et Sarah Borowski
Frère de Cywja Borowski
Né le 26 février 1934 à Orléans
-

Judel et Sarah Borowski (sd). Archives familiales
-

Judel Borowski (sd). Archives familiales
-

Sarah Borowski (sd). Archives familiales.
-

Cywja Borowski (sd). Archives familiales
-

Cywja Borowski (sd). Archives familiales
-

Cywja Borowski tenant dans ses bras sa cousine Éliane Amrofel (mai 1942, Ligny-le-Ribault). Archives familiales
-

À Lothiers. Albert Borowski (à droite) et ses cousins Amrofel, de gauche à droite, Maurice, François, Éliane et Henri, posant avec la directrice de leur école à Lothiers (sd, 1944). Archives familiales