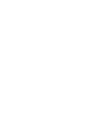Leizer MILIBAND
par sa fille Simone Fenal
Mon père Leizer Miliband (Léon) est né à Varsovie le 9 février 1905 (parfois 1903 selon les différents documents). Il était un des plus jeunes des douze enfants qui composaient la famille. Il avait trois sœurs plus âgées, dont une qui faisait des études et qui voulait devenir institutrice, ce qui devait être particulièrement difficile dans cette famille nombreuse où chacun devait contribuer à faire bouillir la marmite !
Ma grand-mère paternelle, Léa Chana, faisait des gâteaux qu’elle vendait devant chez elle sur un petit tabouret recouvert d’un napperon de dentelle, pendant que le grand-père, Zindel, allait avec ses amis prier à la synagogue. Les garçons essayaient, quant à eux, de trouver des petits boulots, ils allaient souvent arracher des pommes de terre, la nuit, pour pouvoir améliorer l’ordinaire. Ils rêvaient tous d’un monde meilleur sans pogrom, sans antisémitisme, un monde où ils pourraient tous étudier pour devenir quelqu’un, un “mentch”.
Les garçons les plus âgés sont tous des militants de gauche, des bundistes (d’ailleurs ils se refusent à écrire le yiddisch avec des hébraïsmes.) Ils veulent faire la révolution pour vivre libres, heureux.
Mon père arrive de Pologne, sans doute autour de 1925, pour rejoindre sa sœur et ses deux frères plus âgés, déjà installés en France et en Belgique. Je sais qu’avant d’arriver, il s’est arrêté à Anvers où son frère Sam a dû l’héberger un moment. C’est son autre frère Boris qui le reçoit ensuite, car il a déjà un logement à Paris et un petit atelier de gravure sur métaux.
Mon père, déjà militant en Pologne, rejoint rapidement avec d’autres amis, les syndicats professionnels de gauche, les organisations bundistes et les différentes activités culturelles. Pour lui, l’apprentissage de la langue française devait être une priorité. Il fait d’abord les marchés dans la bonneterie, puis, ensuite, apprend la maroquinerie, travaille pour un patron qui fabrique des sacs et des porte-monnaie. C’est probablement à cette période qu’il s’installe dans une chambre rue de la Réunion, dans le 20e à Paris. Comme il a de plus en plus de travail, il cherche une ouvrière pour l’aider et c’est ainsi qu’il rencontre ma mère ! Je n’ai évidemment pas de détails sur leur vie avant ma naissance. Ils décident de se marier et c’est alors que ma mère écrit à son père et à ses petites sœurs restées à Varsovie : “J’épouse mon patron” et son père lui répond alors : “envoie-nous un sac et un porte-monnaie !”
Ma mère, une jeune femme blonde, douce et timide, était arrivée de Pologne avec ses deux sœurs aînées, car les trois filles ne s’entendaient pas avec leur belle-mère. Elles avaient perdu leur mère, très jeunes. Elles laissaient en Pologne leur père, leur belle-mère et trois petites demi-sœurs. Ils sont tous morts dans le ghetto de Varsovie.
Sur l’une des photos que je possède de mes parents, prise sans doute un dimanche d’été au bois de Vincennes, ils ont l’air tellement heureux ! Ils sont avec des amis. Je dois avoir deux ans, et je suis sur les genoux de ma mère. Elle a enlevé ses chaussures et porte une robe avec un col blanc, mon père est assis derrière, il est en chemise et a retroussé ses manches.
Nous habitons deux petites pièces rue de Bagnolet dans le 20e arrondissement de Paris, les toilettes sont sur le palier et j’ai peur d’y aller seule.
Mon père travaille sur une grande planche posée sur deux tréteaux. Il est perché sur un tabouret haut, ma mère pique les pièces de cuir qui serviront à assembler les sacs et les porte- monnaie sur une machine à coudre. C’est d’ailleurs un de mes premiers souvenirs, terrifiant : l’impression d’avoir la tête prise dans la roue de la machine. Mes parents descendent souvent chez des amis qui habitent au troisième étage pour partager un gâteau et un verre de thé. Nous allons aussi très souvent aux marionnettes des Buttes-Chaumont car la cousine de ma mère habite juste à côté. Elle nous sert du thé dans des verres transparents au fond desquels elle met de la confiture de cerises.
Un soir, rue de Bagnolet, mon père revient avec sur ses épaules une toile noire très lourde qu’il pose sur sa table de travail, c’est une grosse boîte en bois verni, un poste de radio. Il le branche et j’entends une voix qui en sort, je suis stupéfaite. Par miracle, je le possède toujours.
1936 : Le front populaire. J’ai trois ans, j’ai un vague souvenir d’avoir été sur les épaules de mon père au milieu d’une foule immense, les gens crient et chantent, j’ai su plus tard que c’était au Père-Lachaise. Je vais à l’école maternelle rue Planchat. Juste en face, il y a les dragées Martial, toute la rue embaume les bonbons et le chocolat.
Plus tard, quand j’irai à la grande école, je serai fière de pouvoir déchiffrer les lettres d’imprimerie des journaux qu’achète mon père. Il lit sans doute la presse juive communiste ou bundiste, comme beaucoup de ses amis, sans doute la « Naie Presse ». Les nouvelles ne sont pas bonnes, il y a des rumeurs terribles. C’est la Nuit de Cristal, les Juifs sont humiliés, on leur coupe la barbe, on les oblige à s’agenouiller dans le caniveau. Partout en Allemagne, les familles juives se terrent chez elles. Dans la communauté juive, les rumeurs de guerre se propagent.
1939 : Premier Septembre. L’Allemagne attaque la Pologne et tous les journaux titrent “C’est la guerre”. Rapidement, le bruit court qu’on peut s’engager aux côtés de l’armée française dans les bataillons de la Légion étrangère créés spécialement. Ils sont environ 25000 hommes juifs dans la force de l’âge à se présenter dans les différents bureaux de recrutement. Pour eux, c’est un devoir de se battre contre le nazisme, de défendre la France, ce pays de la liberté qui les a accueillis.
Mon père part d’abord à Barcarès pour faire des manœuvres avant d’être envoyé au front. Il est incorporé dans le 22e régiment de marche des volontaires étrangers et se retrouve à Marchélepot dans la Somme où son régiment se bat avec rage. Nous recevons juste une carte postale : c’est un soldat en uniforme qui embrasse sa petite fille.
Fin juin 1940, un soir, ma mère me prend la main, elle est nerveuse. Nous descendons les six étages de notre immeuble et, tout à coup, devant la porte, je vois mon père, il est habillé en soldat, il a l’air d’avoir faim, il est mal rasé. Il me prend dans ses bras et me lève à hauteur de son visage. Voilà, il est à nouveau parmi nous, la vie va reprendre son cours, ma mère ne sera plus jamais triste, je suis tellement contente! Bientôt il recommence à travailler. Mes parents ont l’air d’être à nouveau heureux. Mon père m’achète un oiseau dans une cage et m’apprend à le tenir sans l’étouffer !
14 mai 1941 : LE BILLET VERT. Mon père est convoqué comme tous les hommes juifs, environ 3500, il doit se présenter pour une vérification d’identité. Je ne suis pas sûre du lieu, c’est probablement à la caserne militaire du Bd Mortier dans le 20e. Le 14 mai au matin, nous devons l’accompagner, ma mère et moi, comme il est notifié dans la convocation. Nous partons de bonne heure. Il y a déjà beaucoup de monde, des femmes, des enfants, tout le monde piétine. Tout à coup, les gendarmes font rentrer les hommes à l’intérieur. Les portes se referment, on nous demande alors de revenir avec une petite valise sans doute pour rapporter des vêtements (peut-être une couverture car les hommes convoqués sous prétexte d’une vérification d’identité sont pour la plupart en tenue de travail). Nous revenons, ma mère et moi, avec une valise. Je me souviens des cris, des pleurs des enfants, nous essayons d’apercevoir mon père, mais, très vite, les gendarmes tentent de nous disperser. Cette séparation brutale, je la revis douloureusement encore tant d’années après. Je ne comprends pas toute cette injustice. Ma mère est si triste, nous pleurons ensemble. Nous apprenons rapidement qu’il est interné dans le camp de Beaune-la-Rolande.
Pendant un an, nous recevrons ses lettres censurées. Il est toujours très préoccupé de ma santé, de savoir si je travaille bien à l’école et si nous avons assez à manger. Dans une de ses lettres, il écrit : “Dis-moi comment tu t’arranges avec le ravitaillement, ça doit être difficile pour toi, le moral est toujours bon, j’espère que tout finira vite et qu’on sera de nouveau ensemble, votre Léon qui pense à vous”.
Dans une autre lettre, il écrit que le temps est moins froid, qu’il se lève tôt pour écouter les oiseaux chanter et qu’il attend les lettres de ma mère le mardi, jeudi et samedi car ils avaient convenu qu’elle lui écrirait au moins trois fois par semaine. Il a reçu également un colis de ma tante de Niort avec trois œufs, quelques morceaux de pain avec du pâté, un petit bout de beurre, cinq cigarettes et quelques morceaux de sucre. Il écrit aussi dans une de ses lettres qu’il n’a pas encore fini mes sandales, car il n’a pas reçu le bois, mais qu’il espère l’avoir la semaine prochaine. Il me fabrique une belle boîte à couture sur laquelle sont peints des oiseaux qui tiennent une lettre qui m’est adressée : “de la part de ton papa qui t’aime, Léon”. Malheureusement, en quittant les maisons d’enfants, je ne l’ai pas retrouvée.
Je me souviens de notre unique et ultime visite au camp de Beaune-la-Rolande, l’arrivée devant cette grande allée avec, dans mon souvenir, mon père arrivant au loin. A chaque commémoration, c’est cette image imprimée sur ma rétine qui se superpose au paysage.
Mars 1942 : j’ai attrapé la scarlatine, j’ai beaucoup de fièvre. Pour ma mère, le quotidien est de plus en plus difficile, j’ai des engelures qui me font très mal. Nous vivons douloureusement l’absence de mon père. Nous recevons toujours ses lettres du camp qui semblent moins optimistes et plus espacées. Ma mère essaie de lui envoyer un peu d’argent quand elle le peut. C’est à cette période que mon père change de baraque pour aller de la 13 à la 2. Il fait alors partie des responsables des lettres et colis qui peuvent se rendre à la gare pour ramener le courrier au camp. Peut-être pouvait-il s’évader… A-t-il envisagé de le faire ? Je ne le saurai jamais.
Je suis enfin guérie de la scarlatine. Pour ma convalescence, ma mère m’envoie chez sa sœur à Niort. Notre séparation est terrible car je ne veux pas la quitter. Je pars de nuit dans un camion de déménagement Calberson. Je suis à l’arrière et je vois sa silhouette s’éloigner, devenir toute petite. Je ne la reverrai plus, elle a été arrêtée le 16 juillet 1942 et déportée par le convoi 10. Je suis chez ma tante à Niort et je n’ai aucune nouvelle de mon père. J’ai su, bien des années après, qu’au moment du départ de ma mère, il est déjà parti à Auschwitz par le convoi 5. Il mourra le 10 août 1942 (d’après son acte de décès).
Comment appréhender l’absence de ses parents lorsque l’on a neuf ans et que personne ne vous donne d’explications ? Je suis moi-même arrêtée à la campagne où je suis cachée, le 2 février 1944, le jour de mes 11 ans, puis internée à l’hôpital de Niort, sous la surveillance de gendarmes français et de soldats allemands.
J’ai la chance d’avoir des lettres et des photos de mon père prises à Beaune-la-Rolande, ainsi qu’une carte écrite de Drancy par ma mère, la veille de son départ.
C’est grâce aux photos émouvantes d’avant la guerre, que j’ai retrouvées par la suite, que j’essaie d’imaginer les moments de bonheur du dimanche après-midi avec la famille et les amis.
Témoignage recueilli en 2011
LEIZER MILIBAND
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 par le convoi 5
Assassiné à Auschwitz le 10 août 1942 à l’âge de 40 ans
SIMONE FENAL
Fille de Leizer Miliband
Née en 1933
-

Leizer Miliband (au centre), engagé volontaire à Barcarès en 1940. Archives familiales
-

Extrait du registre des internés du camp de Beaune-la-Rolande (1941-juillet 1942). Archives départementales du Loiret – 175 W 34120
-

Lettre écrite par Leizer Miliband, au camp de Beaune-la-Rolande (30 mars 1942) (recto). Archives familiales
-

Lettre écrite par Leizer Miliband, au camp de Beaune-la-Rolande (30 mars 1942) (verso). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande, des internés de la baraque 13 (25 avril 1942). Leizer Miliband est au 3e rang, le 3e en partant de la gauche, avec la cravate. A sa droite, Joseph Klapisch, avec les lunettes. Archives familiales
-

Leizer Miliband au camp de Beaune-la-Rolande (30 avril 1942) Inscription au verso : “en souvenire / de Bon la Rolande / le 30 Avril 1942 / Pour Boris / Léon”. Archives familiales
-

Le service des colis du camp de Beaune-la-Rolande. Leizer Miliband est le 1er debout à gauche, à côté de Mordka Rotgold. Joseph Klapisch est le 1er assis à droite (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Le service des colis du camp de Beaune-la-Rolande. Leizer Miliband est le 1er debout à gauche, au 1er rang, à côté de Mordka Rotgold. Au même rang, Joseph Klapisch est le 2e en partant de la gauche (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales