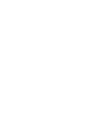Mejer RUBINSZTEJN
par sa fille Micheline Knoll
Mes souvenirs les plus lointains, les plus doux, les plus tendres se rattachent à mon père.
Je l’adorais et bien que je l’aie perdu à six ans, il a marqué toute ma vie.
Mon père est né à Biala Podlaska, en Pologne, le 4 février 1906, dans une famille très pieuse de huit enfants, il était l’avant-dernier. Son père était rabbin. J’ai une photo de mon grand-père prise en 1928, quand, avec ma grand-mère, ils sont venus voir leurs enfants à Paris.
Il a un visage qui respire l’intelligence et la bonté, il est très beau. Il paraît que sa réputation d’homme juste faisait que même les non juifs venaient le consulter pour régler leurs différends. La mère de mon père avait la réputation d’être une femme généreuse.
La famille était pauvre.
En 1918/19, un jeune homme, qui était parti à 15 ans en Amérique, est revenu à Biala pour se choisir une épouse. Il est tombé amoureux de la sœur aînée de mon père. Elle a accepté de l’épouser, mais a demandé d’emmener un de ses frères : Simon.
C’est ainsi que tous les trois sont arrivés à Paris, avec pour projet de rejoindre l’Amérique dès que la jeune femme, tout de suite enceinte, serait en mesure d’entreprendre un si long et fatigant voyage.
Ils ont aimé Paris. Ma cousine Tania y est née en 1920. Ils travaillaient et gagnaient correctement leur vie, dans la maroquinerie. Ils ont donc décidé de rester à Paris et ont fait venir, petit à petit, les frères et sœurs restés au pays.
Mon père est arrivé en I926. Il était grand, surtout pour sa génération, 1m80, il avait des yeux verts et un visage ferme et doux : j’ai une photo qui date de 1938.
C’était un homme réservé, modeste, qui avait, m’a-t-on dit, beaucoup d’humour. Il avait une belle et fine écriture de personne instruite. Arrivé en France, il avait suivi des cours du soir pour bien parler et écrire le français.
Le père de ma mère avait sympathisé, à la synagogue, avec le frère aîné de mon père (qui venait d’arriver en France et qui allait devenir le Rabbin Rubinsztejn). Ils souhaitaient lier leurs deux familles, selon l’usage de l’époque.
C’est ainsi que mon grand-père maternel a invité Mejer à venir prendre une tasse de thé, tout en spécifiant à ma mère qu’elle n’était engagée en rien si ce garçon ne lui plaisait pas.
Ils se sont plu et se sont mariés en 1933.
Ma mère est née le 14 novembre 1909 à Varsovie. Là aussi, huit enfants. La sœur aînée de ma mère s’étant mariée très jeune, ma mère a fait fonction d’aînée.
Mon grand-père avait un atelier de brosses, en Pologne, avec des ouvriers. Ses affaires étaient prospères, ce n’est donc pas la misère, mais l’antisémitisme qui l’a poussé à quitter la Pologne avec ses huit enfants, pour venir s’installer en France, en 1924. Les plus jeunes avaient cinq, quatre et trois ans. Mon grand-père avait fait la guerre russo-japonaise de 1905.
Il avait déjà, à Paris, une sœur aînée, mariée à un Juif français, d’où son choix de la France.
Les frères et sœurs aînés de mon père avaient fondé une famille et l’atelier de maroquinerie, puis le magasin, ne pouvaient plus les faire vivre tous correctement. Ils se sont donc dispersés tout en restant très liés : ils se retrouvaient régulièrement à la maison de campagne de Simon, près de Chantilly.
La femme de Simon, déjà née en France, les a tous aidés, surtout sur le plan administratif, à bien s’implanter en France.
Mon père est venu travailler avec ma mère (qui, auparavant, travaillait avec un de ses frères). Mes grands-parents, avec leurs enfants déjà grands, avaient commencé par faire des brosses, dans leur appartement de Belleville, et à les vendre sur les marchés. Puis ils ont ajouté les produits d’entretien, la parfumerie. À cette époque, c‘était un métier dur, mais qui permettait de bien gagner sa vie.
Je suis née le 15 juillet 1935.
Mes parents ont pu, en cinq ans, acheter leur pavillon au Perreux. À l’époque, c’était presque la campagne : Nogent, “le petit vin blanc”, les guinguettes… Ils travaillaient beaucoup, mais l’atmosphère à la maison était gaie, pleine de tendresse. Mes parents se complétaient : ma mère était plus pragmatique, bien ancrée dans la réalité ; mon père plus rêveur, plus idéaliste. Il était un chaud partisan de Léon Blum.
1936, c’est le Front Populaire. Ma mère m’a parlé de leurs premières et seules vacances : ils étaient partis, avec un tandem pour Berck-Plage. Elle en parlait avec émotion et tendresse.
Mon père jouait beaucoup avec moi : mon plus ancien souvenir ? Je devais avoir deux ans et demi, il me lançait en l’air, nous riions aux éclats, lui et moi, et ma mère avait très peur que je me fracasse le crâne en tombant par terre. Vers trois ans, il me tient la main et je suis à califourchon sur le dos de l’énorme chien du facteur, c’est mon cheval ! Mon père m’a appris à nager dans la Marne, à faire du vélo.
Un souvenir cocasse, qui montre bien qui était mon père, mes parents : ils m’avaient inscrite, pour mon entrée à la maternelle, à l’école “Jeanne d’Arc”, qui était, paraît-il, la meilleure école du Perreux. Quelques jours après la rentrée, mon père me voit, au pied de mon lit, récitant le “Je vous salue Marie”. Le lendemain je quittais “Jeanne d’Arc” pour l’école communale ! Mes parents se voulaient des Juifs modernes, tout à fait prêts à l’intégration, mais pas à l’assimilation.
On ne mangeait pas casher à la maison, mais les fêtes étaient célébrées, avec les familles. Mes parents parlaient français, sauf quand ils ne voulaient pas que je comprenne, alors c’était le yiddish.
Tant de souvenirs, alors que nous avons été si peu de temps ensemble...
Mon père avait fait une demande de naturalisation. Quand la guerre est arrivée, il n’était pas encore français. Comme la plus grande partie des Juifs immigrés, il est parti, alors, comme engagé volontaire.
Ma mère a dû passer son permis de conduire pour pouvoir continuer à travailler. Elle me disait, en souriant, que les inspecteurs étaient très indulgents avec les femmes de soldats, et qu’elle n’était pas très rassurée quand elle a pris le camion, seule, pour la première fois.
Juin 1940, c’est l’Exode. Nos pères sont soldats.
J’ai cinq ans. Avec ma mère, sa sœur Régine, et sa fille, Mireille, trois ans, nous fuyons Paris. Madame Labolle, qui travaille chez mon oncle et ma tante depuis la naissance de Mireille, nous accompagne. C’est une femme d’une cinquantaine d’années, veuve, très intégrée dans la famille. Pour Mireille, c’est “mémé”.
Nous arrivons à Forcy, un petit village dans la Nièvre, où Madame Labolle connaissait quelqu’un. Les Allemands nous rattrapent. Ils sont corrects, à ce moment-là. Nous rentrons à la maison. Mon père est de retour en 1940, également.
Le 14 mai 1941, il est convoqué au Commissariat de Nogent. Il n’a rien à se reprocher, il y va.
Le respect de la Loi, c’est important pour les Juifs, et cette image de la France, pour les Juifs qui viennent de Pologne ! Je ne me souviens pas de l’état d’esprit de mes parents à ce moment-là. Mon père a été emmené à Beaune-la-Rolande.
Un dimanche de juillet 1941, les familles ont été autorisées à rendre visite aux internés. Nous avons vu mon père à l’infirmerie, pourquoi ? Je ne sais pas. Nous étions seuls tous les trois, ça je m’en souviens bien, et ma mère a supplié mon père de s’évader. C’était possible à ce moment-là. Mon père a refusé. Il a dit “Que veux-tu qu’ils me fassent ?… Je vais aller travailler en Allemagne… Si je me sauve, c’est toi et la petite qui serez en danger”.
À moi, ses derniers mots ont été : “occupe-toi bien de ta maman”.
Y avait-il une crainte, une émotion particulière dans la manière dont il a dit cette phrase ? Je ne sais pas, mais je l’ai vécue comme une mission : je devais tenter de le remplacer auprès de ma mère. Cela a pesé très lourd, par la suite, quand ma mère a été malade et malheureuse.
Ma mère échangeait du courrier régulièrement, avec mon père, lui envoyait des colis.
Un jour, vers le 20 juin 1942, elle a reçu une lettre de mon père avec son alliance. Il lui disait : “Nous allons partir pour une destination inconnue. Si je ne reviens pas, fais faire une bague à Micheline pour ses 13 ans”. Il n’était plus question de s’évader à ce moment-là et il avait sans doute perçu que ce serait beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait imaginé.
La maison était bien triste depuis que mon père n’était plus là. Je me souviens du premier jour où je suis allée à l’école avec l’étoile cousue sur mon gilet. Je me souviens de mon malaise, de ma révolte. J’étais obligée, m’a dit ma mère : j’avais six ans révolus. Mon arrivée dans la cour de l’école : une élève me traite de “sale juive”. Bagarre, pleurs, incompréhension surtout : je suis la même qu’hier, j’ai même cette année-là le prix d’excellence et le prix de bonne camaraderie (c’est rare de cumuler les deux). Je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je ne suis pas retournée à l’école.
60 ans plus tard, je reviendrai dans cette même école, témoigner et dialoguer avec les élèves.
16 juillet 1942. C’est la rafle du Vel d’Hiv.
J’ai sept ans, depuis la veille. Ce fut un bien triste anniversaire. Depuis que mon père n’est plus là, je dors avec ma mère.
Ce matin-là, à 4h du matin, la cloche retentit à la grille. Ma mère se précipite à la fenêtre pour pousser les volets “C’est ton père qui revient !” me dit-elle. Mais elle retient son geste et regarde par la fente du volet. Elle voit deux gendarmes et un homme en civil et une voiture derrière eux.
Elle me dit : “Ne pleure pas, ne fais pas de bruit”. Je sens l’angoisse, la terreur de ma mère. Après un temps interminable, ils partent. Ma mère est tétanisée, nous ne sortons pas de la journée (je me souviens que nous avons mangé des biscottes et des sardines en boîte !).
La nuit suivante, vers minuit, on appelle, doucement, sous la fenêtre de la chambre qui donne sur la rue : Berthe, Berthe ! C’est le nom de ma mère en français. C’est ma tante Régine, mariée à un Juif français, qui a été au courant de cette rafle et qui vient de Malakoff voir ce qu’il en est pour nous. Nous nous sauvons, avec une petite valise, par le haut du Perreux. Nous apprendrons, après la guerre par des voisins, qu’ils sont revenus, ce matin-là, avec un serrurier…
À Malakoff, la famille maternelle se réunit chez mon oncle et ma tante. Il est décidé qu’il faut mettre les enfants à l’abri. Madame Labolle part dans la Nièvre pour trouver un placement nourricier. Nous sommes cinq : la plus jeune sœur de ma mère, Éva, 15 ans, ma cousine Suzanne, 14 ans, son frère Bernard, 12 ans, et nous les plus jeunes : moi, 7 ans, et Mireille, 5 ans.
Madame Soudan, qui a, avec sa fille, la plus grosse ferme du village, accepte de nous prendre en nourrice. C’est une région où on a l’habitude de recevoir des petits Parisiens, en particulier les enfants de l’Assistance Publique.
Douleur de la séparation.
Quand nous nous sommes quittées, ma mère m’a dit : “Surtout ne dis jamais, et à personne, que tu es juive”. Bien sûr, nous sommes arrivés sous un faux nom : la famille Jacques (le prénom de mon oncle, le père de Mireille).
Que dire de ces trois années ? Nous n’avons pas été maltraités. Nous menions la vie des petits paysans de cette époque. Chacun aidait, en fonction de son âge. Tous les dimanches, nous allions à la messe. Noël, Pâques, étaient fêtés en grande pompe. Les foins, les vendanges, avec les ouvriers agricoles embauchés pour l’occasion, le cochon qu’on tuait en octobre étaient aussi de grands moments.
Nous avons découvert, avec bonheur, la nature, nous les enfants des villes, la liberté, aussi, nous n’étions plus en permanence sous l’œil des adultes. Moi, fille unique, j’ai apprécié d’avoir des compagnons de jeux, toujours présents.
La guerre semblait loin, jusqu’au moment où les Allemands en déroute sont repassés par Forcy. Les Maquisards étaient nombreux et efficaces dans toute la région : les combats ont fait rage et les Allemands étaient féroces, ils ont fait des ravages dans le village. Nous étions réfugiés dans les caves et avions très peur (mais là, nous étions comme tout le monde).
Madame Labolle venait nous voir deux fois par an, une fois l’été, une fois l’hiver : pour apporter les jouets de Noël, parfois en passant entre deux trains bombardés. Grâce à elle, toute la famille maternelle a été sauvée et c’est à juste titre que bien des années plus tard, à titre posthume, nous avons fait en sorte qu’elle obtienne la médaille des Justes.
La fin de la guerre arrive enfin. Mon oncle Jacques vient nous chercher. Nous restons une année scolaire à Malakoff : ma mère aura bien du mal à récupérer notre maison car des sinistrés du Nord de la France ont été logés chez nous. Tout a été pillé par les Allemands et d’autres : meubles, marchandises, tout. Mon père, en 1940, avait pris la précaution de vendre le commerce à un voisin et ami (non juif, évidemment).
Néanmoins, un administrateur a été nommé car les Allemands ont estimé qu’il s’agissait d’une vente fictive (ce qui était vrai). Nous sommes rentrées dans une maison vide. “Tout ça, c’est des années de travail” a dit ma mère “mais ce n’est rien si ton père revient”. Ma mère a recommencé à travailler, avec une voiture à bras d’abord, puis avec un camion d’occasion. Ses fournisseurs d’avant-guerre lui faisaient confiance et lui avançaient la marchandise, elle payait au fur à mesure de ses ventes. Elle était vaillante, très courageuse.
Pas question de me mettre en maison d’enfants, comme cela lui avait été suggéré, elle ne voulait pas se séparer de moi, elle avait besoin de moi, je le sentais.
Jour après jour, nous attendions le retour de mon père. Tant de bruits circulaient : peut-être qu’il était en Russie ?
Souvent, quand je voyais, de dos, dans la rue, un homme grand qui avait à peu près la carrure de mon père, tel qu’il était dans mon souvenir, je me précipitais, je pensais qu’il était peut-être devenu amnésique. Évidemment, chaque fois, j’étais déçue.
À l’école, peu à peu les pères de mes camarades de classe qui avaient été faits prisonniers revenaient. Tous sont revenus. Je demandais à ma mère : “Et pourquoi pas le mien ?”
“Tu sais, ce n’est pas pareil, parce que nous, nous sommes juifs” a répondu ma mère.
Pour moi, ce fut terrible, car le curé, un brave homme qui n’a jamais cherché à nous convertir, alors qu’il devait savoir ou supposer que nous étions juifs, disait régulièrement en chaire que les Juifs avaient tué Jésus, comme l’Eglise le faisait à l’époque. J’avais “oublié” que j’étais juive ! Je ne savais plus qui j’étais, et personne à qui parler, surtout pas à ma mère que je voulais protéger au maximum.
Pour mes 13 ans, respectant le vœu de mon père, ma mère m’a fait faire une bague avec l’alliance qu’il avait réussi à lui faire parvenir. Alors pour moi, tout fut clair : mon père avait été tué parce qu’il était juif. Alors je serai juive et mes enfants seront juifs. Revanche contre Hitler. Fidélité à mon père. Par de-là la mort, mon père, avec son alliance, avait réussi à assurer la transmission.
J’ai espéré jusqu’en 1948 que mon père reviendrait. Nous n’avions pas d’acte de décès, seulement un acte de “disparition”. Comment ne pas continuer à espérer dans ce cas ? Mais un jour, ma mère a rencontré, à Paris, un ancien voisin de Varsovie qui sortait de sanatorium.
Il avait perdu sa femme et ses enfants à Auschwitz. Il était désemparé. Il cherchait du travail. Ma mère lui a proposé de venir travailler avec elle et finalement ils se sont mariés. Donc, pour moi, ma mère ne croyait plus au retour de mon père. Il n’empêche que, pendant longtemps, j’ai cauchemardé que mon père revenait et que ma mère était bigame !
Ma mère m’avait expliqué que c’était très difficile pour une femme de s’occuper seule d’une maison, d’un commerce, qu’il fallait un homme, même si elle restait de fait “la patronne”.
Dans un premier temps, ce fut un peu difficile pour moi (un jour, elle a donné à Boris un manteau qui avait appartenu à mon père –il a fallu le faire raccourcir, bien sûr– je me souviens de ma colère, de ma peine), mais assez rapidement, j’ai éprouvé un sentiment de soulagement : il y avait là, maintenant, un adulte pour prendre soin de ma mère, j’allais pouvoir m’occuper de moi, reprendre ma vie d’enfant.
Malheureusement, deux ans après, en 1950, ma grand-mère maternelle, qui n’avait jamais été malade, est morte brutalement, dans son sommeil, en faisant la sieste ! Pour ma mère, c’était trop, elle s’est écroulée : elle a fait une dépression nerveuse.
Je voulais être professeur de Français, j’ai dû interrompre mes études, la mort dans l’âme, aller dans un collège technique pour faire une formation de secrétaire et pouvoir vite gagner ma vie.
Mon beau-père, perdu, en voulait à ma mère de ne plus être la femme forte sur laquelle il pouvait s’appuyer : la vie à la maison devint un enfer. Je suppliais ma mère de divorcer. Plusieurs fois, elle a tenté de se séparer de lui, mais il la suppliait, demandait pardon… Elle avait pitié… Notre médecin, car il y eut plusieurs rechutes, estimait qu’il ne pouvait pas la soigner si elle restait avec cet homme.
À 22 ans, je me suis mariée avec un garçon qui avait perdu ses deux parents dans la Shoah et avait été élevé en maison d’enfants. C’est mon oncle paternel, mon tuteur, le rabbin Rubinstein, qui nous a mariés. (Un des seuls survivants, avec sa sœur Rachel de cette grande famille).
En 1960, nous avons eu notre fille, Anne ; et en 1963, notre fils Marc, du même prénom que mon père en hébreu. Une grande joie pour ma mère. La circoncision a eu lieu à la maison, dans cette maison achetée par mes parents, cette maison qui contient tant de souvenirs heureux et tragiques, en présence de mon oncle le rabbin, frère de mon père.
Un jour, ma mère est venue nous voir, chez nous, ce qui était inhabituel, généralement c’était nous qui allions au Perreux. C’était en décembre 1963, ma fille avait trois ans, mon fils six mois. Puis elle est rentrée chez elle, a pris des médicaments et a ouvert le gaz. Elle avait 54 ans.
J’ai eu le sentiment, à ce moment-là, qu’elle était venue constater que j’étais mariée, avec des enfants et que son devoir était terminé, qu’elle pouvait partir. Qu’elle avait survécu 22 ans à la déportation de mon père, pour moi. C’est aussi la seule porte de sortie qu’elle a trouvée pour se séparer de Boris.
Pour moi, ma mère est une victime indirecte de la Shoah.
Un jour, elle a eu ce mot terrible (à propos de sa vie difficile avec Boris) : “Que veux-tu qui sorte de bon des mariages d’Hitler !”
Adulte, grâce au CNED, j’ai préparé et réussi l’examen d’entrée en Fac de Lettres (équivalent du Bac), puis intégré l’École Normale Sociale, très soutenue par mon mari. Ces trois années de formation au métier d’Assistante Sociale, je les ai vécues avec un grand bonheur : une revanche, à propos de ces études que j’avais dû interrompre. J’ai fait ma carrière d’Assistante Sociale à l’Hôpital, en Maternité. Aider les femmes, les couples. Cela m’a donné beaucoup de joies.
Nous avons adhéré, dès le début, à l’Association des Fils et Filles de Déportés Juifs de France. Et c’est grâce au Mémorial de la Déportation des Juifs de France, de Serge Klarsfeld que j’ai su en, 1978 que mon père était parti pour Auschwitz par le convoi 5, fin juin 1942.
Il semblerait que mon père et son plus jeune frère Charles aient été fusillés, avec d’autres, à Auschwitz à la suite d’une tentative d’évasion. Le témoignage est celui du père du professeur Ady Steg, qui était là-bas. Il l’a raconté au rabbin Rubinstein. Sa fille, Jeannette, était présente lors de ce témoignage. Elle est partie en Israël en 1948 et c’est lors d’une de ses visites en 1988 qu’elle me l’a relaté. Pourquoi seulement en 1988 ? Elle m’a dit qu’elle pensait que j’étais trop jeune pour me souvenir de mon père… Suite à cette conversation j’ai décidé d’aller à Auschwitz. J’y suis allée avec mon mari et deux couples amis en 1989. C’était le deuxième voyage organisé par le Rabbin Daniel Fahri, du MJLF, et Liliane Klein Liber de la Coopération Féminine. Je voulais voir où on fusillait. J’espérais faire là, enfin, le deuil de mon père.
En 1992, avec la création de « l’Association des Enfants Cachés », j’ai pu enfin me pencher sur ma propre histoire : extraordinaire partage à partir d’un vécu souvent bien proche, ce terrible manque du parent ou des parents disparus dans la Shoah.
Le départ de nos enfants, à un âge tout à fait normal, fut particulièrement difficile : douleur des séparations passées revécues, en particulier en ce qui concerne le départ de notre fils : je téléphonais, je téléphonais, trop. C’était insupportable pour lui. Jusqu’au moment où j’ai pris conscience que je vérifiais, ainsi, que lui n’avait pas “disparu” !
Notre fille, médecin, a épousé un garçon qui est revenu à une certaine pratique religieuse : shabbat, cacherout, fêtes. Ils ont trois filles qui ont actuellement 21 ans, 18 ans et 16 ans, et qui ont fait leur bat mitsva. La deuxième m’a demandé, il y a six ans, pour la cérémonie religieuse, de lui prêter ma bague de petite fille, “comme ça, ton père sera un peu là”. J’ai été profondément émue. Revanche sur Hitler : “Nous sommes là”.
La plus jeune, pour sa bat mitsva, m’a fait la même demande.
Notre fils, qui a fait aussi de bonnes études, a deux petits garçons de 10 ans et 6 ans. Il a également une compagne juive, qui a beaucoup de famille en Israël.
Quand j’ai été à la retraite, j’ai éprouvé le besoin de préparer un DUEJ (diplôme universitaire d’études sur le judaïsme). C’était, pour moi, acquérir des connaissances que mon père n’avait pas pu me transmettre. Ce fut passionnant. Et bien nécessaire.
Une fois, à l’adolescence, ma fille m’avait dit : “Moi, je suis juive par la Shoah”. Horrible. Il fallait que j’aie d’autres choses à transmettre à mes petits-enfants.
Il y a quatre ans, avec mon mari et des amis, nous sommes partis en Pologne, avec « Valiske », qui organise des voyages à thème juif. Le thème était “1000 ans de vie juive en Pologne”. Désir de voir ce pays où mon père, mes parents, ont ouvert les yeux sur le monde.
Nous sommes partis avec des craintes, fondées, certes, mais nous avons fait, aussi, des rencontres émouvantes, passionnantes. Beaucoup de jeunes s’intéressent à ce passé juif en Pologne.
Le temps qui passe. Les nouvelles générations qui doivent se débarrasser des vieux démons. Sentiment que la boucle est bouclée.
Mémoire de mon père.
Le Perreux, le 6 janvier 2012
MEJER RUBINSZTEJN
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 par le convoi 5
Assassiné à Auschwitz
MICHELINE KNOLL
Fille de Mejer Rubinsztejn
Née le 15 juillet 1935 à Paris 11e
-

Première page du livret de la famille Rubinsztejn : Mejer et Bajla se marient le 31 octobre 1933 à Paris. Archives familiales
-

Page du livret de la famille Rubinsztejn : Micheline naît le 15 juillet 1935 à Paris 11e. Archives familiales
-

Micheline au milieu de ses parents, Mejer et Bajla Rubinsztejn (1938). Archives familiales
-

Extrait du registre des internés du camp de Beaune-la-Rolande (1941-juillet 1942). Mejer Rubinsztejn est « remis aux autorités allemandes le 10/10/41 ». Archives départementales du Loiret – 175 W 34120. Mejer Rubinsztejn est écroué la maison d’arrêt d’Orléans le 10 octobre 1941 sur ordre du tribunal allemand de Paris, suite à une condamnation le 5 avril 1941 pour défaut de pancarte de commerçant juif. Sa peine purgée, il est à nouveau transféré au camp de Beaune-la-Rolande le 24 octobre 1941.