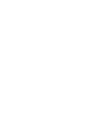Ojzer KAWKA
par son fils Albert Kawka
Mon père est né en 1905 à Lubien en Pologne. Ma mère s’appelait Bluma Krosznieska. Il a quitté son village à 20 ans. Auparavant, il travaillait avec son père comme cordonnier. Il avait donc un métier dans les mains quand il est arrivé en France. Sa famille était religieuse. Mon grand-père était chantre à la synagogue. Dans la famille, tout le monde chante, sauf moi qui suis plus porté vers la musique. Mon père était le plus jeune des quatre frères. Ils sont restés en Pologne, je ne les ai pas connus. Seul, mon père est venu en France en 1926 pour des raisons économiques et pour fuir l’antisémitisme qui commençait à être virulent, même dans les petits villages.
Je sais qu’il avait des idées avant-gardistes dans sa jeunesse en Pologne, en particulier sur la vie familiale. De plus, il n’était pas très religieux, il allait simplement à la synagogue. Avec l’âge, il est devenu plus traditionaliste, il chantait des prières quand il enterrait un de ses amis.
Ma mère, née en 1900, est arrivée avant lui, avec sa sœur. Ils étaient du même village. Ils ont d’abord habité dans une chambre d’hôtel, rue de Turenne à Paris. Puis ils ont vécu au 91 rue de Ménilmontant. Je suis né en 1930. Mon père travaillait dans une échoppe rue Pali-Kao dans le coin de Belleville, puis on a déménagé, en 1934, rue Villiers de-l’Isle Adam où il avait sa boutique et nous habitions dans l’arrière-boutique. Je suis allé à l’école maternelle rue de la Bidassoa, puis à l’école primaire rue Sorbier jusqu’à l’âge de 11 ans.
Je sais que mon père s’intéressait beaucoup à la culture littéraire et musicale. Avec des amis, Michel Trajster, Isaac Justman, Joseph Rotenberg qui venaient régulièrement chez nous, ils ont fondé la Chorale populaire juive de Paris dirigée par Monsieur Kaufman. Le président était Elisha Drylich. Comme ils étaient célibataires et que mon père était le seul à vivre en famille, le samedi, c’étaient des grandes réunions qui se terminaient par des chansons. Ce sont de bons souvenirs.
Mon père a dû se déclarer comme juif au commissariat. Ensuite, il a reçu l’affiche « entreprise juive » à coller sur la vitrine. Je dois reconnaître que les clients du quartier n’ont jamais fait cas de quoi que ce soit. Il a été convoqué par le fameux “billet vert” à 7 heures du matin à la caserne du Boulevard Mortier et comme il était très exact, il était là-bas à l’heure dite, le 14 mai 1941. Je sais qu’il s’est fait accompagner par l’oncle Nathan Sztanke, le mari de ma tante, qui, lui, était naturalisé français. Quand il n’est pas ressorti de la caserne, l’oncle est venu nous voir. Mon père a-t-il hésité à y aller ? Je ne crois pas, d’autant que plusieurs de ses copains ont fait de même, sans doute par ignorance. Certains n’y sont pas allés parce qu’ils ont tardé. Qui pouvait aller à 7 heures du matin, sinon mon père ? Au fur et à mesure que les gens entraient et ne ressortaient pas, ceux qui arrivaient avaient une certaine intuition. Je sais que j’ai pleuré quand il n’est pas revenu.
Pendant qu’il était à Pithiviers, mon oncle et ma tante ont vécu en Normandie. Ils sont partis en vacances en Juillet et comme ils ont trouvé un petit village sympathique, ils sont restés là-bas. Mon oncle faisait les marchés, donc il s’est arrangé pour mettre son stock de marchandises à droite et à gauche, puis il est resté en Normandie. On a su tout de suite où était mon père et l’on a reçu très vite de ses nouvelles. Ses lettres n’ont pas été conservées, mais elles venaient régulièrement, avec l’adresse : Camp d’hébergement de Pithiviers. Il écrivait en yiddish et c’est ma mère qui recevait le courrier.
Début juillet, on a eu une permission pour aller le voir à Pithiviers. On y est allés par le train, une seule fois. J’ai une image très présente, des baraquements situés près de la gare, sur le même côté. On nous a dirigés par là. Les internés venaient du côté gauche, à l’extérieur du camp pour visiter leur famille. On est restés toute la journée. Les internés pouvaient sortir de Pithiviers à condition d’avoir un certificat d’hébergement pour les moissons, ou pour différents travaux de fermage. Comme beaucoup de paysans étaient prisonniers, les fermiers manquaient de main-d’œuvre. Mon oncle lui a procuré un certificat et mon père n’a pas voulu s’évader, il ne voulait pas laisser tomber les copains. C’était son caractère, c’était lui.
Ma mère a eu du mal à subsister. Je me suis réfugié, en novembre 1941, à Mortagne, chez ma tante dans le Perche. Ma tante correspondait en yiddish avec sa sœur. Au début, j’étais vraiment inconscient. La seule fois où j’ai pris conscience, c’est quand à Mortagne, il est arrivé un régiment allemand. Ils se sont établis à proximité de là où nous étions, et le maire de Mortagne avait décidé que nous devions porter l’étoile. Mon oncle et ma tante n’osaient plus sortir, mon cousin était gêné. C’est moi qui allais faire les commissions avec mon étoile. C’était fin juin, début juillet. Je crois que j’étais le seul dans le village à la porter. Après cet épisode, mon oncle et ma tante ont décidé de partir en zone libre.
Ma mère est restée à Paris jusqu’en juillet 1942. Je sais comment elle a été arrêtée parce que ma femme, une amie d’enfance qui habitait dans un immeuble sur le trottoir d’en face, a vu ma mère partir encadrée par deux gendarmes. Elle avait passé la nuit avec une vague cousine qui ne voulait pas rester seule. Elles sont parties toutes les deux. C’était à la rafle du 16 juillet. Ma femme n’est pas juive, sa famille est d’origine italienne, donc le fait d’être étrangers à la France nous a un peu rapprochés. Dans son propre immeuble aussi, il y a eu des arrestations. Ma mère s’est inscrite sous son nom de jeune fille, pour que je ne sois pas inquiété.
Pour téléphoner de Mortagne à ma mère, il fallait envoyer un avis d’appel à un café à proximité de chez moi. Et c’est là que l’on m’a dit qu’elle avait été arrêtée. Elle est passée par Pithiviers. J’ai d’ailleurs reçu une lettre de là-bas me disant qu’elle “remplaçait” mon père. Elle savait donc que mon père avait été déporté. À l’époque, on pensait qu’il s’agissait d’aller travailler.
En zone libre, j’étais à Châtillon-sur-Indre. Mon oncle et mon cousin ont passé la ligne de démarcation du côté d’Angers et comme c’était assez difficile, ils nous ont conseillé de passer par Dax. Ils m’avaient pratiquement adopté. Ma tante était une seconde mère pour moi. Je l’adorais. Nous avons appris que Paris était libéré en septembre 1944 et nous sommes revenus de Châtillon le 11 décembre 44 avec une camionnette.
Au bout de quelques jours, entre Noël et le jour de l’an, j’ai voulu aller chez le coiffeur. Mon oncle et ma tante habitaient le 107 rue de Ménilmontant. En sortant de chez le coiffeur, en boitant, avec une canne, je suis allé jusque chez moi. L’appartement était occupé par une dame de notre entourage. Il n’y a eu aucun problème pour récupérer notre appartement. J’ai revu mes anciens amis, ma future femme.
Mon père est arrivé à l’hôtel Lutetia le 27 avril 1945. Il est venu tout de suite chez mon oncle et ma tante où il a passé la nuit. Puis il est retourné voir ses amis. On l’a envoyé en maison de repos au Vésinet pendant un mois ou un mois et demi. Je suis allé une fois au Vésinet pour le voir.
À son retour, la rencontre a été très affectueuse, c’étaient les retrouvailles, mais j’avais grandi, j’avais 15 ans, alors qu’il m’avait laissé à 11 ans. Je n’ai pas trouvé son comportement identique à celui que j’avais connu. J’étais presque un homme et lui un rescapé. Je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête à l’époque, mais c’était le brouillard, il ne réalisait pas encore sa libération, tout ce qu’il avait vécu.
Au début, il ne parlait pas. S’il avait dû dire ce qu’il avait vu, ce qu’il avait enduré, on ne l’aurait pas cru ou on aurait eu des doutes ou quelque chose dans ce goût-là. Je pense qu’il lui fallait du temps avant de se ressaisir. Il a tout de suite recherché des rescapés. Il est rentré avec deux jeunes, dont Henri Krasucki. À l’époque, je ne le connaissais pas. Il était très fier de mon père, il disait : c’est un peu grâce à lui si je suis vivant aujourd’hui.
Je ne connaissais pas l’histoire mais, au camp, mon père a eu la chance de travailler dans la cordonnerie et il a eu droit à des rations de soupe supplémentaires. Il gardait la soupe pour les jeunes et quand ils rentraient du travail, ils avaient de quoi manger.
Il a été à Auschwitz-Birkenau, Jawischowitz et Buchenwald. Il a eu le numéro de matricule 42192. Il a été libéré à Buchenwald après l’évacuation d’Auschwitz. Ce qu’il évoquait avec le plus de difficulté, c’était l’assassinat d’un proche copain au tout début. Tant qu’il pouvait soutenir moralement les déportés, il le faisait avec plaisir puisqu’il chantait ; ça donnait un peu d’espoir. Puis, il y a eu quelque chose qui s’est brisé quand il a appris la déportation de ma mère, par une de ses amies qui lui a fait un signe de la main.
Donc, à son retour, il a eu un passage à vide. Il manquait de tonus. Puis il a connu une femme avec qui il s’est marié. Ma belle-mère qui était une femme courageuse l’a obligé à quitter la cordonnerie. Comme elle travaillait dans le tricot, ils se sont mis ensemble. Il a commencé à se sentir mieux. C’était une coupure tragique. Revenir, c’est bien, on est vivant, mais on n’a plus rien.
Il ne parlait de sa déportation, il y avait comme une gêne. Je n’osais pas poser de questions, par respect, pour ne pas le gêner. J’attendais que lui raconte. Il a parlé de son expérience, quand il descendait à la mine de charbon à Jawischowitz : un soir de Noël, un ouvrier polonais lui avait donné un bout de pain ou une pomme de terre, c’était quelque chose !
Il a été à l’Amicale d’Auschwitz et aux Anciens Combattants. Je ne l’ai jamais accompagné, il ne m’a jamais invité à venir avec lui, j’y serais allé s’il me l’avait demandé. Le temps a augmenté les distances. Peut-être que j’étais trop grand. Je venais régulièrement le voir. Il avait sa boutique rue Villiers de l’Isle Adam, j’avais un petit magasin dans la même rue, mais un peu plus haut, et, chaque jour, je ne pouvais pas passer devant chez lui sans venir lui dire bonjour, à ma belle-mère et à ma petite sœur.
Quand mon père est rentré de la maison de repos, en septembre 1945, mon oncle m’a fait mon balluchon pour rentrer chez moi. Et je me suis retrouvé vraiment seul. Je me suis retrouvé dans notre ancienne boutique rendue à mon père. Il avait touché un lit en bois blanc, un buffet, une table et deux chaises. Mon père et ma belle-mère habitaient à l’époque à Issy-les-Moulineaux.
Mon père a vécu avec ma belle-mère, Annette Bronjstein, jusqu’en 1952 et ensuite, ils se sont mariés. Il lui fallait un certificat de décès par jugement, donc il a dû attendre six ans ou sept ans. Ils ont eu ma petite sœur Ginette qui est médecin et habite près de Meaux.
Avec le recul, je ne peux pas lui en vouloir, il avait 40 ans quand il est revenu. Je ne lui en ai jamais voulu, mais j’ai eu le sentiment d’être délaissé. Laissé-pour-compte. C’est un sentiment. Après la déportation, il a retrouvé tous ses amis, il était assez gai de caractère, il chantait. Ce qui lui a permis de tenir au camp, c’est son moral et le chant, puis de sentir un milieu amical entre les quelques déportés qui étaient avec lui. D’ailleurs, il avait beaucoup d’amis après sa déportation. Un jour, en se promenant à Tel-Aviv, quelqu’un est sorti de sa boutique, l’a interpellé et lui a dit : “C’est toi Kawka” et il lui a fait cette bague que je porte, il était bijoutier. “Tu m’as sauvé la vie”.
Enfin, il a eu une bonne vieillesse tout de même. Ma belle-mère est décédée en 2007.
Le chant de Pithiviers, composé à l’intérieur du camp, que chantait mon père aux commémorations annuelles à Pithiviers et à Beaune, est un chant assez émouvant, qui peut passer au-dessus de toutes les ségrégations entre juifs, catholiques. Et maintenant, la vieille histoire a l’air de vouloir recommencer toujours…
Ce témoignage, je le fais pour lui et pour ma mère, parce que de ma mère, on en a très peu parlé. Avec le recul, je pense qu’elle n’a pas eu une vie de femme, au sens propre du mot. Il a fallu qu’elle travaille et qu’elle subvienne aux besoins de tout le monde. Ma mère chantait aussi à la chorale. Elle n’a pas dû avoir une vie tellement rose, c’est ce qui me chagrine le plus. Ma tante est décédée à 96 ans, un peu délaissée par son fils, et sa bru. Ils avaient des moyens, mais ils manquaient de de sentiments. Ainsi va la vie.
Il y avait une autre tante qui est venue en 1935-36, qui a été arrêtée le 16 juillet. Mon père a rencontré son beau-frère à Auschwitz avec son neveu Abraham, qui avait 17 ou 18 ans. Ils sont tous morts. Ma tante qui était la 3e sœur de ma mère avec ses deux filles, également. Voilà. Quand on repense à tout ça, c’est vraiment une page d’histoire très poignante. J’avais cet ami d’enfance, Jacky, ce cousin très éloigné, fils de la femme qui a été déportée avec ma mère en juillet 42. Ils habitaient 24 rue de Ménilmontant, et d’après le Mémorial de Serge Klarsfeld, il aurait été déporté au mois de février 1943. Qu’est-ce qui s’est passé pour cet enfant entre-temps ? Comme je fais partie du Comité Tlemcen, en posant les plaques dans les écoles, je recherchais ce cousin dans la rue de Pannoyau, ou dans la rue de Tourtille et dans une des dernières écoles que nous avons faite, celle de la rue Sorbier, je l’ai retrouvé. Il aurait été recueilli par l’UGIF et il serait parti, lors de la rafle de la rue des Rosiers. L’hiver 1943 était terrible, il a dû souffrir, ça a été un des hivers les plus terribles.
Témoignage recueilli en 2008
OJZER KAWKA
Interné au camp de Pithiviers à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 25 juin 1942 par le convoi 4
Décédé le 6 février 2002 à l’âge de 97 ans
ALBERT KAWKA
Fils d’Ojzer Kawka
Né en 1930
-

Ojzer Kawka engagé volontaire, au 2e rang à droite, à Septfonds (sd). Archives familiales
-

Extrait du registre des internés du camp de Pithiviers (« Camp de Pithiviers / 1942 »). Archives départementales du Loiret – 20 M 782
-

La chorale du camp de Pithiviers, en avril 1942. Au 2e rang, Ojzer Kawka (avec les lunettes) est le 4e en partant de la droite, juste à côté Mendel Zemelman, auteur du chant de Pithiviers, en blanc. Chaïm Goldsztajn est le 1er à gauche, même rangée. Archives familiales
-

Au camp de Pithiviers, Ojzer Kawka est le 2e en partant de la gauche, au 1er rang (avec les lunettes). Archives familiales
-

Ojzer Kawka à son retour de déportation (sd, sl). Archives familiales
-

Ojzer Kawka entonnant le « Chant de Pithiviers » lors de l’une des commémorations qui ont lieu sur le site des camps à Beaune-la-Rolande et Pithiviers chaque année en mai depuis 1946 (sd). Archives familiales