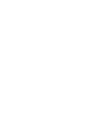Pinkas KALIKSZTAJN
par sa fille Renée Olesinski et sa petite-fille Francine Aknin
Pinkas KALIKSZTAJN par sa fille Renée Olesinski
Je témoigne pour mon père, Pinkas et pour mon oncle Leib, son frère. Ils étaient originaires de Varsovie. En Pologne, mon père était tailleur et mon oncle menuisier tapissier. Ils étaient six frères et deux sœurs. Mon père et mon oncle, qui avaient un an et demi de différence, étaient très liés. Mes grands-parents étaient d’une famille pratiquante traditionnelle, ils respectaient les fêtes et mangeaient cacher.
Mon grand-père paternel était comptable. Ma grand-mère était née à Vienne en Autriche où elle a vécu jusqu’à son mariage. Comme elle avait beaucoup d’enfants, elle ne travaillait pas à l’extérieur.
Mon grand-père maternel était gérant d’immeubles à Varsovie. Ma grand-mère était fille d’un rabbin. Ils se sont mariés jeunes et ont eu également six enfants.
Mon oncle est arrivé en France en 1926 ou 27, mon père en 1929 et ma mère en 1930. Mes parents, qui s’étaient connus à Varsovie, se sont mariés en 1930 en France. Deux frères de mon père sont partis au Pérou : l’aîné d’abord, puis l’autre. On n’a jamais su ce qu’est devenu le reste de la famille. Mon grand-père et tous les autres frères et sœurs ont dû être déportés ou sont morts dans le ghetto, on ne sait pas. La Pologne n’a pas donné de renseignements. Maman, elle, a retrouvé deux frères après la guerre. Ils étaient en Russie, l’un était en Sibérie et l’autre dans un autre endroit.
Mes parents ont d’abord habité dans une chambre d’hôtel, place Voltaire, puis rue Bourg-Tibourg, dans un petit appartement dans le Marais où je suis née en 1934. Quand mon père s’est engagé volontaire dans l’Armée française, maman a perdu un bébé. Mon oncle était tapissier menuisier chez Lévitan. Mon père a travaillé aux Galeries Lafayette et à la Samaritaine. Il était coupeur modéliste et tailleur, et quand c’était la saison, il allait repasser des pantalons le soir pour gagner de l’argent qu’il rapportait à ma mère. Je me souviens que c’était des toiles noires. Il rapportait des chapeaux, l’hiver et l’été, et maman les garnissait à la maison, soit avec des oiseaux, je me souviens que je les lui passais, des petits fruits, des petites cerises, ou l’hiver, des plumes ou des petits oiseaux. Elle faisait également un peu de finition. Ma tante faisait des coussins, des canevas ou bien elle mettait du satin, sur les canapés, à la maison chez elle. Elle avait une machine à coudre. Je me souviens que, pendant les fêtes juives, j’allais à la synagogue avec mon père rue Pavée. J’aimais bien lui mettre sa kippa et son châle.
J’ai appris le français à l’école, car chez moi, on parlait yiddish. Mon père voulait absolument savoir le français et il allait prendre des cours à l’école Berlitz. J’ai des cartes qu’il m’a écrites. J’ai le souvenir des fêtes, des moments joyeux, des anniversaires. Papa aimait beaucoup la vie artistique, on allait au théâtre et il m’emmenait le dimanche matin au cinéma. Il m’a fait apprendre la danse classique quand j’étais petite fille, au théâtre du Châtelet. Mes parents aimaient sortir et mon père aimait se promener avec moi, il me gâtait beaucoup. Je garde de lui le souvenir d’un papa extrêmement gentil : il m’emmenait au jardin des Tuileries, sur les chevaux de bois. Il était calme, très attentionné pour sa famille, très travailleur. Il voulait que tout soit impeccable à la maison. Il aidait maman à faire les travaux difficiles. J’étais toujours bien habillée, puisque c’était son métier.
Mes parents ont été se déclarer comme Juifs. Je me souviens que ma mère avait ces cartes d’identité en accordéon, avec le tampon “Juif”, en rouge. Je suis allée à l’école laïque rue des Archives, jusqu’en 1942. J’ai porté l’étoile pour aller à l’école en juin 1942, dès qu’elle a été obligatoire. On la mettait sur le manteau. Je me rappelle que j’avais mon cartable d’un côté et je mettais toujours ma main sur l’étoile pour la cacher. Il fallait l’avoir également sur la blouse. Heureusement, ma maîtresse, qui ne voulait pas que je la porte, m’avait demandé d’apporter une deuxième blouse : celle qui avait l’étoile restait au vestiaire. Elle a fait de même avec les cinq ou six autres enfants juifs. D’ailleurs, à cette époque-là, je n’ai pas entendu de moqueries de la part des autres élèves, juste quelques regards appuyés.
Ma mère, naturellement, la portait quand nous sortions ensemble. Je me sentais comme quelqu’un qu’on montre du doigt, quelqu’un qui n’est pas comme les autres. Il y avait aussi des interdits, je ne pouvais plus aller à mes cours de danse, les Juifs ne pouvaient pas aller partout. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je n’avais pas le droit de faire comme les autres enfants. Ma mère me disait toujours : “ça va passer, c’est comme ça”. Elle essayait de me consoler, parce que j’étais très jeune. Je ressentais, parfois, comme une humiliation. Je sais qu’on n’allait plus à la synagogue, je ne sais pas si c’était interdit. On n’allait plus dans les jardins publics. Ma mère m’avait dit : “on ne peut pas aller là-bas”, mais elle ne me donnait pas trop d’explications. Je me rappelle qu’on n’allait plus à beaucoup d’endroits et maman me disait : “oui, tu sais, tout est cher maintenant, papa n’est pas là…” Elle ne voulait pas que j’en souffre.
Quand mon père a reçu la convocation, je me rappelle qu’il a dit : “Je dois aller me présenter pour vérification de papiers”, c’est tout. Il n’en a pas dit plus. Il ne paraissait pas inquiet. C’était le matin, j’étais encore couchée, il est venu m’embrasser et il est parti. Il a même dit : “à tout à l’heure”. Pour lui, on devait obéir. Ma mère est revenue sans lui. On a su assez vite qu’il était à Pithiviers.
Je m’en souviens, parce que j’ai posé la question. Je voulais quand même savoir où était mon père, pourquoi il ne venait pas. Il avait l’habitude, quand j’étais couchée, de venir près de mon lit et il me chantait des chansons, des berceuses en yiddish. Et évidemment, ça m’a manqué. Maman a toujours enjolivé les choses, pour moi. Elle ne voulait sans doute pas que j’en souffre.
Mon père a peut-être parlé de cette convocation avec son frère, mais je ne me rappelle pas. Mon oncle habitait dans le 12e, rue Capri, avec sa femme et leur fils. Après la guerre, on a revu une fois ce cousin qui avait huit ans de plus que moi, et je ne sais pas ce qu’il est devenu. Il a dit qu’il devait partir à l’étranger, qu’il nous écrirait… On a fait des recherches, en vain. Maman a toujours pensé qu’il s’était engagé en Israël et qu’il était mort là-bas.
Mon oncle a été convoqué certainement dans son arrondissement, avec sa femme et son fils. Ils ne se sont pas retrouvés, en fait. Mon oncle était à Beaune-la-Rolande et mon père à Pithiviers. Donc les deux frères ne se sont pas revus.
Pour les visites, je me souviens qu’on avait rendez-vous avec ma tante et on allait de Pithiviers à Beaune-la-Rolande. Je crois qu’on avait le droit une fois par semaine d’apporter des colis. On prenait le train et après, je crois qu’il y avait un petit train ou un autocar qui reliait les deux camps. Je n’arrive pas à me rappeler. Et il y avait d’autres dames du quartier avec des petites amies à moi. Mon père est resté un an là-bas. J’y suis allée pas mal de fois, le jeudi, le jour où je n’allais pas à l’école que je ne voulais pas manquer. De ce camp, j’ai le souvenir de quelque chose de triste parce qu’il y avait des fils de fer barbelé. Et papa qui était toujours très bien habillé, je le voyais habillé de façon plus négligée, ça m’a impressionnée. Je l’avais trouvé amaigri, aussi. Mon souvenir le plus dur, et après je ne l’ai plus jamais revu, c’était en 1942 : je ne savais pas que c’était la dernière fois, il m’a regardée d’une façon très étrange. Et quand je me suis retournée, j’ai eu le sentiment que je ne le reverrais pas de sitôt. Son visage et son regard se sont imprimés en moi. Je me suis retournée plusieurs fois pour le voir. Comme si j’avais senti quelque chose. C’est la dernière fois que je l’ai vu.
Quand on allait le voir à Pithiviers, on entrait dans le camp, mais on n’est jamais sorties avec lui. Par terre, c’était des petits cailloux et de la boue. Mon père n’a jamais voulu que j’entre dans la baraque, on restait dehors, il y avait des bancs, je crois. À Beaune-la-Rolande, c’était pareil.
Mon père me disait qu’il fallait que je travaille bien à l’école, que je sois très gentille avec ma mère, que je ne sois pas soucieuse, qu’un jour il reviendrait à la maison. Il disait qu’il n’était pas tellement malheureux, seulement de ne pas être avec nous, mais qu’à Paris il n’aurait pas pu travailler. Il me disait qu’il fallait que je pense à lui, qu’il pensait toujours à nous. Il parlait plus avec maman. Il y avait des enfants avec nous, on jouait un peu… Mais j’avais toujours envie de prendre mon papa dans les bras, comme si j’avais un pressentiment. À cet âge-là, on ressent les choses, mais on ne peut pas les exprimer vraiment, c’est difficile.
Beaucoup de gens venaient en visite. Ils ne venaient pas tous le même jour. Je crois qu’on avait le droit de rester un certain temps. On pouvait marcher entre les baraques. Les gardiens du camp étaient habillés comme la police française et il fallait montrer les papiers avant de rentrer. Les colis étaient vérifiés, pour voir s’il n’y avait pas, je ne sais pas, des armes ou un marteau… Mais mon père sortait du camp, car là-bas il travaillait à la sucrerie qui était à côté. Il nous donnait du sucre à maman et à moi. Maman disait qu’il lui donnait un peu d’argent. Elle travaillait toute la journée à cette époque-là.
La visite terminée, on allait voir mon oncle avec ma tante, ou bien on allait d’abord à Beaune. C’était le même style de camp. Mon oncle travaillait dans un atelier où ils fabriquaient des objets. Il m’avait fait rentrer dans l’atelier, mais pas dans la baraque. Il m’a fait un petit oiseau sur un bois que j’ai chez moi. Quand mon père était militaire, il m’avait fait un petit cœur, avec sa photo dedans, que j’ai conservé. Dans cet atelier, il y avait des vieilles machines. Je me demande comment il les avait obtenues. En tant que tapissier, mon oncle avait des outils chez lui, certainement des marteaux que ma tante lui avait apportés. Mon oncle avait des migraines et il était souvent à l’hôpital de Beaune, justement avec le père de Camille Zoltobroda. Dans son livre, il parle de mon oncle, L.K.
Ma mère m’a raconté, après la guerre, qu’elle voulait que mon père s’évade, au moment où il allait au travail, mais il n’a jamais voulu. Il était très respectueux de la loi, tout comme mon oncle. Je crois qu’ils ne se rendaient pas compte de ce qui les attendait. Pour eux, ils étaient là, puis ils allaient rentrer à la maison, et tout serait comme avant. C’est l’impression que j’ai toujours eue.
Je me souviens qu’après la guerre, quand j’ai retrouvé maman, on allait à l’hôtel Lutétia, pour voir si on reconnaissait quelqu’un. On demandait, et à cette époque-là, on ne savait pas ce qu’ils étaient devenus. Pour moi, personnellement, mon père n’était pas mort, et je me souviens que, quand je me promenais avec maman, dans la rue, et que je voyais un homme qui ressemblait à mon père, je croyais que c’était lui. J’avais envie d’aller vers lui, je me disais : peut-être il est malade, peut-être il ne nous reconnaît pas. J’ai vraiment fait le deuil de papa quand j’ai eu les documents du CDJC, bien après la guerre, dans les années 50-60. Et même quand ma mère est devenue veuve de guerre, je n’y croyais pas. Pour moi, c’était une chose impossible, qu’il soit mort. C’est après la guerre qu’on a appris qu’il n’était plus à Pithiviers.
Eux ont été déportés en juin et en juillet par les convois 4 pour mon père et 5 pour mon oncle. Puis, il y a eu la rafle du Vel d’Hiv. C’était très tôt le matin, on a entendu beaucoup de bruit à travers les volets, des enfants qui pleuraient. Maman s’est levée tout doucement, elle m’a fait signe de me lever aussi sans faire de bruit, on est rentrées dans la salle à manger, on s’est assises, et quand ils ont tapé à la porte, on n’a pas ouvert. Et on a eu de la chance, parce que, comme on allait souvent avec maman dormir chez ma tante, la concierge a dit : “elle ne doit pas être là, Madame Kaliksztajn va souvent dormir chez sa belle-sœur, avec la petite”. Quand ils sont partis, ma mère est montée chez une infirmière au 3e étage. Elle a pris des affaires, un peu d’argent, et à partir de là, on n’est plus redescendues. Ils sont revenus et ils ont mis les scellés. On est restées une quinzaine de jours chez cette voisine, le temps qu’elle trouve un passeur.
Au milieu de la ligne de démarcation, il nous a laissé tomber, donc on a été obligées de traverser une forêt. On a atterri à Châteauroux en faisant du stop. Maman a trouvé du travail dans un restaurant, et ils nous ont donné une petite chambre, mais quinze jours après, la police nous a prises et on a été transférées au camp de Nexon. Dans ce camp, il faisait très chaud. On y est restées au moins jusqu’à fin août, et un jour, ils ont fait l’appel, et nous avons été transférées à Rivesaltes, dans un train à bestiaux. À la gare, des camions bâchés nous attendaient. On y est restées au moins jusqu’en octobre. On laissait sortir les enfants naturalisés français à condition qu’ils aient un endroit où aller. Comme je parlais bien yiddish, je chantais des chansons en yiddish. Un vieux monsieur, qui m’avait prise en amitié, a dit à ma mère qu’il était naturalisé français, que sa fille allait venir le chercher pour le faire sortir. Ma mère a demandé si elle pouvait me prendre, et sa fille m’a fait sortir.
Ma mère est restée dans le camp. Je ne voulais pas partir, et ma mère m’a dit : “Tu sais, on fait d’abord sortir les enfants et après les grandes personnes” pour ne pas me dire la vérité. Je me souviens qu’il y avait une grande porte, je tenais la main de cette dame et j’avais un petit baluchon. Je me suis retournée, ma mère était de dos, elle pleurait je suppose, et là je suis partie avec cette dame qui, en fait, faisait partie de la Résistance. Elle n’a pas pu me garder chez elle, elle n’avait qu’une pièce et son père a commencé à tousser. Le médecin a dit qu’il était contagieux. Elle m’a lavée, j’avais des poux, j’étais sale et elle m’a emmenée dans un café. Monsieur Trigano, des campings Edgar, qui était dans la Résistance, a proposé de me prendre, et j’ai beaucoup pleuré quand cette dame est partie.
J’ai appris après la guerre que le camp de Rivesaltes avait été fermé à la fin de 1942. Ma mère a été mise à Gurs, puis à Septfonds où elle a été libérée. Ensuite, elle est remontée sur Paris. De 1942 à 1944, je ne savais pas du tout où étaient mes parents. Les Trigano, fin 1943, avaient peur de me garder, parce qu’ils étaient toujours obligés de déménager. Pendant un petit moment, j’ai été dans un couvent. Une dame est venue me chercher, sans doute une résistante. Puis je me suis retrouvée dans une Maison d’Enfants de l’OPEJ, je crois, à Toulouse, où ma mère est venue me rechercher. Je me suis évanouie quand je l’ai retrouvée. Puis j’ai été dans une Maison d’Enfants au Pavillon Joséphine, à Rueil-Malmaison. Maman venait me voir une fois par semaine, elle ne pouvait pas me prendre chez elle, notre appartement était habité par des sinistrés.
En février 1945, elle est revenue me chercher pour mes 11 ans, comme promis. À ce moment-là, on habitait une mansarde, rue Vieille-du-Temple, il faisait froid, et on allait dans les cantines, avec une gamelle, pour chercher à manger. Maman était malade. Je suis retournée dans la même école, rue des Archives. Il a fallu que je rattrape le temps perdu. On m’a appris que la directrice qui était dans la Résistance avait été déportée, et que ma maîtresse, Mademoiselle Dauguet, était morte.
Avec ma mère, on allait à l’hôtel Lutétia. Elle continuait les recherches. Elle ne s’est jamais remariée. Plus tard, elle m’a dit qu’elle n’a pas voulu m’imposer un beau-père, parce que j’aurais été trop malheureuse, j’aimais trop mon père.
Quant à ma tante, le jour de la rafle, elle a ouvert la porte, et elle a été envoyée du Vel d’Hiv au camp de Drancy. Elle a été déportée par le convoi 12, elle est morte à Auschwitz, avec son mari.
Je veux faire ce témoignage pour la mémoire de mon père, et pour qu’il reste quelque chose de cette époque dans l’Histoire. J’ai participé au livre “Paroles d’Etoiles”, à l’Association des Enfants cachés, à celle de Serge Klarsfeld.
Ma fille est au courant de tout. Quand elle a commencé à me poser des questions, je lui ai raconté.
Ma mère est décédée en 1985. Jusqu’à aujourd’hui, je fais toujours des cauchemars. Je suis suivie en psychothérapie, tout le temps, parce que, après la guerre j’étais très nerveuse, très peureuse aussi, je ne pouvais pas supporter que quelqu’un marche derrière moi. Pendant toute la guerre, j’ai eu peur, tout le temps, dans les camps, partout. Ne pas dire qui j’étais, ce que j’étais, toujours mentir, se cacher. J’étais une petite fille très calme et après la guerre, j’étais très nerveuse intérieurement. J’ai l’impression de vivre deux vies à la fois, celle d’avant et celle de maintenant.
Pinkas KALIKSZTAJN par sa petite-fille Francine Aknin
Pinchas, grand-père chéri,
….WITZ. Tu vas me dire : c’est de l’inconscience de couper ce mot, tu es “mechouge” ! Oui, sans doute, mais j’ai délibérément voulu tordre le cou à ce mot insoutenable, insupportable, j’ai tordu, coupé en deux, annulé les premières lettres atroces pour garder la sonorité la plus proche du Mot d’esprit de ce Witz de la yiddischkeit. C’est aussi celui évoqué par Freud, car il symbolise l’imprévisibilité de la langue face à ton destin planifié. Je décide donc singulièrement de choisir le dialogue imaginaire avec toi, d’évoquer le yiddish de Varsovie…. Petit retour en arrière ; je me souviens quand j’allais au lycée, je portais un médaillon autour du cou te représentant jeune et souriant, et il me semble que tu me protégeais, image mythique. Au fil du temps, j’ai cru, comme ma mère, et beaucoup d’autres, que tu allais réapparaître, débarqué d’un monde énigmatique, souffrant d’amnésie, oubliant ton identité et ta famille, parti dans un autre pays, reconstruire autre chose, voire ne nous reconnaissant plus.
Cette croyance a duré très longtemps. Et subitement, après des recherches effectuées par ma mère, ta fille Renée, il n’y a pas très longtemps, j’ai demandé que l’on m’adresse une recherche sur les convois. C’est donc moi qui ai reçu le courrier confirmant “noir sur blanc”, que tu figurais sur une liste de déportés du convoi 4, les dates étaient très précises et qu’apparemment tu as succombé au typhus en juillet 42. Cette annonce ultra violente, qui inscrivait définitivement ton anéantissement, m’a justement… anéantie. Finis les espoirs et rêveries dignes d’un conte cruel. Là il fallait enfin pouvoir faire le fameux travail de “deuil”. Mais ici, il s’agissait d’un deuil très singulier. Je ne t’ai pas connu de ton vivant, tu n’as pas de sépulture, pas de rituels autour de ta disparition. Disparu sans laisser de traces, de façon précise, prévisible, planifiée, dans le drame le plus fou. Voilà ton nom, ton prénom, ta date de naissance dont les lettres explosèrent ce jour-là sous mes yeux. Ce deuil a directement concerné ma mère que toi, Paul pour les Français, tu as eu le bonheur de chérir pendant six ans, et pour qui paradoxalement cette annonce fut un horrible “soulagement”. Bref comment faire avec ce document insupportable ? Certes maintenant je peux mieux affronter ton corps sur les photos, ton visage, ton sourire, détailler chaque morceau de toi, tes vêtements, tes cheveux, tes traces charnelles… et pourtant je ne veux pas y croire. Tout ce qui a pu être archivé, évoqué, lorsque par exemple en père très sérieux, discret et élégant, tu allais à la synagogue de la rue Pavée, ou très souvent au cinéma, aux Tuileries ou dans tel café rue de Rivoli qui existe toujours. D’ailleurs aujourd’hui, il suffit que tu traverses la rue et pas très loin, tu arriveras au Mémorial de la Shoah. Ton nom est enfin inscrit sur un mur symbolique, puis tu rentres et dans le hall, là Sarah, ton épouse et ta fille Renée apparaissent sur une très grande photo. En dehors de ton métier de tailleur, tu prenais des cours de français à l’école Berlitz, ce dont témoignent tes cartes postales sans faute de français. Je sais où tu as vécu, rue du Bourg-Tibourg, ton amour inconditionnel pour Sarah et “Ronchele”, ton amour inconditionnel pour la France. Mais parfois, je t’en veux de ta naïveté à t’être rendu à la convocation du “billet vert”, ou d’avoir refusé de t’exiler aux Etats-Unis comme deux de tes frères. Figure toi que j’ai cité ton nom à Yad Vashem à Jérusalem, même si pour moi cela restera “Jérusa-larme”. Mais au fond de moi-même, comme dans l’ombilic du rêve, il reste quelque chose d’inaccessible, d’insaisissable. Tu t’es inscrit dans ma mémoire inconsciente. Je préfère rester à présent dans une sorte d’amnésie flottante de cet épisode brutal. Alors voilà la langue, le yiddish, l’humour, les lapsus, l’imprévisible comme je le disais, qui font que dans notre échange, nous deux seuls pouvons comprendre les sous-entendus, l’ironie, le tragique, notre complicité tient avec cette langue et cette identité. Je choisis de garder ce mode de pensée dynamique vivante et poétique. Le Witz m’apporte effectivement comme le souligne Freud une “satisfaction purement fantasmatique à des pulsions terribles et violentes que la civilisation dissimule”. ...No comment... Figure toi que je suis psychanalyste ! Tu te demandes quel est ce “jargon”, c’est justement la “langue” psychanalytique qui entre autre m’a un peu sauvée de l’intolérable. Ainsi, je choisis une logique “inconsciente”, involontaire. Tu es mort en 1942, je suis née en 1957, un “fossé” nous sépare… Mais, Pinchas, tu triompheras en héros scintillant. Tu es mon “SuperMensch”. Continue à me parler, je t’écoute… comme André mon mari et ton arrière-petit-fils, Pierre-Paul.
Témoignages recueillis en 2011
PINKAS KALIKSZTAJN
Interné au camp de Pithiviers à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 25 juin 1942 par le convoi 4
Assassiné à Auschwitz le 25 juillet 1942 à l’âge de 36 ans
RENÉE OLESINSKI
Fille de Pinkas Kaliksztajn
Née en 1934 à Paris 4e
FRANCINE AKNIN
Petite-fille de Pinkas Kaliksztajn
Née en 1957
-

Pinkas Kaliksztajn au 1er plan dans un atelier de tailleur (sd, sl). Archives familiales
-

De gauche à droite, Pinkas Kaliksztajn, son épouse Sarah et son frère Leib Kaliksztajn en 1932. Archives familiales
-

Pinkas Kaliksztajn, engagé volontaire, incorporé à Septfonds (entre le 9 mai 1940 et le 12 septembre 1940). Archives familiales
-

Médaillon fabriqué à Septfonds et offert par Pinkas Kaliksztajn à sa fille Renée. Dimensions 33 x 2 x 27 cm. Inscription au recto : « Pour ma Renée Chérie ». Inscription au verso : « Septfonds le 14 VII 1940 ». Collection familiale – photo © Géraldine Aresteanu
-

Médaillon fabriqué à Septfonds et offert par Pinkas Kaliksztajn à sa fille Renée. Dimensions 33 x 2 x 27 cm. Inscription au recto : « Pour ma Renée Chérie ». Inscription au verso : « Septfonds le 14 VII 1940 ». Collection familiale – photo © Géraldine Aresteanu
-

La famille Kaliksztajn, Renée et ses parents, Pinkas et Sarah, au jardin des Vosges (1940). Archives familiales
-

Au camp de Pithiviers. Pinkas Kaliksztajn est debout, le 1er à droite (hiver 1941-1942, sd) Srul Aronczyk est le 2e assis en partant de la droite. Archives familiales
-

Petite planche en bois gravée, fabriquée au camp de Beaune-la-Rolande, figurant un oiseau et un palmier, offert par Leib Kaliksztajn à sa nièce Renée. Dimensions 95 x 22 x 68 mm. Inscription au recto : « L. K. / 14.V.41 ». Inscription au verso : « SOUVENIR DU CAMP / Beaune-la-Rolande / 28 juin 1941 / à ma chère petite nièce / Renée ». Collection familiale – photo © Géraldine Aresteanu
-

Petite planche en bois gravée, fabriquée au camp de Beaune-la-Rolande, figurant un oiseau et un palmier, offert par Leib Kaliksztajn à sa nièce Renée. Dimensions 95 x 22 x 68 mm. Inscription au recto : « L. K. / 14.V.41 ». Inscription au verso : « SOUVENIR DU CAMP / Beaune-la-Rolande / 28 juin 1941 / à ma chère petite nièce / Renée ». Collection familiale – photo © Géraldine Aresteanu
-

Renée Olesinski, fille de Pinkas Kaliksztajn, et sa fille Francine Aknin (16 février 2010) photo © Géraldine Aresteanu