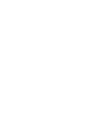Abraham ZOLTOBRODA
par son fils Camille Zoltobroda
Mon père Abraham Zoltobroda, né en 1905, était originaire de Garwolyn en Pologne, une petite ville à côté de Varsovie où ses parents avaient acheté une maison qui servait de sanatorium pour les “gens pulmonaires”, comme disait mon père, et cette maison se trouvait en pleine forêt, d’où le bienfait de l’air pur pour ces gens-là. Mes grands-parents étaient très religieux, c’est pourquoi ils ont insisté pour qu’il aille faire ses études dans une yeshiva. Il a été écœuré par l’attitude des gens qui l’hébergeaient et qui ne faisaient pas grand cas des personnes elles-mêmes.
À 19 ans, il est parti avec quelques bagages vers l’ouest, pour Berlin, dans l’idée certainement d’aller plus loin, ce qu’il a fait par la suite. Il fallait bien manger, il a donc trouvé une place dans une usine de chaussures où il cousait les empeignes de chaussures à la machine. Il y est resté quelque temps et a pris la décision d’aller encore plus loin, cette fois-ci à Paris, où il est arrivé sans un sou. Ses premiers jours et ses premières nuits, il les a passés devant les galeries Barbès : à cette époque, devant le magasin, il y avait des tables et des chaises en bois où les gens pouvaient s’asseoir, discuter, manger peut-être. Lui ne mangeait pas, il venait le soir pour dormir, accoudé sur la table.
Il avait laissé en Pologne toute sa famille, ils étaient neuf en tout, dont des sœurs mariées avec des enfants. C’était une grande et belle famille. Il était l’aîné, ce qui lui donnait le “droit” de faire un peu ce qu’il voulait parce qu’il savait que les autres étaient vraiment à la charge des parents qui n’étaient pas riches du tout.
Quand il est arrivé à Paris, il ne connaissait personne. A Berlin, peut-être que quelqu’un lui avait donné une adresse à Paris. Il a pu entrer en contact avec une tante de ma mère qui habitait dans le 18e arrondissement. Chez elle, il a rencontré ma mère qui était divorcée parce que son mari la battait. Elle était remontée à Paris, avec sa fille Sarah. Mes grands-parents maternels, venus d’Estonie, habitaient Bordeaux d’où ils ont été déportés par Papon.
Mes parents parlaient yiddish, mon père, un très mauvais Français, ma mère qui avait eu son certificat d’études en France lisait et écrivait parfaitement. Elle avait dû venir en France vers sept ou huit ans avec ses parents. Ma mère était née à Stockholm en 1908, puis mes grands-parents sont allés à Londres, Paris, enfin Bordeaux.
Mon père était bourré de bon sens et d’une bonté extraordinaire, il l’a prouvé tout au long de sa vie, y compris dans le camp de Beaune-la-Rolande où il a fait tout ce qu’il pouvait pour soulager certains de ses coreligionnaires.
Quand mes parents se sont mariés, ils ont trouvé un appartement, sans aucune commodité, dans une vieille bâtisse, rue des Partants, à côté du cimetière du Père-Lachaise. Mon père a accueilli sa femme qui avait déjà une fille, ma sœur Sarah qui avait 8 ans de plus que moi. Ils ont travaillé dur, puis peu de temps avant la guerre, mon père a trouvé une petite maison au Perreux-sur-Marne qu’un monsieur Pisani voulait vendre. Il a pris un crédit qu’il a voulu rembourser avec son travail. On a déménagé en 1939, et en 1941, mon père n’a pas pu continuer à payer puisqu’il était au camp de Beaune-la-Rolande. La maison a été fermée en 1942 lorsque ma mère, ma sœur et moi sommes partis pour tenter de passer la ligne de démarcation. Nous avons retrouvé la maison à la Libération avec les portes fracturées et les meubles cassés. Le propriétaire n’a fait aucun problème pour que mon père puisse continuer à payer quand il le pouvait, ce qui a été une chance pour nous. Au Perreux, mon père était tailleur pour dames et on était vraiment heureux dans cette maison jusqu’à ce que mon père reçoive ce “billet vert”.
J’avais sept ans. Je me souviens très bien de ce moment où nous avons été accompagner mon père au commissariat de Nogent-sur-Marne. On a dit à la famille de retourner chercher de la nourriture pour une journée et des vêtements. Le commissaire principal de Nogent-sur-Marne était un client de mon père, il venait se faire tailler des costumes sur mesure, mais il a fait semblant de ne pas le reconnaître. Il se sentait certainement responsable. On est restés quelques moments avec mon père, lui derrière les grilles, et nous sommes rentrés à la maison au 31 avenue des Champs-Elysées au Perreux, maintenant avenue Gabriel Péri. On a eu des nouvelles de mon père quelque temps après. Nous sommes allés, ma mère et moi, lui rendre visite en train à Beaune-la-Rolande, peut-être deux ou trois mois après. En arrivant, je me souviens avoir vu des baraques. Ma mère avait acheté une bouteille de vin vieux, un “remontant”. Sur la gauche, il y avait une petite baraque avec des gendarmes qui filtraient. Ils ont pris le vin. On a vu mon père, on a dû rester trois ou quatre heures. Naturellement, ils n’ont pas rendu la bouteille.
Ma mère a continué à travailler dans la couture, à la machine et à la main. Elle remplaçait mon père pour le peu de travail qu’il y avait. Et cela n’a duré que jusqu’au moment où on est venus nous chercher en 1942. Jusque-là, on vivotait.
J’ai porté l’étoile jaune. Je me souviens qu’il y avait un ordre d’aller chercher ces étoiles et de les coudre sur chacun des vêtements de ma sœur, de ma mère et de moi-même, de façon que ce soit visible sur le côté gauche. Et ces étoiles étaient échangées contre des points textiles. Ma mère a cousu une étoile sur ma blouse d’écolier. La première fois que je suis entré avec cette étoile, il fallait passer dans un préau et pour aller dans la cour, il y avait derrière la porte un gamin dont le père était ferrailleur. Il a proféré “sale jude”. Je n’ai pas réagi car je n’ai pas fait la liaison entre jude et juif. J’ai vu mes copains dans la cour qui n’ont rien dit et en entrant dans la classe, quelques-uns sont venus, sans une parole, m’apporter une gomme, un crayon, un carnet, en signe de sympathie. L’instituteur n’a rien dit et les a laissés se déplacer.
C’étaient des moments perturbants pour nous tous. Je me souviens que quand on allait sur Paris ou même au Perreux, il fallait laisser la place libre quand on voyait un Allemand venir en sens inverse. Dans le métro, je me souviens qu’il fallait aller dans le wagon de queue.
On n’avait pas beaucoup de nouvelles de mon père. Comme il avait été malade auparavant, il avait eu, je crois, une inflammation du cervelet, je sais que ma mère essayait d’avoir des certificats médicaux, surtout quand il a été transféré de Beaune à l’hôpital. Un médecin, le Dr Berman, avait fait un certificat. Cette maladie était apparentée à de la folie, cela n’en était pas, mais il ressentait des choses dans la tête. Son raisonnement était bon, mais il devait beaucoup souffrir. Il avait été hospitalisé. C’était un peu le secret de famille.
À Beaune, il s’est débrouillé pour être interné dans un asile de fous. Il sentait que ça pouvait lui être bénéfique parce qu’il voyait des internés qui partaient régulièrement en train, et il savait par une radio qu’ils avaient écoutée dans le camp qu’il y avait des camps de concentration en Allemagne réservés aux Juifs. Il a fait des pieds et des mains, il a réussi et peut-être cette maladie qu’il avait eue avant l’a aidé pour simuler. Quand il a dit qu’il était très malade et qu’il ne pouvait pas rester dans le camp, ce sont des médecins juifs internés qui l’ont examiné et ont décidé de le garder parce qu’il n’était pas bien dans sa tête. Il a simulé la folie, il a aggravé ce qu’il ressentait et, au bout d’un certain temps, il a été muté à l’asile psychiatrique de Semoy, lui et d’autres internés à qui mon père avait conseillé de simuler la folie pour partir de ce camp. Ils étaient entre huit et dix. Ils ont été en autocar de Beaune-la-Rolande à Fleury-les-Aubrais et beaucoup ont été choqués de voir ces gens qui étaient vraiment fous. Quelques-uns ont tout fait pour retourner au camp. Ils ont été écoutés, hélas pour eux, car ils ont été déportés.
Une fois arrivé à l’hôpital psychiatrique, on l’a mis dans une chambre avec des draps, ce qui était extraordinaire par rapport à ce qu’il venait de vivre au camp. On lui a fait passer des tests pour savoir s’il était vraiment fou. Le médecin a tout de suite vu que ce n’était pas le cas et il l’a pris un peu en amitié parce qu’il aidait les infirmiers à soigner les vrais fous. Mon père me racontait les scènes où les fous subissaient les électrochocs et c’est lui qui les ramenait dans leur chambre. Ces infirmiers ont été extraordinaires. Ils ont noué des liens du fait de leur appartenance communiste, ce qui a permis à mon père d’avoir de la nourriture en plus. Il nous a même envoyé des colis de haricots alors que nous étions à Lacaune-les-Bains en résidence surveillée.
Pour mon père, là-bas, ça s’est passé plutôt bien. J’ai appris, plus tard, lorsque j’ai été récupérer des documents à Fleury qu’il a fait quelques allées et venues entre l’hôpital de Beaune et Fleury. Il y est resté un peu après la libération de Paris. À ce moment-là, il a demandé au médecin chef, le docteur Caron, de pouvoir partir. Après un court séjour à Sainte-Anne, il est allé directement au Perreux. Quand mon père est sorti, il a même vu des officiers allemands morts dans des coins de rue. Il avait pu récupérer un poignard sur un officier allemand dont la lame était gravée avec les mots “sang et honneur”. Au Perreux, la porte avait été cassée, et les meubles fracassés. Mon père a dormi dans la maison, grande ouverte.
En juillet 1942, le 16 au matin, ma mère avait décidé d’aller faire la queue pour les œufs, avec l’étoile jaune bien en vue. Sur ces entrefaites, deux policiers en civil entrent dans la maison où nous habitions et ma sœur a dit que ma mère était partie à Paris faire des courses. Ma sœur m’envoie prévenir ma mère d’aller se cacher. On est allés se cacher chez un plombier qui avait fait des travaux chez nous. On est restés deux ou trois jours chez des connaissances. Nous avons pris le train pour rejoindre mes grands-parents à Bordeaux. Puis ma mère a décidé de passer la ligne de démarcation dans un village qu’on connaissait. Et pour passer la ligne française, ma mère s’est mise à genou devant ce gendarme français qui ne voulait pas nous laisser passer. Il nous fait monter dans un camion qui nous emmène à Laréol, dans un grand bâtiment.
Ma mère a été envoyée au camp de Rivesaltes. Nous avions une tante qui habitait à Pau et nous sommes restés dans sa chambre d’hôtel. Nous sommes allés voir ma mère à Rivesaltes. Ma mère a tout fait pour tenir le coup. Ceux qui avaient deux enfants français pouvaient sortir du camp et être mis en résidence surveillée. Nous avons été assignés à Lacaune-les-Bains. Ma mère a pu envoyer une carte-lettre à mon père pour lui dire où nous étions, c’est là qu’il nous avait envoyé des flageolets. Ma mère faisait des raccommodages, j’allais à l’école communale avec mon cousin qui était avec nous.
À la Libération, nous sommes rentrés au Perreux. Je m’attendais à ce que mon père nous fasse la fête. Mais il est resté distant. Il s’est rattrapé après. Mon père a gardé des contacts avec certains infirmiers. Il était resté pratiquement le seul des internés de Beaune.
Grâce aux archives, j’ai appris des détails intéressants. Par exemple, je ne savais pas que mon père avait été malade avant la guerre. Au Havre, j’ai trouvé les carnets de mon père, écrits en yiddish. Ma mère les a traduits, en ajoutant ce qu’elle avait ressenti.
Mon père est décédé en 1993, ma sœur en 1983.
Je suis très fier que mon père ait eu la présence d’esprit d’avoir pu faire ce récit, par le menu.
Mon fils sait, mais ma fille ne veut rien écouter. L’important est qu’ils sachent et qu’ils sachent se défendre. Je n’ai pas pu retranscrire la douleur, simplement les larmes au cours du récit, mais ça ne s’écrit pas.
Témoignage recueilli en 2009
ABRAHAM ZOLTOBRODA
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Interné à l’hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais à partir d’août 1941, puis de février 1942
Décédé en 1993 à l’âge de 88 ans
CAMILLE ZOLTOBRODA
Fils d’Abraham Zoltobroda
Né le 17 juin 1934 à Paris 20e
-

Abraham Zoltobroda à l’âge de 18 ans (1923, sl). Archives familiales
-

Extrait du registre des internés du camp de Beaune-la-Rolande (1941-juillet 1942). Archives départementales du Loiret – 175 W 34120
-

Certificat de présence au camp de Beaune-la-Rolande établi au nom d’Abraham Zoltobroda (15 juillet 1941). Archives familiales
-

Petit chien sculpté fabriqué au camp de Beaune-la-Rolande en 1941 par un co-interné d’Abraham Zoltobroda. Bois sculpté et peint. Dimensions 6 x 5 x 2 cm. Collection Cercil N°INV 161 / fonds famille Zoltobroda – donation Camille Zoltobroda. Photo © Géraldine Aresteanu
-

Abraham Zoltobroda (à droite) à l’hôpital psychothérapique de Fleury-les-Aubrais, avec deux infirmiers, dont au centre, Marcel Tinseau qui l’a pris en amitié. Archives familiales
-

Certificat de séjour d’Abraham Zoltobroda à l’hôpital Sainte-Anne à Paris (25 septembre 1945). Archives familiales
-

Camille Zoltobroda posant avec le petit chien sculpté au camp de Beaune-la-Rolande (8 décembre 2010). Photo © Géraldine Aresteanu