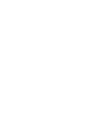Aron-Szya FALCMAN
par sa fille Berthe Burko-Falcman
Mon père, Aron-Szya Falcman, l’un des Juifs étrangers piégés par le “billet vert”, en yiddish : dos grine tsetl, expédiés dans les camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers le 14 mai 1941, était arrivé en France le 15 juillet 1932. Il venait de Pologne. Il était né le 15 août 1907 à Strykow, une petite ville voisine de Lodz. Son père, Michal Falcman, un homme de grande piété, travaillait dans une fabrique de textile. De sa mère, Brukha, morte quand il avait onze ans, je ne sais rien. Aron avait une sœur et un jeune frère né du second mariage de son père. D’eux non plus, je ne sais rien. Michal souhaitait que son fils aîné devienne rabbin. Alors, après le heder, Aron, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, fut étudiant dans une yeshiva (école talmudique). Puis il l’a quittée. Il a appris, bon gré mal gré, le métier de tailleur. Il s’est syndiqué et a milité au Bund où il a rencontré ma mère Rayzl Guterman.
Rayzl travaillait dans un atelier de haute couture. Elle gagnait bien sa vie et aimait son travail. Mais l’antisémitisme polonais l’a décidée à quitter la Pologne pour la France où était installée sa sœur cadette. Elle attendait son passeport depuis pas mal de temps lorsque Aron l’a demandée en mariage. Le passeport est arrivé, Rayzl a acheté son billet pour Paris et Aron l’a rejointe l’année suivante.
Ces bribes de mon histoire familiale m’ont été racontées. Elles sont pauvres de détails, mais cohérentes, bien plus que mes premiers souvenirs confus et désordonnés. C’est la date du 13 mai 1941 qui met de l’ordre et installe définitivement la chronologie dans ma mémoire. Ce 13 mai, un mardi je crois, en fin d’après-midi sans doute puisque je suis à la maison, donc rentrée de l’école, tout commence.
J’ai six ans depuis le 15 février. On frappe à la porte. D’habitude, c’est le dimanche que les amis viennent. Ces coups frappés en semaine, quand tout le monde travaille, ont dû paraître insolites car mon père et ma mère quittent, elle, la machine à coudre, lui, la table de coupe. Et moi, je les suis. Tous les trois, nous sommes devant la porte. Je ne sais plus qui l’ouvre. Un agent de police se tient dans l’encadrement, sur le petit palier. Il semble embarrassé, il tend une feuille verte à mon père en demandant : “Falcman ?”. Il dit encore quelque chose. Puis il s’en va. La porte fermée, j’ai le souvenir d’un grand silence. Et je sens l’inquiétude de mes parents. Ils la disent en polonais et je ne comprends pas, puis en yiddish, la langue naturelle à la maison. Là, je comprends que mon père doit se rendre le lendemain matin très tôt au commissariat du quartier. Mes parents se concertent et Aron décide d’aller voir des camarades du Bund installés dans le voisinage afin de savoir s’ils ont eux aussi une convocation et s’ils comptent s’y rendre. Dans la soirée, Moïshè C., un autre camarade, vient prendre conseil auprès de mon père, il a reçu la convocation, il ne sait pas quoi faire. De mon lit, je les entends qui discutent. Et je sens qu’il va arriver un malheur à mon père.
Le lendemain matin, je ne vais pas à l’école, j’accompagne mes parents au commissariat. Le soleil dans la rue m’aveugle, il faut dire que notre logement est particulièrement sombre. Je n’ai aucun souvenir de ce qui s’est passé à la police ni comment nous avons pris congé de mon père. Quand avec maman nous retournons à la maison, nous croisons la concierge au bas de l’escalier qui mène à sa loge. Elle a entendu ma mère lui crier très fort “cordon s’il vous plaît” pour qu’elle ouvre la porte sur la rue quand nous sommes sortis ce matin. Alors elle veut savoir pourquoi les Falcman sont partis si tôt et où ils sont allés. Maman lui explique : et qu’on n’a plus laissé son mari quitter le commissariat, on l’a empêché de sortir, et plus maman parle, plus elle devient véhémente. Elle dit que la police a gardé son mari comme s’il était un voleur. Elle dit que son mari n’est pas un voleur, que c’est un homme qui travaille et qu’il s’est engagé volontaire pour la France, qu’il a été soldat pour la France, que ça c’est pas normal de l’empêcher de sortir. L’après-midi, je retourne à l’école.
Et puis, dans les jours qui viennent, ma mère reçoit des lettres de Pithiviers, le camp où est interné mon père. C’est moi qui les lis à haute voix car mon père les a écrites en français et maman a du mal à lire le français écrit, et aussi à l’écrire. Alors elle me dicte les réponses en yiddish et moi je les écris en français, à cause de la censure. Dans chacune de ses lettres, toujours très tendres, Aron répète : “j’ai bon moral”. Il écrit également des lettres en yiddish, mais j’ignore par quelle voie elles arrivent. Dans une de ces lettres, il raconte à Rayzl comment, à l’occasion de Pourim (probablement au printemps 1942), il a lu la Méguila d’Esther pour ses camarades de la baraque 3. Mon père, un bundiste ancien étudiant de yeshiva, animant une commémoration rituelle qui évoque la délivrance des Juifs, la punition d’Aman, cela amuse Rayzl et je ne comprends pas pourquoi. À l’époque, j’ignore ce qu’est Pourim, qui est Aman, J’ignore tout de la tradition juive, mes parents sont strictement laïques. Ils parlent yiddish avec leurs camarades, ils me parlent en yiddish et moi, je crois que parler yiddish, c’est ce qui nous fait Juifs. Avec le temps, j’ai compris cette lecture de mon père comme une lecture d’espoir, et Aman, une métaphore de Hitler.
Dans la baraque 3, Aron est avec d’autres bundistes si j’en crois une photo de groupe envoyée de Pithiviers. Il y a le matricule 342. Du camp, il m’envoie un porte-plume-coupe-papier en bois, incrusté des visages photographiés de mon père, de ma mère et de moi. Les baraques qui servent de dortoirs aux internés y sont esquissées à la plume. C’est un interné qui a fabriqué l’objet. Un autre interné a reproduit au fusain une photo posée spécialement pour Aron où nous figurons maman et moi. J’ignore par quelle chance j’ai encore le porte-plume-coupe-papier et le dessin au fusain signé Reisz.
Tandis que mon père est à Pithiviers, Rayzl, à deux reprises, me laisse chez des camarades bundistes, les Szwarzstein, sans m’en expliquer la raison. Je l’ai sue environ cinquante ans plus tard par leur fille Odette : à Pithiviers, le 14 juillet 1941, les internés avaient refusé de travailler pour cause de fête nationale de leur pays d’accueil. Afin de les punir, on les avait privés de courrier et de colis. Informées je ne sais comment, les compagnes et les mères des détenus étaient venues protester contre la sanction devant le camp. Rayzl en fut. J’imagine que la sanction a été levée car, dans mon souvenir, ma mère n’a jamais cessé d’envoyer des colis à son mari. Elle utilisait des petites caissettes en bois. Au fond de la caissette, elle posait une lettre écrite en yiddish, elle la recouvrait d’un papier et remplissait ensuite la boîte. Je sais que des camarades l’ont aidée pour qu’elle ait toujours de quoi remplir les caissettes.
À la fin du mois de juillet 1941, maman reçoit par la poste l’autorisation de rendre visite à Aron. J’ai oublié comment nous sommes arrivées à Pithiviers. Je me souviens que nous sommes déjà dans le camp lorsqu’apparaissent les pères, les fils, les maris, les fiancés. En rang. Ils viennent de l’extérieur, des gendarmes les encadrent. L’instant des retrouvailles, je l’ai oublié. Mais je nous vois ensemble dans la baraque 3. Il y fait sombre. Je découvre les châlits. Mon père et ma mère sont assis sur la paillasse du lit inférieur, ce devait être la place de mon père. Aron enlace Rayzl. Ils s’embrassent. Je sors rejoindre d’autres enfants. Un garçon raconte que la soupe au camp, c’est comme de l’eau de vaisselle, c’est son père qui l’a dit. Puis je me promène toute seule. J’ai oublié le moment de la séparation : les visiteuses et les enfants sont devant les baraques et regardent les hommes s’éloigner en rang, comme ils sont arrivés, avec les gendarmes. Il me semble que mon père s’est retourné pour nous voir encore. Moi, j’ai pensé : je ne le reverrai jamais. Je l’ai vraiment pensé. J’ai toujours entendu Rayzl répéter le refus de mon père de s’évader par crainte des représailles contre sa fille et sa femme. Je me demande encore si ma mère n’est pas revenue voir mon père d’autres fois, peut-être est-ce pour cela qu’elle m’a encore laissée chez les parents d’Odette. Elle ne m’en a jamais parlé.
Entre la visite à mon père pendant l’été 1941 et ce qui s’est passé durant l’été 1942, je n’ai pas de souvenirs, sinon qu’un soir, ce devait être après le couvre-feu imposé aux Juifs, il faisait encore jour et je jouais dans la rue avec d’autres petites filles, ma mère est arrivée sur le trottoir, elle m’a arrachée de la marelle où je sautais, elle m’a entraînée chez nous. Elle était comme folle de terreur.
Et puis en juin 1942, sans doute afin de m’épargner le port de l’étoile à l’école, maman m’a envoyée chez une nourrice en Normandie. Je devais y rester deux semaines. C’est alors que mon père, informé je ne saurai jamais ni par qui ni comment, a écrit à Rayzl de ne pas me ramener à la maison, il se préparait quelque chose de grave : “nem nisht aheïm dos kind”. Ma mère a alors fait écrire à la nourrice de me garder deux mois encore, le temps des grandes vacances. Et c’est ainsi que j’ai échappé à la rafle du Vélodrome d’Hiver. Le 16 juillet 1942, des policiers français sont venus nous chercher. J’aurais été la maison, maman m’aurait prise par la main et nous les aurions suivis. Seule, elle s’est rebiffée, elle a refusé d’obéir, elle a hurlé qu’elle ne partirait pas sans sa fille, “sans ma tête j’irai, pas sans mon enfant ” m’a-t-elle souvent raconté. Les policiers lui ont dit de se calmer, de préparer sa valise et qu’ils reviendraient plus tard. Ma mère s’est calmée, a préparé sa valise, on a frappé à sa porte, elle a ouvert et alors, comme un miracle : une amie était sur le seuil. Femme de prisonnier de guerre, donc intouchable encore à cette époque, elle a emmené Rayzl se cacher. C’est sûr, Aron ne s’est pas évadé de Pithiviers, mais depuis le camp, il a sauvé les vies de sa femme et de sa fille. Avant d’être déporté, il a envoyé à Rayzl un petit paquet qui contenait sa montre. Et le temps s’est arrêté.
Dans le Mémorial de Serge Klarsfeld, le nom de mon père figure sur le deuxième feuillet de la liste alphabétique du convoi 4 parti le 25 juin 1942 de Pithiviers. Aron Falcman est le trente-cinquième de la colonne de gauche. À Auschwitz où il est arrivé le 27 juin 1942, son bras a été tatoué du n°42037. D’après les Fragments du registre des décès à Auschwitz, il serait mort le 16 août 1942, le lendemain de son trente-cinquième anniversaire. Il y est inscrit comme le 21196e mort de l’année 1942.
Témoignage recueilli en 2008
Aron-Szya Falcman
Interné au camp de Pithiviers à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 25 juin 1942 par le convoi 4
Assassiné à Auschwitz le 16 août 1942 à l’âge de 35 ans
Berthe Burko-Falcman
Fille d’Aron-Szya Falcman
Née le 15 février 1935 à Paris
-

Cinq soldats, tous camarades au Bund. Aron Falcman, debout au centre, pose sa main sur l’épaule de Mendel Gliksman (1939-1940, sd, sl). Archives familiales
-

Aron Falcman, soldat, pose sa main sur l’épaule de Mendel Gliksman (1939-1940, sd, sl). Archives familiales
-

Au camp de Pithiviers, un groupe de Bundistes. Aron Falcman est au dernier rang, le 3e en partant de la droite (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Porte-plume en bois fabriqué au camp de Pithiviers (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Dimensions 237 x 20 x 33 mm. Inscription au recto : “A MA CHERE FILLE Berthe / EN SOUVENIR DE TON PAPA”. Inscription au verso : “SOUVENIR DU CAMP DE / PITHIVIERS / 1941-1942”. Archives familiales – Photo © Géraldine Aresteanu
-

Porte-plume en bois fabriqué au camp de Pithiviers (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Dimensions 237 x 20 x 33 mm. Inscription au recto : “A MA CHERE FILLE Berthe / EN SOUVENIR DE TON PAPA”. Inscription au verso : “SOUVENIR DU CAMP DE / PITHIVIERS / 1941-1942”. Archives familiales – Photo © Géraldine Aresteanu
-

Portrait au fusain de Rayzl et Berthe Falcman, fait au camp de Pithiviers par Franz Reisz à partir d’une photo prise en 1941 (1942). Dimensions 23,3x22,5 cm. Inscription sur le dessin : “REISZ / CAMP DE / PITHIVIERS /1942”. Archives familiales – Photo © Géraldine Aresteanu