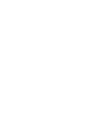Israël PESSES
par Albert Pesses, son fils
J’étais jeune alors, à peine sept ans, et mon esprit ne mesurait pas encore la gravité des choses. La présence des Allemands à Paris avait plus éveillé ma curiosité qu’elle ne l’avait effrayée.
J’ai néanmoins conservé le souvenir de cette journée du 14 mai 1941 où les Juifs étrangers (mon père était Polonais, et qui plus est, apatride) étaient convoqués par la Préfecture de police, à cause d’une vive discussion qui opposa mon père et ma mère. Ma mère lui déconseillait de s’y rendre ; lui, mettait cette convocation du “billet vert” au compte des multiples tracasseries administratives qui avaient jalonné son existence, en Belgique comme en France, depuis qu’il avait fui la Pologne pour échapper à un procès politique.
Il s’y rendit et ne rentra pas à la maison. Mais il ne fut pas tout de suite conduit à Pithiviers, et il y avait là un mystère que je n’ai débrouillé que récemment en consultant les archives du Centre de Documentation Juive, au Mémorial de la Shoah.
Je me souvenais qu’on lui rendait visite, ma mère, ma sœur et moi, avant qu’il aille à Pithiviers. Quand il s’y est trouvé, ma mère y allait seule ou, une fois, en compagnie de ma sœur aînée.
Les archives ont confirmé ces vieux souvenirs : un document mentionne son arrestation le 14 mai 1941 alors qu’un autre signale son entrée à Pithiviers le 12 août 1941, soit trois mois plus tard. C’est au cours de la réunion récente, du 18 décembre au Mémorial, initiée par Monique Novodorsqui et Rachel Jedinak, où j’ai posé la question de cette anomalie, que j’ai reçu en réponse un écho analogue. Un membre de l’assistance avait connu avec son père la même situation et il a avalisé le souvenir confus de ma sœur et de moi-même, que ce premier lieu d’internement était à la porte des Lilas, peut-être la caserne.
Au cours de ces trois mois passés aux Lilas, un soir, alors que nous rentrions d’une visite à mon père, nous avons retrouvé la porte fracturée et le logement retourné. Des voleurs étaient passés et avaient dérobé le peu d’argent que ma mère y avait laissé. Des vautours s’ajoutaient aux bêtes de proie qui nous menaçaient.
Nous avons deux photos de mon père à Pithiviers. On le voit en compagnie de quatre autres détenus avec des instruments de terrassement à la main. La seconde est une photo de groupe où on distingue difficilement son visage. Quand ma mère partait lui rendre visite, j’étais, le plus souvent, confié à la garde de ma sœur aînée, Berthe.
Puis, nous avons échappé à la rafle du 16 juillet 1942 en abandonnant notre logement à l’aube, ma mère ayant été prévenue. Trois semaines plus tôt, mon père était déjà parti avec le convoi 4 pour mourir un mois après son arrivée à Auschwitz, mais cela nous ne l’avons appris que beaucoup plus tard, la guerre terminée.
Notre sort, à ma sœur Berthe et moi, a été celui des enfants cachés. Ma mère nous a trouvé un abri temporaire de quelques semaines dans une gargote des quais de Seine, tenue par deux femmes compatissantes qu’elle connaissait. Elle nous a quittés pour chercher une solution plus durable et je pense qu’elle est entrée en contact avec l’OSE. Une personne est venue nous chercher et nous a emmenés en train à Héricy, nous recommandant de prétendre voyager seuls, alors qu’elle nous surveillait à distance. Héricy est un village près de Fontainebleau et nous avons été confiés à une vieille dame, nullement charitable, qui s’était fait une source de revenus de garder des enfants de toute sorte, sept en tout, nous compris. Elle nous faisait vivre dans des conditions plutôt rudes, toujours dehors, été comme hiver, sauf pour les repas et le sommeil. Elle n’était pas en peine, non plus, de tenir des propos antisémites, tout comme de favoriser les antagonismes entre nous, les enfants qu’elle gardait.
Au bout de dix mois, on est revenu nous chercher. L’instituteur du village avait été arrêté par la Gestapo pour faits de résistance, et le village n’était plus sûr. À nouveau, une femme de l’OSE clandestine est passée nous prendre pour nous conduire dans une petite ville, Brou, près de Nogent-le-Rotrou, qui a d’ailleurs été un lieu de refuge pour de nombreux enfants juifs. Cette fois-ci, nous étions hébergés par une femme qui se disait veuve pour ne pas dire qu’elle était divorcée d’avec son mari dont elle portait toujours le nom, Leroux. Elle avait trois filles : Édith et Éliane, adolescentes, Claudine venait de décéder avant notre arrivée. Son fils Serge était marié et réfractaire du STO. Cette femme était gentille et nous avons mené, avec ses filles, la vie des Français de l’époque, avec un peu moins de restrictions, grâce à un jardin et un poulailler que nous avions plaisir à entretenir.
L’école nous avait acceptés en cachant le fait que nous étions juifs. Il est probable que la mairie protégeait les enfants juifs car nous avions sans difficulté des cartes de rationnement. Il y a eu à plusieurs reprises des descentes de police pour arrêter des Juifs mais elles faisaient sans doute l’objet de discrets avertissements, car elles étaient toujours infructueuses. On nous faisait alors monter dans des greniers de maisons du village.
Je dois dire que ma mère assurait sa présence par des visites impromptues, aussi fréquentes qu’elle le pouvait, malgré les risques effroyables que ces initiatives (prendre le train, échapper aux rafles, sauter du train avant l’arrêt où les contrôles étaient fréquents) lui faisaient courir. Elle a vécu une vie pleine de dangers qu’elle a su affronter, mais dont le souvenir rétrospectif, des années après la guerre, venait hanter ses rêves.
Puis ce furent le débarquement et la libération au cours des mois suivants. Notre région, proche du lieu des combats, a été parmi les premières libérées. En septembre, nous avons quitté Brou. Ma mère, comme de nombreux Juifs de l’époque, devait se rétablir économiquement, travailler, trouver un logement décent. Elle ne pouvait pas nous reprendre tout de suite. Après un intermède de quelques jours à Paris où nous sommes passés par un orphelinat d’une rebutante sévérité, nous avons été pris en charge par l’OSE et envoyés dans une colonie de vacances à Saint-Quai-Portrieux. La mer, les jeux ! Le rêve après l’orphelinat !
Après ces vacances, nous avons rejoint d’autres maisons d’enfants de l’OSE, à Champfleurs, à Mesnil-le-Roi, puis ma sœur et moi avons été séparés : elle, dans une maison de filles, Le Tremplin, où elle est restée un an, et moi à Fontainebleau dans une maison mixte, pendant deux ans. Nous gardons un souvenir ému de ces maisons. Non seulement elles subvenaient à nos besoins, mais elles alimentaient nos esprits et nos intelligences. Je me souviens de Nicole, notre jeune monitrice, issue de la Résistance, qui réunissait dans sa chambre les plus mûrs d’entre nous, encore bien jeunes, pour lire Le Silence de la mer de Vercors et les poèmes de Jacques Prévert. Atmosphère étonnamment libérale et ouverte pour l’époque et tous les sujets de réflexion qui pouvaient refléter la culture et l’actualité de l’époque y étaient évoqués sans tabous, au travers d’un bulletin inter-maisons, appelé Lendemains, où nous pouvions tous nous exprimer.
On peut dire que notre génération issue d’une guerre atroce et d’un régime criminel à son égard a su en sortir sans cultiver le ressentiment ou d’amers contentieux, et a même paradoxalement illustré par ses talents et son énergie ce pays dont elle était citoyenne.
Témoignage recueilli en 2010
ISRAËL PESSES
Interné au camp de Pithiviers à partir du 12 août 1941
Déporté à Auschwitz le 25 juin 1942 par le convoi 4
Assassiné à Auschwitz le 28 juillet 1942 à l’âge de 34 ans
ALBERT PESSES
Fils d’Israël Pesses
-

Extrait du registre des internés du camp de Pithiviers (« Camp de Pithiviers / 1942 »). Archives départementales du Loiret – 20 M 782
-

Israël Pesses au camp de Pithiviers (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Israël Pesses (entouré) au camp de Pithiviers (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Israël Pesses (entouré) au camp de Pithiviers (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales