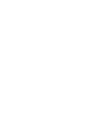Joseph SZAJN
par sa fille Charlotte Messer
Mes parents sont nés à Szydlowiec, une petite ville près de Radom, mon père en 1905 et ma mère en 1906.
Des deux côtés de ma famille, nous descendons de très grandes familles rabbiniques et mon père a suivi la tradition. Quand mes parents se sont mariés, en 1929, il est rentré dans l’entreprise de mon grand-père maternel qui fabriquait des bas à Lodz. Avec la grande dépression, toute la famille maternelle et paternelle s’est dispersée.
Ma mère et mon père sont venus en France en 1933, pour des raisons économiques. Ma tante et mon oncle, qui avaient créé cette entreprise de chaussettes, sont partis en Palestine et les autres membres de la famille sont restés en Pologne. Maman avait neuf frères et sœurs, mon père avait juste un demi-frère. Ils ont tous été déportés, soit cent vingt-deux membres de ma famille paternelle et maternelle.
Ma grand-mère maternelle venait d’une famille très riche, qui habitait à Wolanow.
Ma mère et ma tante parlaient le yiddish et le polonais, parce que maman avait fréquenté l’école polonaise, mon père également. Le yiddish était vraiment la langue de la maison et le polonais était la langue du commerce, la langue du dehors. Mon père parlait aussi l’hébreu. Il a été au heder, puis il a fait des études talmudiques et il est allé au lycée.
Mes parents sont d’abord passés par Bruxelles, où se trouvait une tante de ma mère, assez aisée, dans l’espoir de travailler. Sans papiers, ils ont été emprisonnés et expulsés. Ils sont donc venus en France, toujours sans papiers, et travaillant la nuit. Ils ont d’abord habité 14 rue Pierre Dupont, dans le 10e arrondissement, ensuite au 16 de la même rue, où je suis née. Quand ma sœur est née en 1935, la situation s’était régularisée, ils ont eu des papiers, mais la vie était, je pense, très difficile.
Le 14 mai 1941, mon père a reçu le fameux papier vert, c’était le jour de mes quatre ans. Je me souviens parfaitement de cette journée-là. Papa et maman sont partis tôt de la maison, maman avait fait plein de gâteaux, je pense qu’elle avait organisé une fête pour mon anniversaire. Ma sœur de six ans était malade. Maman nous a dit de les attendre. Elle est revenue sans prononcer la moindre parole. Elle a pris une valise avec des affaires, elle a pris tous les gâteaux, et elle a dit “je reviens”. On ne savait pas où était papa. Et on ne l’a jamais revu, sauf une fois, à Beaune-la-Rolande. Ce qui était complètement incompréhensible, c’est que maman ne parlait pas, elle ne nous a rien dit et nous n’avions rien demandé.
L’immeuble du 16 rue Pierre Dupont, qui existe toujours, comporte deux bâtiments de part et d’autre d’une cour. Il n’y avait pratiquement que des Juifs, et la plupart ont répondu à cette convocation. Ils devaient tous revenir vite. Et maman est revenue seule. On n’a pas fêté mon anniversaire, je n’ai pas eu la poupée promise. Ce jour-là a été gommé comme journée de joie et maman ne nous a jamais plus fêté aucun de nos anniversaires. J’en ai pris conscience très tardivement, le jour de mes 21 ans, quand ma sœur m’a offert un cadeau.
Ensuite, j’ai un trou jusqu’à ce mois de juillet 42, quand on a frappé à la porte. Je pense que je devais être à la Maternelle, et ma sœur à l’école primaire. Elle a porté l’étoile. Je pleurais parce que j’en voulais une aussi, je trouvais ça très beau, et maman m’a fait une fausse étoile pour que je puisse la porter. Maman devait satisfaire à tous les besoins de la vie.
Ma sœur me dit qu’une fois nous sommes allées à Beaune-la-Rolande. Elle se souvient qu’elle avait vu papa à l’extérieur du camp. On n’était pas rentrées dans le camp, et ce qui l’avait beaucoup frappée c’est qu’il portait une barbe et elle s’est mise à pleurer parce qu’elle ne le reconnaissait pas. Apparemment, après, il s’est rasé, puisque sur toutes les photos que nous avons, il n’a pas la barbe. Ma mère a fait en sorte que l’absence de papa ne soit pas un trop grand traumatisme pour nous. C’était une femme absolument extraordinaire.
La guerre a continué pour nous le 16 juillet, on prenait tous les Juifs dans les appartements. On habitait toujours 16 rue Pierre Dupont. Au moment où on a frappé, maman a mis la main devant la bouche pour nous dire de ne pas bouger. Nous avons entendu derrière la porte, une petite amie de Marguerite, ma sœur, disant “je sais que Marguerite est là, je sais que Marguerite est là”, et la concierge, Madame Gibert, “vous voyez bien qu’il n’y a personne” et ils sont partis. Le soir même, nous sommes allées nous cacher dans un appartement vide, qui appartenait certainement à des amis. Nous y sommes restées quelques jours avec les volets fermés, sans bouger, assises, ma sœur et moi, sur une table placée près de la fenêtre, ne chuchotant que lorsqu’une voiture passait sous la fenêtre. Nous ne descendions de la table que le soir. Il me semble qu’en bas il y avait un atelier, et au-dessus des gens qui marchaient. J’avais cinq ans et ma sœur sept.
Puis nous sommes parties avec un groupe d’amis pour passer la ligne de démarcation. Je ne sais pas à quel endroit. Je me souviens, juste d’un soir, en pleine campagne, on entendait les chiens allemands aboyer. On a marché toute la nuit dans l’eau, à la demande du passeur, je crois, jusqu’à Moulins. Maman n’en pouvait plus, elle voulait abandonner, c’est ma sœur qui l’a soutenue. On est restées quelques jours cachées là, jusqu’à ce que maman essaie de se remettre.
Elle avait un accent très prononcé. Elle parlait très mal le français. Un jour, ma mère a fait un rêve prémonitoire concernant un train pour Montauban : elle a rêvé de son père lui déconseillant de prendre l’un des deux trains. Elle a raconté ce rêve à tous ses amis, et malheureusement, toutes les personnes qui ont pris l’un des deux trains (que maman n’a pas pris) ont été déportées. C’est un train qui a été arrêté par la police française.
À Montauban, elle rencontre, tout à fait par hasard, un ami qui la conduit auprès d’une famille qui lui a proposé d’être femme de ménage et de nous garder – et elle nous a vraiment très bien gardées jusqu’au jour où elle a été dénoncée parce qu’elle cachait des Juifs. À la Kommandantur, elle a été battue et elle ne nous a pas dénoncées. Il nous a fallu partir à Golfèch, un petit village. On n’était pas malheureux. On allait à l’école, ma sœur et moi, sous une fausse identité, jusqu’à la fin de la guerre. Maman est partie à Paris, pour essayer de recommencer sa vie.
Elle n’avait pas de nouvelles de mon père pendant ce temps-là. Elle a appris son décès quand nous avons été à l’hôtel Lutétia. Elle a fait des recherches et a eu des papiers officiels, dans les années 1950.
Maman a trouvé un appartement rue Julien Lacroix, le nôtre était occupé par des personnes dont la maison avait été démolie. Après différents procès, je crois qu’on a récupéré l’appartement en 1948 ou 1949. À ce moment-là, on savait que papa ne reviendrait pas. Pour nous-mêmes, il y avait une sorte de pudeur par rapport à cette absence. L’absence de mon père est plus difficile maintenant que lorsqu’on était enfant ; parce que maman disait à tout le monde “je suis leur père et leur mère”. Et quand on a récupéré l’appartement rue Pierre Dupont, elle a commencé à travailler chez les autres, elle a appris le métier de tricoteur et s’est mise à son compte. En 1952/53, maman avait un atelier de 14 ouvrières. On avait pris un très grand local, 53 rue Notre-Dame de Nazareth, et un appartement dans l’immeuble. En 1953, c’est la première fois qu’on avait une salle de bains et des toilettes.
Pour nous, maman ne s’est jamais mise en ménage. Quand après la guerre, il y avait des prétendants, et qu’un homme disait “mais qu’est-ce que vous allez faire de vos deux filles ? Où va-t-on les placer ?”, Maman mettait les hommes dehors et disait “je ne me séparerai jamais de mes filles”.
Maman nous parlait beaucoup de notre père. Elle nous disait qu’il ne pouvait pas entendre un enfant pleurer, et lorsque maman nous grondait, c’est mon père qui pleurait, ou quand on pleurait, il pleurait avec nous. À la maison, il y avait toujours du monde, tout le monde venait manger à la maison. Pour mes parents, c’était absolument impensable de dîner un soir seuls, mon père partageait toujours. Nous avons gardé, ma sœur et moi, cette philosophie de la vie.
Après la guerre, notre mère nous a tout le temps parlé de notre père avec beaucoup de respect.
En fait, ma mère et mon père se sont connus à l’Hashomer Hatzaïr. Maman a vécu l’antisémitisme, c’est certain, mais par les Associations juives, maman nous racontait des moments très heureux en Pologne. Après l’Hashomer, mon père est devenu militant du Bund. Quand ils sont venus en France, ils n’étaient plus religieux.
Quand il a été déporté, il a écrit une lettre à maman, mais que, malheureusement, on ne retrouve pas, en disant “il faut que tu saches que je ne suis pas déporté parce que je suis socialiste, mais uniquement en tant que juif et je te demande d’élever Charlotte et Marguerite en tant que juives, rappelle-leur la tradition, rappelle-leur les fêtes”.
On interdisait à maman de nous parler en français, parce que quand elle nous parlait français, on sentait l’étranger. Elle nous disait toujours “écoutez, mes enfants, comment voulez-vous que je gère mon entreprise, comment voulez-vous que j’aille faire du commerce avec mon accent et mes fautes ?”. On lui disait “mais écoute, tu te débrouilleras, nous on va te parler en français et tu nous réponds en yiddish”. Et maman ne parlait qu’en yiddish, même dans la rue. Dans le métro, on lui disait : “Maman, parle yiddish”. Pour nous, c’était notre intimité. On ne savait ni lire, ni écrire, en yiddish. Maman est partie vivre en Israël où elle avait encore sa sœur en 1961. Elle a eu un cancer osseux en 1957 et, sans sa volonté, elle n’aurait jamais survécu. Ma sœur l’a rejoint en 1968.
Ce témoignage, je le fais pour mon père et pour ma mère. Pour mon père qui devait être un homme d’une grande tendresse, d’une grande écoute, d’une grande humilité, quelqu’un de bien, une personne chaleureuse, très attentive aux autres. Je pense qu’on aurait été très heureux ensemble.
Il est parti par le convoi 5, en juin 1942. J’ai appris qu’il est décédé très vite, le 4 septembre 1942, et quelque part, pour moi, c’est un soulagement, parce que je ne pense pas qu’il aurait survécu à la guerre. Quand il y a la commémoration, avec Serge Klarsfeld, à Beaune-la-Rolande, j’emmène toujours les photos, en espérant que quelqu’un qui aurait connu mon père le reconnaisse.
Je n’ai rien raconté à mes enfants, et ils n’ont rien demandé, sans doute par pudeur. Ils savent que mon père a été déporté. Ils connaissent très bien l’histoire de la Seconde guerre mondiale, mais pas mon histoire. Ce témoignage est utile pour mes enfants et mes petits-enfants. Souvent le passé remonte, et la dépression me guette. Plus je vieillis et moins je supporte, et je comprends parfaitement que Primo Levi se soit suicidé, je comprends les gens qui se sont suicidés.
Témoignage recueilli en 2008
JOSEPH SZAJN
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 par le convoi 5
Assassiné à Auschwitz le 4 septembre 1942 à l’âge de 37 ans
CHARLOTTE MESSER
Fille de Joseph Szajn
Née le 14 mai 1937 à Paris 10e
-

Joseph Szajn en 1941 (au camp de Beaune-la-Rolande ?). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est le 2e en partant de la droite (janvier 1942, sd). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est debout au 2e rang, le 2e en partant de la droite (avril 1942, sd). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est le 2e en partant de la gauche (avril 1942, sd). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est le 3e en partant de la droite (mai 1942, sd). Archives familiales
-

Joseph Szajn au camp de Beaune-la-Rolande (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est le 3e en partant de la gauche (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Mordka Wisniewski est le 2e en partant de la droite. Archives familiales
-

Au camp de Beaune-la-Rolande. Joseph Szajn est le 2e en partant de la gauche (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales