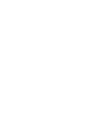Léon HECKER
par sa fille Francine Bordet
Mon père, Léon Hecker, est né en 1885, à Bruyères dans les Vosges où ses parents tenaient une boucherie. Son père, originaire de la vallée de Saint-Amarin en Alsace, avait émigré avec toute sa famille en Lorraine pour ne pas être Allemand.
Mon père, ayant perdu sa mère assez jeune, n’avait pas eu la possibilité de poursuivre ses études au-delà du brevet élémentaire. Il était devenu boucher comme ses parents et ses grands-parents. Il avait ouvert une boucherie à Thaon dans les Vosges, en association avec son frère. Parallèlement, ils étaient aussi marchands de bestiaux et éleveurs.
Il s’est marié peu avant la guerre de 14-18. Ma mère était Lorraine, originaire de Vic-sur-Seille, ville allemande à l’époque. Mes parents se sont rencontrés par l’intermédiaire de connaissances communes (mon grand-père maternel était également boucher). Je crois qu’ils se sont vraiment aimés, bien qu’il se soit agi d’un mariage arrangé. Mon père était un homme très droit et fier de sa nationalité française, sans pour cela être un extrémiste. Il lisait beaucoup et était abonné à plusieurs journaux, en particulier l’Œuvre et Marianne. Partisan d'Aristide Briand, radical-socialiste et franc-maçon, il croyait profondément que nous pouvions nous entendre avec les Allemands. Ce n’était pas un militant, mais il avait des idées très affirmées et discutait souvent avec mes sœurs aînées pendant les repas. En 1914, mon père a été mobilisé comme brancardier. Il s’est fait de nombreux amis, particulièrement des curés avec lesquels il a partagé ces années si difficiles. L’un d’eux nous aidera en 1942, en nous fournissant des certificats de baptême.
Bien qu’il ait été gazé, il avait pu reprendre ses activités normalement après la guerre. Il a eu six enfants, je suis la plus jeune. Malheureusement, ma mère est morte en 1934, le laissant désemparé. Heureusement, il a pu compter sur mes sœurs aînées, âgées alors de 14 et 16 ans.
Notre famille n’était pas pratiquante, particulièrement mon père. Cependant, nous respections les grandes fêtes. Mon frère a fait sa bar mitzwa, mes sœurs ont suivi les cours de religion. Quant à moi, j’étais trop jeune (je suis née en 1929). Bien sûr, je savais que j’étais juive, mais, à vrai dire, cela n’avait pas beaucoup de réalité. Nous nous vivions comme Français, le judaïsme étant seulement une religion.
En juin 1940, comme beaucoup d’autres, nous sommes partis vers le sud. Lorsque mon père a compris que Pétain avait signé l’armistice, il décida de rentrer chez nous à Épinal. L’idée de rester dans le sud pour éviter l’occupation allemande ne l’a pas effleuré. Rien ne pouvait nous arriver : il n’a jamais pris au sérieux les menaces hitlériennes, ni les récits des réfugiés allemands arrivés en 1938 en Lorraine. Je l’entends encore dire : “Pour nous, c’est différent, nous sommes Français et Pétain ne laissera jamais les Allemands nous menacer, surtout les Anciens Combattants.”
Je pense qu’il ne commença à comprendre qu’en octobre 1940, quand Pétain édicta les premières mesures anti-juives et qu’il dut abandonner ses affaires (boucherie et fermes d’élevage). Ma sœur aînée dut quitter l’enseignement. Mais c’est vraiment au début 1942 qu’il réalisa le danger. Il décida alors que mon oncle, mon frère alors âgé de 21 ans et lui-même passeraient en zone libre pour trouver un refuge et faire venir le reste de la famille.
En mars 1942, mon oncle et mon frère partirent tous les deux dans un wagon plombé, grâce à un réseau résistant de cheminots. Ils arrivèrent sans encombre et retrouvèrent une de mes sœurs mariées qui vivait en zone libre. Mon père partit deux jours plus tard, mais il fut arrêté à la ligne de démarcation, le réseau ayant été dénoncé. Il fut condamné à quelques mois de prison. Il devait être libéré en juin. Mais, entre-temps, Pétain avait décidé de livrer aux Allemands les Juifs arrêtés pour quelque motif que ce soit.
Il fut d’abord interné à la maison d’arrêt de Dijon, puis en mai, au fort d’Hauteville. Durant son séjour, il reçut la visite d’un ami qui put lui apporter de nos nouvelles et décider avec lui de différentes mesures.
Au travers de ses lettres, nous avions quelques précisions sur sa détention. Il était sûr d’être libéré rapidement. Le 13 avril, il écrit “Dites à Mémère que le moral est bon et qu’on se verra sous peu, il y a déjà un mois de passé”. Ses premières lettres sont écrites sur des cartes d’un format imposé (format carte postale). Au début, il pouvait recevoir assez facilement des colis et envoyer des lettres, puis après il n’avait plus le droit qu’à une lettre par semaine, mais plus longue. La nourriture était certainement insuffisante (soupe d’épinards, de légumes, de topinambours), aussi comptait-il sur les colis qu’il recevait rapidement. On lui envoyait des conserves, du beurre, des biscottes, du saucisson sec, des cigarettes qu’il échangeait avec les autres prisonniers. Tout un système de livraison de colis était organisé avec des gens de l’extérieur, en particulier, une blanchisseuse. Il s’arrangeait pour cuisiner avec de l’alcool ou du charbon de bois et trouvait le moyen de se composer des menus corrects, surtout lorsque les colis arrivaient en bon état. Nous disait-il la vérité ou était-ce pour ne pas nous inquiéter ? Il pouvait recevoir également des vêtements et nous renvoya un manteau et un costume par l’intermédiaire d’un certain Dominique (certainement un pseudonyme).
Il parle de visites qu’il recevait d’un ami servant d’agent de liaison qui nous transmettait les lettres et les consignes de mon père au sujet de ses affaires. Il avait vraiment le souci de nous aider au maximum et de nous donner les moyens de vivre en son absence. Il avait attrapé des poux, mais avait pu s’en débarrasser grâce à une blanchisseuse, Mme Dullier, qui accepta de lui laver son linge. Dans ses lettres, il ne se plaint jamais, mais avoue trouver le temps long. Il croit toujours être bientôt libéré, puisqu’il dit en date du 19 mai “le camarade Paul Vernay doit sortir lundi, c’est-à-dire un jour avant moi. Il vous téléphonera si cela se passe sans encombre. Alors, il y aura des chances que j’arrive le lendemain”. Cependant, il ajoute “Dans les circonstances présentes, on ne sait jamais. On voit tous les jours des gens transférés dans des camps à l’expiration de leur peine”. Cependant, sa lettre se termine par “Alors à bientôt ”.
Dans ses lettres, il cite quelques personnes : un Monsieur Lévitan, journaliste à “l’Auto”, Pierre Ignace, un cousin lointain enfermé à Compiègne, le comte de Montreuil, “type intelligent, catholique convaincu et sympathique, propriétaire dans la Dordogne et en Normandie, son père administrateur de la Banque de France” et il ajoute ce détail extraordinaire : “Celui-ci, comme il arrive quelquefois a été invité à se rendre à la prison par ses propres moyens, et il s’est rendu directement ici sans passer par la prison de Dijon, venant de Paris”. Il parle également d’un tailleur, M. Goldschmitt qui rend bien des services aux prisonniers, d’un ami de Charmes dans les Vosges, Robert Lévy et d’un Hollandais Zelander, agent général de Philips.
Il pensait être libéré le 23 juin. En fait, il fut envoyé au camp de Pithiviers, convoyé par deux gendarmes français qui décidèrent de le loger, pour une nuit, dans un hôtel à Orléans. Malheureusement, il ne saisit pas cette chance de s’échapper, croyant toujours être libéré rapidement.
Dans une lettre datée du 24 juin 1942 et écrite à Etampes, il nous explique qu’il est en route pour le camp de Pithiviers en attendant, dit-il, d’être transféré à Beaune-la-Rolande. Il apparaît qu’ils ont fait une partie du trajet à pied et une autre en train, car nous avons reçu une lettre datée du 24 juin d’un voyageur nous prévenant qu’il avait voyagé avec mon père et Robert Lévy, et que mon père lui avait demandé de nous avertir de son transfert.
À la fin de cette lettre, il suggère que peut-être, il ne sortira pas de prison “à moins qu’on ne puisse m’en tirer comme ancien combattant”, mais il ajoute “Je ne me rends pas compte”. Il semble, d’après ses lettres, que mon père ne fut jamais transféré à Beaune-la-Rolande. Finalement, il fut déporté le 17 juillet 1942 de Pithiviers par le convoi 6. D’après les archives d’Auschwitz, il est mort le 13 août 1942.
Mes sœurs essayèrent de le faire libérer en raison de son âge et de sa qualité d’Ancien Combattant, mais en vain. Elles reçurent même une proposition de libération contre la somme de 100.000 F. En fait, ce n’était qu’une escroquerie. Je me rappelle que nous avons appris son départ “pour l’Est”, comme il disait, très rapidement car mes sœurs avaient entrepris des démarches officielles. On leur a répondu que c’était trop tard car il avait déjà quitté le camp de Pithiviers et passé la frontière. Mes sœurs avaient contacté un avocat, Maître Paul Eber de Nolay, le 10 juillet 1942. Celui-ci leur conseilla, par une lettre du 20 juillet, ô ironie ! d’essayer de s’adresser aux autorités officielles seules capables d’intervenir. Là encore, il était trop tard.
Quant à nous, nous étions restés à Épinal, dans la maison familiale. J’allais au collège de jeunes filles, en classe de quatrième. Nous habitions près d’une ferme et ne manquions de rien, d’autant que mon père était resté en relation avec le gérant de son affaire. Il en parle dans quelques-unes de ses lettres. En juin 1942, nous avons dû porter l’étoile jaune, peu de temps, car je fus envoyée en zone libre.
Je pense que nous avons su l’arrestation de mon père par son courrier. Il a pu échanger des lettres avec mes sœurs. Les premières que je possède datent de la mi-avril. À ce moment-là, nous ne réalisions pas vraiment ce que cela signifiait, mais dès le mois de novembre 1942, des informations entendues sur la BBC ne nous avaient pas laissé beaucoup d’espoir quant aux gens partis “vers l’Est”, d’autant que mon père était déjà âgé et de santé fragile. C’est alors que nous avons commencé à avoir vraiment peur d’être arrêtés et avons compris la réaction des Juifs polonais arrivés chez nous et préférant se tuer plutôt que de tomber dans les mains des Allemands. Cependant, il nous fallut attendre la fin de la guerre et le retour des premiers déportés pour comprendre et réaliser la disparition de mon père. Malgré de nombreuses démarches, nous n’avons jamais rencontré de gens l’ayant connu.
J’ai toujours dit la vérité à mes enfants au sujet de la disparition de leur grand-père, sans beaucoup insister sur la culpabilité allemande. J’ai toujours cherché à leur faire comprendre la différence entre un peuple et ses dirigeants. Je ne voulais pas que mes enfants, puis mes petits-enfants portent l’angoisse que j’aurais pu leur transmettre. Je ne leur ai jamais caché, que, bien que non croyante ou pratiquante, je me reconnaissais comme juive.
Pour que mes petits-enfants n’oublient pas ce lourd passé et puissent l’assumer, j’ai écrit un court récit de ma vie et particulièrement de mon enfance. Je tiens à ce qu’ils le connaissent et ne renient pas leurs origines.
Témoignage recueilli en 2011
LÉON HECKER
Interné au camp de Beaune-la-Rolande le 27 juin 1942 (après arrêt à Pithiviers)
Déporté à Auschwitz le 17 juillet 1942 par le convoi 6
Assassiné à Auschwitz le 13 août 1942 à l’âge de 57 ans
FRANCINE BORDET
Fille de Léon Hecker
Née en 1929