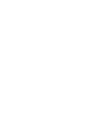Henoch (Henri) RAUSCH
par sa fille Claire Farkas
Henoch, ou Henri, pour tous ceux qui m’ont parlé de lui.
Comment écrire l’histoire de mon père? Comment écrire à propos de quelqu’un qu’on n’a jamais connu, ni vu, ni touché, ce quelqu’un qui est mon père? Dès mon plus jeune âge, je l’ai aperçu sur les photographies, que par chance ma mère avait conservées, et qu’aujourd’hui je garde soigneusement. Elles sont en noir et blanc et, malgré le temps, n’ont pas vieilli, comme mon père, d’ailleurs, cet homme qui n’a pas vieilli, qui est resté jeune à jamais. Il a parcouru un court chemin dans la vie, il n’a marché que 27 ans.
Il est né le 12 juin 1914 à Zolkiew, Lwow, en Pologne, aujourd’hui l’Ukraine, deuxième fils d’Abram Rausch et de Jutta Astman, d’une famille de cinq enfants, trois garçons et deux filles. Son père exerçait le métier de charretier, c’est-à-dire messager : il faisait des courses pour ceux qui avaient besoin de transporter soit des marchandises, soit du courrier. Je n’ai aucun autre renseignement concernant les origines de la famille Rausch. Par contre, je sais que la famille Astman était originaire de la région depuis plusieurs générations, le père de ma grand-mère maternelle était issu d’une famille de douze garçons.
J’ai très peu d’informations à propos de l’enfance de mon père, concernant son éducation. Je peux déduire qu’il a dû être élevé au “heder “ comme la plupart des enfants à l’époque, qu’il a dû être en bas âge apprenti fourreur, renseignement que j’ai eu par mon beau-père, à savoir que tous les enfants étaient préparés pour apprendre un métier. À part cela, je n’ai pas d’autres informations.
De toute sa famille, seulement ses deux frères ont survécu à la guerre, l’aîné, Bernard et le cadet, Teddy ; la sœur aînée a été déportée avec son mari et son enfant de Malines, Belgique, en 1944, la sœur cadette a été massacrée avec ses parents par les Nazis dans leur village. Mes oncles se sont murés toute leur vie dans un silence impénétrable, concernant leur vie d’avant. Même aujourd’hui, le frère cadet de mon père, qui vit toujours, se cache derrière le mur de l’oubli, bien bâti et impénétrable. Par contre, mon autre oncle, qui est décédé il y a deux ans à l’âge de 94 ans, a fait une seule fois l’aveu à une de mes cousines de son grand remords d’avoir quitté l’Europe en 1939 sans mon père, s’étant toujours considéré responsable de ses frères et sœurs et par conséquent, par la suite, du reste de la famille. Je n’ai pas non plus de renseignements précis concernant l’arrivée de mon père en France ni dans quelles conditions il est arrivé.
Comment reconstruire la narration d’une vie ? Une vie courte, mais pas moins intense. Je ne connais mon père que par les récits de ma mère, de mes tantes, de ses amis, qui ont survécu à la guerre. C’est ainsi que j’ai pu me faire une image de son caractère, de ses qualités, de ses défauts, de sa manière d’être, de son aspect physique. Il paraît qu’il avait les yeux d’un bleu ciel, ce qui lui donnait un regard mélancolique. Peu de photos le montrent souriant, mais plutôt grave et soucieux. Il était svelte et même athlétique, maintes photos le montrent faisant du ski, du vélo, du foot, du canoë, à la plage. Et travailleur, d’après les photos prises dans son atelier de travail. Il avait son propre atelier, avec une équipe de trois ou quatre personnes avec lui, tous à la tâche avec leur tablier blanc.
D’après le dossier établi par la CIVS, j’ai pu constater la date précise de l’arrivée de mon père en France, information que, jusqu’à présent, je n’avais pas obtenue. Le Registre Analytique, folio 108, précise “aut. France 13-6-33”. Il s’est fait immatriculer au registre de Commerce l’année suivante, en 1934, comme fourreur, au 80 Faubourg Saint-Denis, à Paris 12e. En 1936, il était également inscrit au registre des Métiers, avec les mêmes mentions. Son atelier sera l’objet d’une mesure d’aryanisation, et par la suite, trois administrateurs se succéderont, jusqu’en 1944, lorsque les scellés seront levés. Ma mère s’est fait enregistrer de nouveau au Registre des Métiers dès 1945, dans l’espoir de son retour.
Mes parents se sont mariés en 1938 et habitaient au 49 rue Condorcet, Paris 9e. Dès leur mariage, ma mère a rejoint mon père dans son travail qui n’était pas nouveau pour elle, étant elle-même fille de fourreurs. Ils avaient leur atelier au 80 Faubourg St-Denis, dans le 12e.
Ma mère, Tatiana Leifer, est née le 31 Janvier 1915 à Brest-Litovsk, qui était en Russie à l’époque. Ses parents, Zalman Leifer et Rosa Tilles, tous deux également originaires de Brest-Litovsk, sont arrivés en France en 1920, avec trois enfants et la mère de mon grand-père, Rachel Nephtar, fuyant la montée des bolcheviques, la famine et la misère de la Russie. Ils avaient obtenu des permis d’entrée et de résidence par l’intermédiaire des parents de ma grand-mère maternelle, qui déjà résidaient en France dès 1910 ou 1912. Donc toute la petite famille a obtenu la nationalité française en 1921. Les trois sœurs de ma mère sont nées à Paris. Elle était l’aînée de six enfants, deux de ses sœurs, Sylvie et Fanny, sont décédées ces dernières années, ses frères, Moise et Benjamin, ont été arrêtés le 20 août 1941, lors de la rafle du 11e arrondissement, tous les deux ont été déportés aussi à Auschwitz par les convois 1 et 3. Sa sœur cadette, Annie, vit toujours à Paris ; ma mère, qui par la suite s’était remariée en Argentine, a vécu avec mon beau- père, dès 1980 près de chez nous, jusqu’à leurs décès.
Lors de la déclaration de la guerre, d’après ce que j’ai su, mon père a compris qu’il lui fallait aussi, comme son frère aîné, quitter la France. C’était le dilemme de tous les ressortissants étrangers : où aller ? Son but était de rejoindre son frère cadet en Amérique, mais à cause des différents quotas, les visas d’entrée étaient presque impossibles à obtenir. Pourtant, il a fait plusieurs démarches et a finalement obtenu un visa pour aller en République Dominicaine. Ils ont quitté Paris avec ma mère pour embarquer, mais en chemin, il s’est retrouvé face à l’armée polonaise en retraite. Comme ses papiers indiquaient qu’il était de nationalité polonaise, il a été forcé de suivre cette unité polonaise jusqu’à ce qu’elle soit faite prisonnière par les Allemands. Il s’évade et retourne à Paris. Je n’ai aucun renseignement sur son évasion.
Et la vie a repris comme auparavant, jusqu’à la convocation du “billet vert”, le 14 mai 1941 où il a été interné à Beaune-la-Rolande, dans le Loiret. Un administrateur provisoire a été nommé pour son atelier de travail, et les scellés ont été installés. Ma mère est allée plusieurs fois le voir. Lors d’une visite, elle avait organisé son évasion. Apparemment, cela n’était pas trop difficile, mais bien qu’elle ait tout préparé, il a refusé de s’évader, de se cacher, d’avoir de faux papiers. Les détenus étaient convaincus, au début, que leur arrestation serait provisoire, qu’ils seraient ensuite transférés dans des lieux de travail.
De cette période fatidique concernant Beaune-la-Rolande, j’ai certaines photographies de mon père, devant sa baraque, fumant, seul. J’en ai d’autres avec un groupe d’hommes, photos un peu floues, mais tout de même identifiables. Période qui a occasionné à ma mère un chagrin ineffable, qu’elle a “traîné” toute sa vie. Son refus d’évasion, lorsque c’était encore possible, son manque d’initiative et de prise de risques lui ont été difficiles à accepter, elle qui a été toute sa vie audacieuse, énergique et courageuse, comme la suite l’a prouvé.
Je n’ai pas à juger ni l’un ni l’autre, car les circonstances étaient telles que, sans doute, il n’avait pas trop le choix. Au fil du temps, ma mère l’a accepté, disant que cela avait été son destin.
De mon père, je n’ai que trois objets : son porte-cigarettes, une boîte à bijoux, et une grammaire. Le porte-cigarettes est un peu cabossé, peut-être à cause des péripéties passées. Il est en argent, avec ses initiales, HR. Lorsque ma mère me l’a remis, il y avait dedans sa dernière lettre de Beaune-la-Rolande ; lettre que par la suite j’ai déplacée, consciemment ou inconsciemment, jusqu’au jour où je ne l’ai plus retrouvée, mais je me souviens presque mot à mot de ce qu’elle disait. C’était juste avant sa déportation, elle était rédigée dans un français parfait : il lui disait d’avoir confiance en l’avenir, qu’il partait vers un camp de travail, et qu’à son retour, ils allaient m’élever ensemble. Ce qui ne s’est jamais produit. Apparemment, ils avaient beaucoup correspondu tout au long de son séjour à Beaune-la-Rolande, et à un certain moment, je ne sais pas exactement quand, ma mère m’a avoué que dans un moment de rage, elle a brûlé toutes les lettres, sauf la dernière.
Je suis née le 17 janvier 1942, à Paris 9e. Et il est parti en déportation par le convoi 5, le 28 juin 1942. Pour ne jamais revenir.
Le deuxième objet est une boîte à bijoux ou à couture, en bois qu’il a dû acheter à Beaune-la-Rolande, fabriquée par des prisonniers. Il y a une inscription sur l’arrière et on peut lire : “Souvenir de Beaune-la-Rolande à ma chère femme Tatiana. 21-2-1942”.
Et le troisième est une petite grammaire française, qui a dû lui appartenir car son nom est inscrit sur la première page : Henri Rausch, livre que j’ai retrouvé, à ma grande surprise, il n’y a pas longtemps, lorsque j’ai trié les affaires de ma mère.
Par la suite, ma mère décida de fuir en zone libre, avec deux de mes tantes et moi. Nous avons franchi la ligne de démarcation, et nous nous sommes installées à Saint-Antonin-Noble-Val, dans le Tarn-et-Garonne, où munies de faux papiers, nous sommes restées jusqu’à la fin de la guerre.
Tout ce que ma mère m’a raconté de mon père l’a été par bribes, toujours entrecoupées par des larmes. Elle a toujours été fidèle à sa mémoire, même remariée, même après plus de 50 ans. Cela ne pouvait pas en être autrement, il avait été l’amour de sa vie. Elle a toujours été hantée par ces années de guerre, d’occupation. Jusqu’à ses derniers mois, dans le brouillard de sa vie, cela était resté ancré dans sa mémoire.
Je ne peux pas dire quand exactement j’ai entendu le mot fatidique d’Auschwitz, lieu qui finalement me hantera le reste de ma vie. Même après m’y être rendue, je pense toujours à ce lieu avec effroi, ce musée de l’horreur, aujourd’hui devenu le symbole de la barbarie nazie.
En octobre 1948, ma mère et moi avons quitté définitivement la France pour partir en Argentine, où les frères survivants de mon père étaient installés. C’est à peu près à cette époque, d’après mes souvenirs, que chaque Yom Kippour, ma mère m’a encouragée à aller à la synagogue pour dire le Kaddish en souvenir de mon père. Par la suite, ma mère s’est remariée avec un survivant, Samuel Honig, qui lui aussi avait eu sa première épouse déportée, et qui aussi, par ce hasard de la vie, était du même “shtetl” que mon père, et qui l’avait connu. Il était de la même génération que mon oncle. Il ne m’a jamais trop parlé de mon père, par égard pour ma mère, mes oncles, ou pour lui-même, je n’ai jamais su et je n’ai jamais insisté. Nous avons constitué une famille. Il a été mon père adoptif, j’ai toujours été pour lui l’enfant qu’il n’a jamais eu. Et il a été un vrai grand-père pour mes enfants. Il est décédé en 2004, à l’âge de 94 ans.
Je me suis mariée avec Jorge Farkas et, en 196,9 nous avons pris la décision de partir aux États-Unis, où nous avons eu deux enfants. Nous résidons à présent à Newton, dans la banlieue de Boston.
Chaque fois que je vais à Paris, je vais au Mémorial de la Shoah, même pour peu de temps, effleurer la dalle où ses nom et prénom sont inscrits à jamais.
En tout cas, aujourd’hui, je peux dire que sa disparition ne tombera pas dans l’oubli, sa mémoire reste et restera vivante. La vie a pris le dessus. Le 4 septembre 2008, ma petite-fille est née, c’est-à-dire son arrière-petite-fille, exactement 66 ans à quelques jours près de sa disparition. Les archives indiquent que son décès à Auschwitz a eu lieu le 27 août 1942.
Ma mère est décédée en décembre 2008, six semaines avant ses 94 ans, mais elle aura eu le bonheur d’avoir vu naître son arrière-petite-fille.
Et ce qui restera pour toujours, c’est le chagrin, la mémoire et tant de questions sans réponses. Et comme dit Elie Wiesel, dans son dernier livre Le cas Sonderberg : “On ne vit pas dans le passé, mais le passé vit en nous”.
Témoignage recueilli en 2010
HENOCH (HENRI) RAUSCH
Interné au camp de Beaune-la-Rolande à partir du 14 mai 1941
Déporté à Auschwitz le 28 juin 1942 par le convoi 5
Assassiné à Auschwitz le 27 août 1942 à l’âge de 28 ans
CLAIRE FARKAS
Fille de Henoch (Henri) Rausch
Née le 17 janvier 1942 à Paris 9e
-

Henoch (Henri) Rausch et Tatiana, son épouse (sd, sl). Archives familiales
-

Henoch (Henri) Rausch, à droite (sd, sl). Archives familiales
-

Henoch (Henri) Rausch au camp de Beaune-la-Rolande (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Extrait du registre des internés du camp de Beaune-la-Rolande (1941-juillet 1942). Archives départementales du Loiret – 175 W 34120
-

Henoch (Henri) Rausch, le 1er à gauche, au camp de Beaune-la-Rolande (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Henoch (Henri) Rausch, le 2e en partant de la droite, au camp de Beaune-la-Rolande (entre mai 1941 et juin 1942, sd). Archives familiales
-

Boîte fabriquée au camp de Beaune-la-Rolande par Henoch (Henri) Rausch. Bois, colle, vernis, encre, métal. Dimensions 24,2 x 5,7 x 9,5 cm. Inscription manuscrite sous le couvercle : « Souvenir de Beaune la Rolande à ma chère femme Tatiana 2.2.1942 ». Collection Cercil N°INV 133. Donation Claire Farkas. Photo © Cercil